Sanaa el-Cheikh perchée au-dessus des forces de l’ordre. Photo Nabil Ismaïl
Samedi 18 janvier, dans l’après-midi, alors que la tension montait d’un cran au niveau du Parlement, dans le centre-ville de Beyrouth, un politologue invité dans le cadre d’un talk-show avance qu’« au vu de la nouvelle tournure de la situation, on verra de moins en moins de femmes dans la rue ». Au même moment, à la télévision, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur divers groupes WhatsApp, on parle d’infiltrés, de cinquième colonne, de casseurs ou même de personnes envoyées par certains partis politiques pour servir on ne sait quel agenda caché.
Au milieu de ce flot d’opinions et de spéculations lancées à tout-va, toutes les caméras, toutes les rétines sont rivées sur la vision lunaire de cette énigmatique jeune femme, la trentaine dirait-on, qui, se détachant de la masse des manifestants en retrait, fonce seule vers le barrage des forces de l’ordre rue Weygand, enjambe les barbelés dans un geste comme échappé d’un manga japonais, pour finir par se percher au sommet de la barrière, les yeux plantés dans ceux des agents des forces de l’ordre… Il suffit de quelques instants pour que le moment, immortalisé par une trentaine de photographes agglutinés autour de cette inconnue qui n’a peur de rien, se répande sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. L’Orient-Le Jour a retrouvé Sanaa el-Cheikh.
(Lire aussi : Pour Baabda, des éléments infiltrés seraient derrière les troubles)
Plus rien à cirer
Ce n’est pas un hasard si cette Tripolitaine de 29 ans a fait des études de droit. Pas une coïncidence, non plus, qu’elle se soit destinée à une carrière d’arbitre et coach d’équipes de football arrivées à des coupes asiatiques. Du plus loin qu’elle se souvienne, Sanaa el-Cheikh bataillait déjà, à l’école, pour les droits de ses camarades, se fichant éperdument de se retrouver en ligne de mire et se mettre la direction à dos. Pour elle, et c’est non négociable, « la justice et la rigueur sont deux choses primordiales ». D’autant plus qu’elle a poussé, et vit toujours, à Tripoli, épicentre de la pauvreté libanaise, « autour d’amis, de proches, de voisins, qui n’avaient plus de quoi s’acheter du pain ou se faire soigner. Alors qu’à quelques pas seulement, les familles les plus riches du Liban se font construire des palais, font fi de notre existence et ne daignent nous approcher qu’avant les élections, histoire de s’assurer nos voix », tel qu’elle le raconte avec une rage dans les cordes vocales. Il aura donc fallu que la révolution se déclenche en octobre dernier pour que Sanaa el-Cheikh, à l’instar de bon nombre de Tripolitains, se « réveille de ce sommeil profond et comprenne, d’un coup, tout le jeu politique dans lequel nous ne tomberons plus ». Les premières semaines, quotidiennement, elle fait sa révolution « contre la faim », tient-elle à préciser, au cœur de la place al-Nour, s’inscrivant en faux contre « ceux pour qui nous ne sommes rien à part des bulletins de vote, et ceci en dépit de ceux qui me disaient de faire gaffe car ma position pourrait froisser certaines personnes ». Mais à ce moment-là, précise-t-elle, elle n’en a « plus rien à cirer ». Dès lors qu’un transport vers Beyrouth est disponible, elle se rend aux places de la capitale pour apporter un soutien pacifique aux révolutionnaires beyrouthins. La semaine de la colère, qui s’est ouverte mardi dernier, a trouvé un écho particulier chez cette batailleuse qui précise : « Nous avons été très patients face à une classe politique qui a fait la sourde oreille pendant les 90 premiers jours de la révolution, et qui ne se soucie que du partage de ce gâteau politique alors que les gens crèvent de faim. »
(Lire aussi : "Arrêtez de viser les yeux" : au Liban, une campagne en ligne contre la répression des forces de l'ordre)
Faire porter sa voix
Cette colère qui sommeillait en elle finit par exploser, samedi 18 janvier, quand les forces de l’ordre recourent à une forte répression afin de faire reculer les manifestants. Le sang de Sanaa el-Cheikh ne fait qu’un tour et elle se précipite vers le barrage des forces de l’ordre qui gardent l’une des entrées du Parlement. Des hommes, autour, essayent de la rattraper, mais elle ne veut rien entendre ou voir, ni leurs conseils, ni les gestes menaçant des forces en face. Comme une créature androïde, elle franchit, en sautant, les barbelés jetés au sol. Elle pense à sa maman, décédée. Elle pense à son frère, décédé, lui aussi, faute de soins conséquents. Elle pense à son papa, et son autre frère qu’elle a à charge, et dont les frais lui paraissent insurmontables. Elle pense à ses comparses tripolitains, leur peine que personne ne semble accueillir, et elle dit : « La douleur, je l’ai connue… Ce n’est pas un barrage qui va me faire peur. » Alors elle grimpe de plus belle, et se retrouve accrochée à la barrière. Ses mains, agrippées au rebord, sont « martelées de coups de bâtons par quatre membres des forces ». Blessée au niveau des doigts, elle se retire alors pour se faire soigner, mais finit par revenir, de plus belle, « faire face aux forces de l’ordre ». Quand elle prend du gaz lacrymogène dans les yeux, Sanaa el-Cheikh va se laver le visage, vinaigre, oignons, et revient sur la ligne de front pour la troisième fois, ne craignant plus rien, faisant fi de ses blessures. C’est à ce moment qu’elle reçoit en pleine face un jet d’eau, ainsi que du gaz lacrymogène qui la contraignent à aller se faire soigner, de nouveau, auprès des secouristes. « Il ne fallait pas me chercher, chaque coup augmentait ma colère », se souvient celle qui, à force de remonter au front, finit par être touchée au niveau du dos par une balle en caoutchouc. Il faut de longues minutes pour qu’un manifestant la repère, étalée sur l’asphalte dans un grand nuage de gaz lacrymogène, non loin de l’hôtel Le Gray, et l’emmène aussitôt à l’hôpital.
« Une fois soignée, j’ai voulu revenir vers la place, mais ça s’était calmé. Je tenais absolument à ce que ma voix porte. Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous sommes un peuple qui se suffit de si peu. De l’électricité, de l’eau, de quoi pouvoir payer des frais médicaux, de quoi manger. De la dignité, en fait, que demandons-nous de plus ? » conclut Sanaa el-Cheikh, dimanche 19 janvier, de nouveau en première ligne au lendemain des infinies violences qu’elle a subies mais qui, affirme-t-elle, « ne m’empêcheront pas de revenir dans la rue aujourd’hui, et tous les jours ». Elle qui n’a plus rien à craindre, car plus rien à perdre, « sinon mon pays qu’il nous faut sauver ».
Lire aussi
De quelle violence parle-t-on ?, l’édito de Émilie SUEUR
Mouvement de contestation : la violence n’est plus un tabou
Les émeutes se renouvellent dans le centre-ville au lendemain d’un samedi d’une violence inouïe
Et maintenant les balles en caoutchouc...



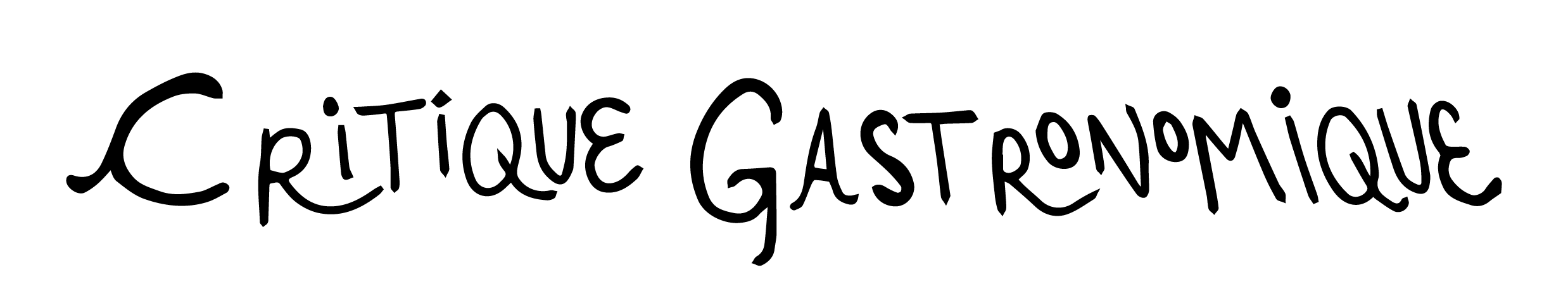
commentaires (14)
Bravo et Respect
Ziad
19 h 46, le 21 janvier 2020