
Photo G.K.
Elle fait ses courses à pied. Elle marche dans la chaleur poisse de Beyrouth, entre les ordures qui se décomposent sous une traînée de moucherons, mais où un homme de son âge, en costume, cherche quelque chose, sans doute de quoi apaiser la faim qui lui creuse les joues. Elle marche parmi les trous et les égouts qui vomissent des monstres gluants sur les trottoirs crevassés, dont elle sait que personne ne viendra les réparer. Elle marche le sac serré contre elle, alerte, sur le qui-vive, le regard aguerri, une peur au ventre qu’elle ne se connaissait pas.
Elle marche comme on avance sur un champ de mines, au cœur de cette ville qui n’est plus que le fantôme d’une ville. Sa ville qu’elle ne reconnaît plus. Elle marche parce que le projet d’une voiture, elle en a abandonné l’idée depuis la crise de carburant, depuis ce jour où, sous ses yeux, deux hommes pleurant de rage ont failli s’étriper pour un crachat d’essence. Le réveil avant l’aube pour ranger l’auto dans une queue formée depuis la veille, pare-chocs contre pare-chocs des heures durant, son véhicule qui se transforme en fournaise, les négociations avec le pompiste pour un peu plus que la limite fixée à 30 000 livres libanaises, juste pour ne pas avoir à répéter le même exercice le lendemain matin ; le regard hagard des enfants collés aux vitres et qui ont déjà compris que leur pays n’en est pas un, les pleurs des mères dont les nerfs lâchent, la furie des pères qui en viennent aux mains, tout ce rituel d’une infamie sans nom, elle a refusé de l’intégrer à son quotidien. « La bahdalé, la dégradation, a des limites. » Pour elle, c’était l’essence. Alors elle marche, Aïda, « jusqu’au jour où ils taxeront nos jambes », dit-elle.
Un monde parallèle
Pourtant souvent, sur le chemin du retour, Aïda s’arrête à l’ombre d’un ficus qui survit par elle ne sait quel miracle. En sueur, fragile et perdue comme un enfant qu’on a envie de prendre dans ses bras, elle se demande pourquoi elle continue de marcher, pourquoi elle se dérange encore pour sortir. « Juste pour l’essentiel ? » Mais l’essentiel, même ça, il y a belle lurette qu’il a disparu de nos distributeurs de billets, nos stations-service, nos pharmacies et nos rachitiques rayons de supermarché. Et puis, de toute façon, les rendez-vous chez le coiffeur, les visites chez les copines, les parties de cartes au club, le restaurant, la boutique de nouveautés au coin de la rue, il y a bien longtemps qu’elle n’en parle même plus. En dessous de chez elle, le temps de retrouver ses forces pour monter les cinq étages jusqu’à son appartement, elle se pose sur un bloc en parpaing oublié ici et elle regarde sa ville et sa vie s’effondrer pièce par pièce. « Comment sommes-nous tombés si bas ? » se demande-t-elle à chaque fois. Aïda regarde la tour qui a poussé juste en face en lui bouchant l’horizon. Ledit bâtiment qu’elle trouve abscons, barricadé de tous bords par des blocs de béton tout aussi abscons, est gardé par une flopée de gardes du corps qui semblent à tout moment prêts à aboyer et mordre. Un ministre y vit. Aïda le sait parce que pour peu que son regard s’attarde sur la tour en question, l’un de ces gaillards en gilet noir et oreillette l’approchera et la sommera d’aller regarder ailleurs, ou pire : « Rentrez chez vous pour ne pas que vous ayez des problèmes. » Aïda le sait aussi, parce qu’il lui arrive souvent de croiser ce ministre ou un membre de sa famille, toujours lâchement claquemurés entre leurs vitres fumées et leurs hommes barbus, armés et en colère. Elle rentre parfois d’une visite à la banque qui lui a fait monter la tension artérielle, d’une course au supermarché qui lui a crevé le cœur, d’une excursion à la pharmacie dont elle est sortie bredouille, et elle assiste à ce spectacle-là, si proche d’elle, un trottoir plus loin, mais semblant provenir d’un monde parallèle.
Son double inversé
Dans la moiteur de son appartement que n’illumine qu’une bougie de fortune aux heures de coupures de courant, elle observe l’appartement du ministre où s’affaire une armée d’employées de maison. Elle le voit affalé sur le cuir reluisant d’un sofa, cigare piqueté aux lèvres, whisky inabordable à la main, à faire défiler des photos de femmes à poil sur son téléphone. À le regarder, on penserait que nous vivons dans le meilleur des mondes, pense-t-elle. Elle voit les œuvres d’art contemporain éclairées, les lustres scintillants, les meubles d’un luxe qui défie l’imagination, les tables qui débordent de quoi nourrir dix familles pour une vie, et l’électricité qui par magie ne s’interrompt jamais. Aïda scrute ses sacs d’emplettes vides de choses dont elle n’a même pas osé s’enquérir du prix, les bijoux terrés au fond d’un tiroir, redoutant le jour où elle devra les vendre et, juste en face, la femme du ministre, son double inversé, dont rien qu’un sac à main équivaut désormais à la somme de ses économies. Le dos élimé sous le poids de la vie, elle la regarde enchaîner le coach de sport, les soirées en robe de bal, les massages à domicile, les restaurants où elle continue à se trimballer même si elle s’y est fait maintes fois lyncher, et puis les valises qui se font et se défont, les voyages sans doute en jet privé. Alors que se paralyse sur son écran l’image de ses enfants qui sont partis trimer ailleurs, loin de ce pays qui les a chassés, Aïda voit les enfants de la tour d’en face rentrer les week-ends de leur école au bord du Léman.
Et là, à court de mots, assise au bord de son matelas affaissé, alors que se joue devant elle la scène la plus nauséabonde qui soit, elle se répète tous les jours : « J’irai faire Tfeh ! sur vos tombes. » C’est tout ce qu’elle a à dire, même si elle ne peut s’empêcher, quand même, naïvement peut-être, de se demander de quoi ils sont fait. Comment font-ils pour ne pas voir ? Pour ne pas voir les larmes des mères et la rage des pères aux stations-service, les poubelles où fouillent des hommes et femmes dignes et désormais si affaiblis, les supermarchés, les pharmacies et les portes d’hôpitaux où se cristallise, chaque jour un peu plus, la bahdalé de tout un peuple? Ou, pire, pour voir tout ça mais continuer tout de même, et coûte que coûte, à se battre pour la nomination d’un « ministre chrétien » ? Quel est leur secret, leur psychose, leur défaut de fabrication? Mais la réponse, Aïda la connaît déjà. Il n’y a qu’une rue entre elle et le ministre, mais c’est toute une humanité qui les sépare.
Chaque semaine, « L’Orient-Le Jour » vous raconte une histoire dont le point de départ est une photo. C’est un peu cela, une photo-roman : à partir de l’image d’un photographe, on imagine un minipan de roman, un conte... de fées ou de sorcières, c’est selon...




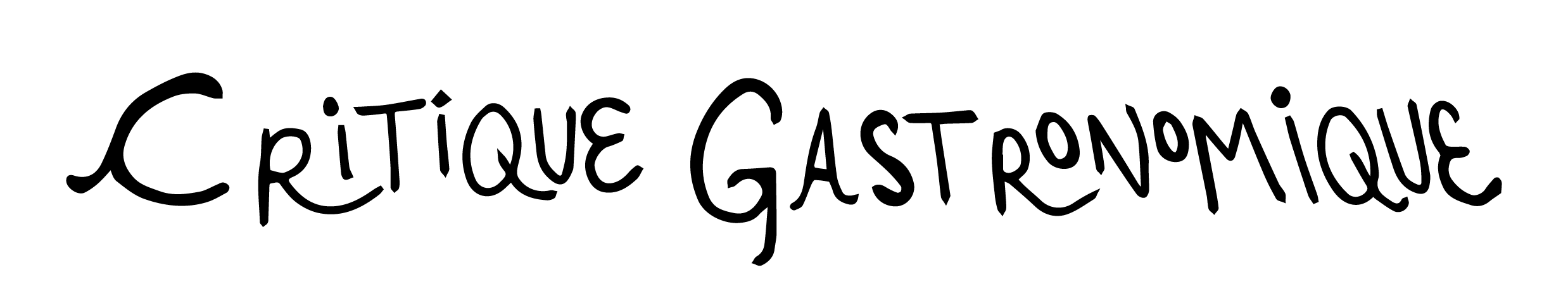
commentaires (9)
Ou est arrive mon beau pays ...???
Eleni Caridopoulou
20 h 44, le 21 juin 2021