
Le président du Parlement libanais, Nabih Berry (à gauche sur la photo), et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, en 2007. Photo d'archives HASSAN IBRAHIM / POOL / AFP
L’insistance du tandem chiite (Hezbollah et Amal) à obtenir le ministère des Finances au sein du prochain gouvernement n’est guère liée à un contexte politique particulier et encore moins à un caprice saisonnier. Il s’agit d’une demande constante qui trouve ses racines dans la frustration historique que ressent une grande partie de la communauté chiite par rapport au rôle qui lui est dévolu dans le cadre des institutions, notamment pour ce qui est des mécanismes du pouvoir exécutif.
Le contexte actuel entourant le processus de formation du gouvernement – l’initiative française et la nouvelle tournure prise par la politique de sanctions américaines – a certes des incidences sur la marche de ce processus, mais il ne commande pas pour autant l’attitude générale des deux formations chiites au sujet de la forme des gouvernements au Liban, et en particulier sur la question de l’attribution du ministère des Finances.
Si on appliquait la Constitution et les règles coutumières de manière rigoureuse – ce qui n’est plus le cas depuis des lustres –, on constaterait que la formation du gouvernement, son investiture par le Parlement à travers le vote de confiance, ses prises de décision et sa chute sont des étapes qui échappent intégralement au contrôle des chiites alors que le contraire est vrai pour ce qui est des chrétiens et des sunnites.
Certes, le pouvoir du président maronite est somme toute devenu marginal, depuis l’adoption de la Constitution issue de l’accord de Taëf (1989), dans le processus de désignation du Premier ministre, le chef de l’État étant censé mener à cette fin des consultations contraignantes auprès des groupes parlementaires, de sorte que le Premier ministre est, au final, désigné par voie de cooptation par les groupes en question. Mais le président se rattrape dans le processus de formation du gouvernement puisque la Constitution l’autorise à refuser son aval aux moutures que lui présente le Premier ministre désigné, ce dernier étant alors appelé à revoir sa copie.
En outre, le poids numérique des députés chrétiens au sein de la Chambre (64 sièges sur 128), même s’ils sont politiquement divisés, fait qu’il est quasiment impossible qu’un gouvernement obtienne la confiance parlementaire si les principaux blocs chrétiens la lui dénient. Cela n’est pas le cas pour à la fois les sunnites et les chiites, dans la mesure où chacune des deux communautés ne dispose que de 27 sièges. Mais si les sunnites sont logés à la même enseigne que les chiites pour ce qui est du vote de confiance, il reste qu’ils disposent de trois leviers déterminants : 1 – Le Premier ministre désigné est habilité par la Constitution à former un gouvernement à son goût, sans tenir compte des résultats de ses consultations avec les groupes parlementaires, étant simplement tenu de recueillir le consentement du chef de l’État ; 2 – C’est lui qui met au point l’ordre du jour des séances du Conseil des ministres, le président de la République ayant de son côté le loisir d’y poser des sujets de discussion, mais hors de l’ordre du jour. 3 – Par sa démission, il met fin à n’importe quel moment à l’existence de son gouvernement, sachant que la démission d’un tiers plus un des ministres entraîne aussi la chute du cabinet. Les chiites ne pouvant former à eux seuls ce tiers plus un, ils n’ont donc théoriquement pas de prise sur une telle décision.
Le cas de 2005-2008
L’exemple le plus notoire sur ce dernier point est celui du retrait des six ministres chiites (Amal et Hezbollah) du premier gouvernement Siniora (2005-2008), essentiellement pour protester contre les efforts du cabinet en vue de la création du Tribunal spécial pour le Liban, pour juger les assassins de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri. À l’époque, la majorité (14 Mars) au pouvoir a considéré, en conformité avec le texte de la Constitution, que le retrait de six ministres (ils n’avaient, de plus, pas formellement démissionné) ne pouvait entraîner la chute d’un gouvernement de 30, le tiers plus un étant dans ce cas égal à 11. De son côté, le tandem chiite, rejoint ultérieurement par le Courant patriotique libre de Michel Aoun, estimait qu’en perdant sa composante chiite, le cabinet n’avait plus de légitimité, le préambule de la Constitution insistant sur les impératifs du vivre-ensemble.
Le malentendu provient en réalité d’un énorme décalage historique entre la philosophie à la base de la Constitution et du pacte national – philosophie renforcée par Taëf – et le contexte local et régional actuel. L’idée de base de tout le système politique libanais repose sur la coexistence globale islamo-chrétienne, devenue paritaire avec la nouvelle Constitution. Rien ne peut être fait au Liban si tous les chrétiens ou tous les musulmans s’y opposent. Cette philosophie correspondait à une fracture politique islamo-chrétienne qui était de mise pendant de longues décennies, mais qui ne l’est clairement plus aujourd’hui. Elle a été remplacée par d’autres fractures, à une échelle plus réduite. Mais à la différence des chrétiens, où le clivage principal (FL/CPL) n’est pas d’ordre sectaire, mais plutôt totalement politique (sauf pour les plaisanteries stupides autour de Pâques), chez les musulmans, la fracture et donc les contours des leaderships politiques coïncident avec les frontières confessionnelles (sunnites-chiites-druzes).
Changement de système ?
Face à cette situation, on comprend que les chiites – et en particulier le Hezbollah – soient demandeurs d’un changement ou d’une évolution du système politique. Une demande que les autres acteurs principaux rejettent jusqu’ici en soulignant, tout à fait légitimement, qu’on ne discute pas d’une nouvelle république avec une partie qui a posé son arsenal sur la table. D’où l’impasse… Que répond alors le tandem chiite ? D’accord, on ne changera pas le système, mais à condition que désormais, on ait toujours des gouvernements d’union ou d’entente nationale, avec si possible, lorsque le camp du 8 Mars est minoritaire à la Chambre, de pouvoir disposer du tiers de blocage au sein du gouvernement et, cerise sur le gâteau, du… ministère des Finances.
Ce statu quo a été consacré par la conférence de Doha, en mai 2008, qui a institutionnalisé, aux dépens de la Constitution et des lois, le principe du consensus-roi.
Il est vrai, cependant, que les chiites n’ont pas réclamé les Finances de manière systématique à chaque fois qu’un gouvernement était formé. Cela dépend en fait de leur évaluation du degré de contrôle qu’ils exercent sur le cabinet en gestation. À l’époque de la tutelle syrienne, ils avaient suffisamment de garanties sur le comportement des gouvernements pour ne pas faire de cette exigence une condition de leur participation. La situation est différente aujourd’hui.
Mais pourquoi spécifiquement le ministère des Finances ? Simplement parce qu’il incarne cette fameuse « quatrième signature ». On sait que les décrets doivent être contresignés par le président de la République, le chef du gouvernement et le ou les ministre(s) concerné(s). Or les Finances est le ministère le plus concerné par la plupart des décrets, dans la mesure où il existe souvent un volet financier dans les actes gouvernementaux.
Cette « quatrième signature » permet donc aux chiites de disposer d’un levier de contrôle (et de blocage) sérieux sur l’action du pouvoir exécutif, que leur dénient la Constitution et les règles coutumières. Du coup, c’est la « répartition par tiers » (chrétien-sunnite-chiite) ou plutôt par quarts (le quart druze) qui s’impose officieusement face à la parité islamo-chrétienne. En attendant de sortir de l’impasse…



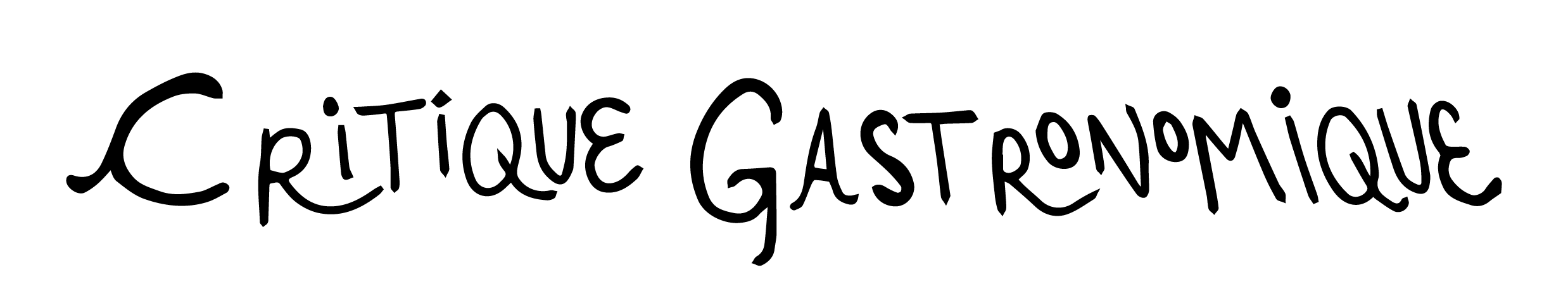
commentaires (32)
Je pense que le tandem CHIITES veut la main mise sur le ministère des finances pour contourner les éventuels blocages de comptes bancaires sur les proches de leurs groupes . B.FADDOUL
Badi Faddoul
20 h 36, le 21 septembre 2020