À l’abri des regards, debout sur une chaise, grande était ma joie, et elle en était ainsi chaque fois que je trouvais une pièce de monnaie de vingt-cinq piastres après avoir fouillé sous les vieux journaux protégeant les étagères du garde-manger, en bois noir, dont les parois étaient garnies de toile métallique à mailles très fines et serrées avec ce qu’on avait coutume d’y renfermer. Ce grand meuble, calé par un petit morceau de bois, nous servait de réfrigérateur pour garder les aliments à l’abri des nuisibles, mais aussi une cachette secrète, pour ma mère, lui servant à planquer les petites pièces de monnaie sous les vieux journaux. Je gardais précieusement la pièce que j’avais trouvée dans la poche unique de ma tenue scolaire beige : elle lui était destinée.
À mon retour de l’école, dans la cour couverte de sable gris cendré et parsemée de petits cailloux, entourée d’un pâté de maisons délabrées en piteux état, où vivaient des migrants ruraux venant du Sud-Liban, des kurdes, des Hauranis de Syrie et d’autres, je l’attendais avec impatience, un cornet de « karabije » (crème meringuée) à la main, acheté avec la pièce de vingt-cinq piastres, au-dessous de l’unique olivier sauvage. Mon enfance et le début de mon adolescence, à Beyrouth, tenaient dans cet espace réduit. En me voyant, elle me regardait en penchant sa tête, voire en rougissant: c’était mes premiers émois, mes premières vibrations et mes premiers échanges. Main dans la main, on finissait le cornet ensemble et on se séparait avec le mot « sipas » (merci). Quand l’argent me faisait défaut, je me contentais de la regarder par la fenêtre de la chambre, au-dessus de la cour, jouer à la marelle. Avec un bâton, elle traçait le schéma au sol. Elle faisait un aller vers la case « ciel » et un retour vers la case « terre » en sautant à cloche-pied de case en case. Je lui faisais un signe de la main en la saluant : « Roj baş, rewş çawa ye? » (« Bonjour, comment vas-tu ? »). En parlant sa langue que j’ai apprise en la fréquentant, je suis devenu la risée de mon entourage. Je découvris qu’elle était différente de moi : Zerya était kurde, et il ne fallait pas parler sa langue.
Mon amour pour Zerya était éphémère et ne dura que ce que durent les fleurs : quelque temps plus tard, le propriétaire du pâté de maisons délabrées décida de le vendre. Les habitants quittèrent le lieu les uns après les autres, à l’exception de mon père, en désaccord avec le propriétaire. Il choisit d’y rester. Après chaque départ, je perdis de vue mes amis. La dernière fut Zerya. La famille se trouva seule dans une chambre unique isolée au milieu d’un îlot d’habitation vidé de ses occupants. Je garde du propriétaire le souvenir d’un homme d’un certain âge, d’un abord désagréable et hargneux, très imposant, obèse, suant en abondance, revêtu toujours d’un vieil habit couvert d’une couche de poussière avec une sacoche porte-outils portée en bandoulière. Il sortait rarement, on ne le voyait que le jour où il devait empocher ses loyers. Parlant fort, le bruit de sa présence nous effrayait. Un jour, une violente dispute verbale éclata entre mon père et le propriétaire à propos du montant de l’indemnité à verser par ce dernier pour libérer la chambre occupée par mes parents. Le propriétaire laissa entendre qu’un bulldozer viendrait démolir les habitations pour la journée du lendemain.
Ce jour-là, à mon retour de l’école, ce fut un grand choc pour moi ; je ne reconnaissais pas le lieu : il avait été démoli, transformé en amas de pierres, de débris et de poussière. Il ne restait que notre chambre au milieu des ruines. L’olivier sauvage était couché: ses racines a vaient résisté au bord tranchant du bulldozer. Le petit chemin menant vers la chambre fut obstrué par les décombres. Sans savoir comment y accéder, je me frayais un passage avec peine, mon cartable d’écolier à la main, à travers l’amas de pierres, de briques et de poutres en avalant la poussière. Le litige dura plusieurs mois, pendant lesquels j’ai vécu parmi les ruines, tourmenté par l’absence de mes amis d’enfance et de Zerya. Le ciel de Beyrouth devenait mon seul refuge, je l’observais les yeux rivés sur des cerfs-volants virevoltant au vent. Le soir, dans la chambre, je voulais me remémorer des ruines en passant mon temps à dessiner les maisons de l’îlot, et les visages de mes camarades et de l’unique olivier dans la cour. Quant à Zerya, je dessinais ses cheveux, ses yeux et sa bouche pour lui parler avec sa langue en réitérant à chaque fois la même question : « To mnt xosh dawet ? » (« Est-ce que tu m’aimes ? »). Ma question est restée lettre morte.
Auteur
Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « courrier » n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de L’Orient-Le Jour. Merci de limiter vos textes à un millier de mots ou environ 6 000 caractères, espace compris.

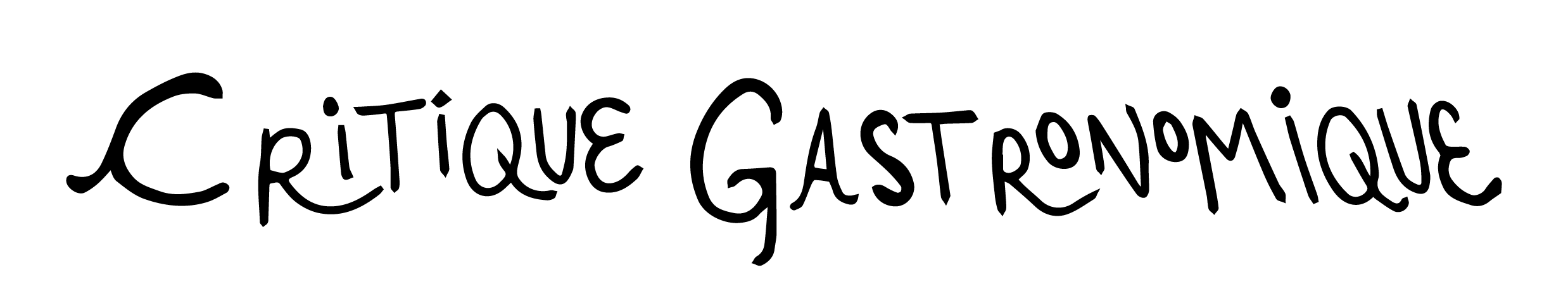
commentaires (0)
Commenter