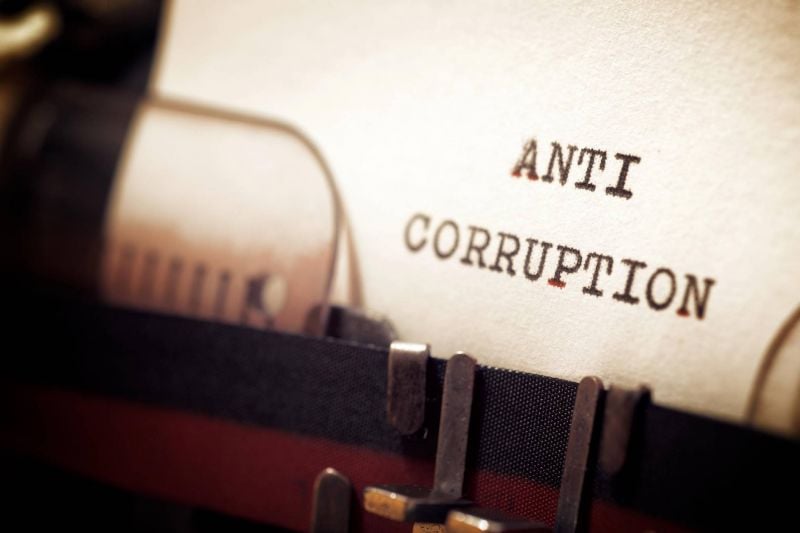
« Mieux vaut tard que jamais », estime Julien Courson, directeur exécutif de Lebanese Transparency Association, tout en déplorant le délai de près de deux ans entre l’entrée en vigueur de la loi et la création effective de la Commission nationale pour la lutte contre la corruption. Illustration : pedrosala/Bigstock
Alors que le Liban est régulièrement classé parmi les pays les plus corrompus du monde dans l’indice de la corruption effectué par Lebanese Transparency, branche libanaise de Transparence International (le Liban occupe la 154e position, en baisse de cinq places, parmi 180 pays dans le dernier rapport publié le 25 janvier dernier, NDLR), la Commission nationale pour la lutte contre la corruption vient enfin de voir le jour, après la signature vendredi du décret de sa formation par le président de la République Michel Aoun. Le Conseil des ministres avait en effet désigné le 24 janvier quatre des six membres qui la composent. Il s’agit de Fawaz Kabbara (un avocat dont le nom figure parmi ceux proposés par les deux ordres des avocats de Beyrouth et Tripoli), Ali Bedrane (un des experts-comptables proposés par le syndicat de ce métier), Joe Maalouf (expert en finances dont la Commission de contrôle des banques a suggéré le nom parmi d’autres),et Kleib Kleib (économiste et sociologue, choisi parmi les noms proposés par la Commission technique chargée du suivi de l’exécution de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption, présidée par la ministre d’État au Développement administratif, Najla Riachi).
 La ministre Najla Riachi. Photo DR
La ministre Najla Riachi. Photo DR
Le corps de la magistrature avait élu les deux autres en juin dernier, en l’occurrence deux juges à la retraite, Claude Karam (président de la commission) et Thérèse Allaoui. Pour que cette instance prévue par une loi promulguée en mai 2020 soit complétée, il aura donc fallu attendre vingt mois, alors qu’elle fait partie des réformes-phares réclamées par la communauté internationale depuis le début de la crise multiforme que subit le pays. Les attentes sont axées désormais sur la capacité de la commission à jouer pleinement son rôle dans l’assainissement du secteur public.
La mise sur pied de la Commission nationale pour la lutte contre la corruption vient couronner une série de lois adoptées au cours des dernières années par le Parlement en vue de contrer une corruption tentaculaire. Cette commission est conçue comme un outil juridique dédié à l’application des lois, notamment celles sur le droit d’accès à l’information (2017), la protection des lanceurs d’alerte (2018), la transparence du secteur des hydrocarbures (2018), l’enrichissement illicite (2020), et les marchés publics (2021). À ce jour, la plupart de ces législations n’ont pas encore été mises en pratique.
Des enquêtes, mais pas de jugements
Jouissant selon la loi d’une indépendance financière et administrative, la nouvelle commission devrait se consacrer à des missions d’investigation liées à la violation des lois précitées. Elle pourra se saisir d’office ou agir sur base de plaintes déposées auprès d’elle par tout citoyen ou organisme de la société civile. Les requêtes doivent néanmoins revêtir « un caractère sérieux et logique », précise une source judiciaire interrogée par L’Orient-Le Jour. Comprendre qu’un plaignant devrait détenir un minimum de documents ou de présomptions permettant de suspecter la personne à qui il veut demander des comptes.
La commission n’est pas une juridiction, c’est-à-dire qu’elle enquête sans rendre de jugements. La décision d’investiguer est prise à la majorité des six membres. Une règle critiquée par la source judiciaire précitée, qui note que l’examen d’un dossier suspect risque de ne pas s’effectuer lorsque les voix se partagent à égalité. La source préconise d’amender la loi pour faire prévaloir, dans un tel cas, la voix du président de la commission.
Au cours de ses investigations, la commission a la latitude de réclamer aux diverses institutions locales et internationales des documents qu’elle juge utiles et ses requêtes sont contraignantes. Une fois les preuves rassemblées, elle saisit le procureur général, le juge d’instruction, ou le juge unique pénal pour l’engagement de poursuites, et assure le suivi des procès.
Sur un autre plan, l’organisme sera chargé de recevoir les déclarations de patrimoine des responsables travaillant dans le secteur public, alors qu’auparavant ces derniers devaient les remettre au Conseil constitutionnel (CC). Selon les prérogatives qui lui étaient accordées, le CC était en mesure d’ouvrir l’enveloppe contenant la déclaration d’un ministre seulement à l’expiration du mandat de ce dernier, tandis que la commission a la possibilité de l’ouvrir à tout moment, en cas de poursuites pour enrichissement illicite ou autres.
Concernant l’accès à l’information, la commission pourra aider un requérant à obtenir des renseignements sur les dépenses publiques en donnant des instructions directes aux ministères et administrations réticents à les fournir.
L’instance a en outre une vocation d’information et d’éducation. Elle est par exemple habilitée à organiser des campagnes auprès des citoyens pour les inciter à dénoncer des actes de corruption et à présenter des requêtes dans ce sillage, ou encore à demander l’inclusion dans les établissements scolaires d’un cours sur la sensibilisation à la prévention de la corruption. Pour plus de transparence, la commission disposera d’un site électronique sur lequel seront diffusées ses données, à l’exclusion de celles concernant la teneur de ses investigations.
Optimisme prudent
Dans les milieux de la société civile, l’annonce de la décision d’activer la commission est accueillie avec « un optimisme prudent », selon les termes de Julien Courson, directeur exécutif de Lebanese Transparency Association. « Mieux vaut tard que jamais », note-t-il, déplorant le délai de près de deux ans entre l’entrée en vigueur de la loi et la création effective de la commission. Un retard que Mohammad Chamseddine, chercheur à l’agence al-Douwaliya lil Maaloumat, attribue au « manque de sérieux de l’État dans sa volonté de combattre la corruption ». M. Courson estime dans le même esprit que l’environnement politico-judiciaire n’aide pas à concrétiser les mesures et sanctions attendues, voulant toutefois croire que le « rôle stratégiquement indépendant de la commission » est de nature à nourrir la confiance. À condition, ajoute-t-il, qu’« il soit bientôt assorti d’une loi sur l’indépendance de la justice ». Sur ce point justement, M. Chamseddine aurait préféré « un renforcement du pouvoir judiciaire plutôt que la création d’un nouvel organisme dont les membres sont nommés sur base communautaire ». M. Chamseddine accorde toutefois le bénéfice du doute à tous les membres, évoquant leur bonne réputation dans leurs milieux professionnels.
Éthique et conscience professionnelle
La ministre Najla Riachi est confiante. « Les six membres ont été choisis sur base de critères de compétence, d’indépendance et d’intégrité, à l’écart de toute considération politique ou clientéliste », assure-t-elle, citant parmi les conditions de candidature celles de n’avoir pas exercé d’activités politiques, ni s’être affilié à un parti durant les cinq dernières années, ni encore de pratiquer un métier pendant les six années de mandat au sein de la commission. Des diplômes d’études de 3e cycle sont en outre exigés ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.
Pour Mme Riachi, le fait que les membres de la commission ne dépendent d’aucune hiérarchie favorise encore plus leur indépendance. « N’étant soumis à aucune autorité, ils ne risquent pas d’être limogés », indique-t-elle, comptant sur « leur éthique et leur conscience professionnelle ».
Pour ce qui a trait au financement de la commission, Mme Riachi affirme qu’un budget de 10 milliards de livres avait été prévu dans la loi de 2020, reconnaissant cependant que ce montant a été sérieusement amputé par la dévaluation de la monnaie nationale. Elle assure qu’en tout état de cause, « on attend une aide des partenaires internationaux, d’autant que le Liban est membre de la Convention des Nations unies contre la corruption ». Le PNUD et d’autres organisations onusiennes ont ainsi promis d’apporter leur soutien notamment pour la location du siège, l’installation de matériel technique et électronique, et la formation des équipes administratives.


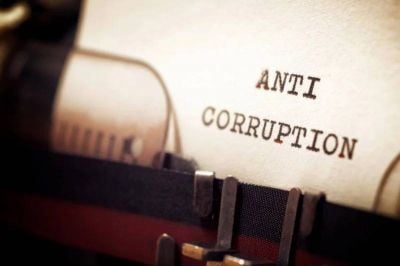
commentaires (10)
Votre censure permanente de mes commentaires est une honte. Quand d’un autre côté vous vous permettez de publier des commentaires anonymes! Pas de soucis. Continuez à censurer. C’est tout à votre honneur. Je saurai quoi faire quand vous appellerez la prochaine fois pour demander d’aider le journal…
Nagi SCHOUCAIR
07 h 52, le 03 février 2022