
Jonathan Glazer récompensé de l’oscar du meilleur film étranger. Photo AFP
Avant l’oscar du meilleur film étranger, The Zone of Interest avait déjà été récompensé du Grand Prix du Festival de Cannes. Ce film britannico-polonais prend le parti de raconter la réalité concentrationnaire sans jamais la montrer. Une réflexion sur la banalité du mal qui entre en résonance avec l’actualité au Proche-Orient.
Hors champ
Rudolph et Hedwig Höss mènent une vie parfaitement ordinaire : ils ont une jolie maison, ils jardinent, ils pique-niquent avec leurs enfants, ils vont se baigner dans la rivière, ils reçoivent des amis avec lesquels ils discutent de tout et de rien. Une famille normale, à ceci près que le jardin se termine sur un mur derrière lequel bourdonne l’immense camp d’extermination d’Auschwitz dont Rudolph est commandant.
Ce camp, Glazer ne le montre pas. Il est laissé hors champ, mais sa réalité glaçante est omniprésente : de la fumée noire qui vient teinter le ciel par-dessus le gazon verdoyant aux bruits étouffants qui s’échappent de l’autre côté du mur. On ne voit pas, mais on entend. La rumeur sonore envahit le jardin idyllique des Höss. Des plans fixes sur leurs fleurs éclatantes – fertilisées par les cendres des victimes – se heurtent au ronflement des trains et aux cris d’agonie.
 « The Zone of Interest » se confronte à la réalité concentrationnaire en suivant le parti pris lanzmanien de ne jamais montrer l’horreur directement et résister à toute esthétisation. Capture d'écran YouTube
« The Zone of Interest » se confronte à la réalité concentrationnaire en suivant le parti pris lanzmanien de ne jamais montrer l’horreur directement et résister à toute esthétisation. Capture d'écran YouTube
Voir ou ne pas voir
Pas de poésie après Auschwitz. Jonathan Glazer suit le précepte d’Adorno, au cœur du débat moral sur la représentation de la Shoah qui travaille le cinéma depuis plus de soixante ans. La Zone d’intérêt se confronte à la réalité concentrationnaire en suivant le parti pris lanzmanien de ne jamais montrer directement l’horreur et résister à toute esthétisation : les lumières sont naturelles et le jeu très sobre.
Toute l’abomination s’exprime à travers la « banalité du mal » de ce petit cadre exécutant qui a pourtant activement participé à des meurtres de masse. Höss est un bureaucrate, il discute en réunion de la manière la plus efficiente de brûler le « chargement » des trains, lance la construction d’un nouveau crématorium au téléphone comme n’importe quel commercial. Cette absence d’affect s’appuie sur une déshumanisation complète des juifs spoliés, dont sa femme Hedwig récupère les manteaux en fourrure. Dans le jardin, elle discute avec sa mère d’une dame qu’elles connaissaient, aujourd’hui probablement de l’autre côté du mur. La mère raconte qu’elle a essayé sans succès de récupérer ses rideaux aux enchères lorsqu’elle a été déportée. Le propos est dénué d’émotion. Sauf peut-être pour les rideaux.
L’autre n’existe plus, rendu invisible par une cloison aliénante. « J’ai voulu faire quelque chose principalement sur le mur qui séparait le camp du jardin, de l’idéal qu’ils se sont construit, littéralement sur les os des victimes. (…) Ce mur est devenu l’expression de quelque chose que l’on se dit pour compartimenter les choses pour notre propre commodité », a exposé Jonathan Glazer lors d’une conférence de presse à Cannes, insistant sur la capacité de cécité de ses personnages qui ne voient jamais les victimes, enfermées dans des camps de l’autre côté des barbelés.
Un projet eugéniste et colonial
Une des forces du film de Glazer est de montrer en quoi le nazisme n’est pas juste une affaire individualiste, mais s’inscrit dans un projet colonial eugéniste sous-tendu par des enjeux politiques et économiques. Des usines se déplacent dans cette région où la main-d’œuvre est devenue gratuite. « Tout ça, c’est à nous (…) il y a trois ans, ce n’était qu’un champ », triomphe Hedwig en montrant à sa mère son jardin bien taillé au pied d’un grand mur sur lequel elle a fait pousser une vigne supposée le cacher. Dans la lettre à Hitler écrite en sa faveur, Höss est décrit comme « un colon exemplaire et un pionnier de la conquête de l’Est ». Et lorsqu’il annonce à sa femme qu’ils doivent quitter la maison, elle lui rétorque qu’ils vivent pourtant exactement comme le Führer l’a ordonné : ils sont partis à l’Est, dans leur espace vital. Le mot « lebensraum » est plusieurs fois répété. Pour se réconcilier, le couple rêve aux terres qu’ils pourront exploiter après la fin de la guerre : celles de Pologne, mais aussi celles de Hongrie où la déportation des juifs commence.
Avant, pendant ou après l’Holocauste
Dans son discours de remerciements aux Bafta où La Zone d’intérêt a reçu trois prix – meilleur film britannique, meilleur film en langue étrangère et meilleur son –, le producteur James Wilson est revenu sur ces murs que l’on construit « pour ne pas avoir à regarder de l’autre côté » et qui ne datent pas « d’avant, pendant ou après l’Holocauste ». Sous une salve d’applaudissements, il a déclaré qu’il lui semble « frappant aujourd’hui que nous devons nous préoccuper des personnes innocentes tuées à Gaza ou au Yémen de la même manière avec laquelle nous pensons aux personnes innocentes tuées à Marioupol ou en Israël ». Le réalisateur Jonathan Glazer a, lui, déclaré dans son discours aux Oscars que ce film « montre comment la déshumanisation mène au pire. Cela a façonné tout notre passé et notre présent. (…) nous sommes ici en tant qu’hommes qui réfutent le fait que la judéité et l’Holocauste soient détournés par une occupation qui a conduit à des conflits pour tant d’innocents, qu’il s’agisse des victimes du 7 octobre en Israël ou de l’attaque en cours sur Gaza. Comment pouvons-nous résister ? »
S’il semble évident, ce parallèle avec l’actualité n’en est pas moins sensible. Pour preuve, la récente polémique autour de la déprogrammation de la projection du film organisée par le collectif juif décolonial Tsedek! Fondé en juin 2023, ce mouvement, qui lutte contre toute forme d’antisémitisme et de racisme, est particulièrement actif dans le combat pour la fin de l’apartheid et de l’occupation en Israël-Palestine. Au cours du mois précédent, Tsedek! a voulu programmer deux fois La Zone d’intérêt dans son ciné-club, mais les séances ont été annulées en raison de leurs positions jugées trop propalestiniennes, d’abord sur décision de Dulac Cinémas puis suite au désistement de l’intervenant Johann Chapoutot, historien de la Shoah, la veille de l’événement. Le cinéma parisien Grand-Action ne souhaitait pas que la seule intervenante soit Sadia Agsous-Bienstein, spécialiste des cultures arabe et hébraïque. Une décision désolante pour Samuel Leter, le militant de Tsedek! qui devait animer le débat: « Les recherches de Sadia ont pourtant été financées par le mémorial de la Shoah… Mais étant donné qu’elle parle aussi de sujets liés à la population arabe, et notamment la Nakba, on nous a dit que ça allait être trop politisé. Son travail encourage un dialogue entre des personnes juives et arabes, c’est ce qu’on essaye de faire avec Tsedek! Empêcher Sadia de parler renforce l’hostilité. »



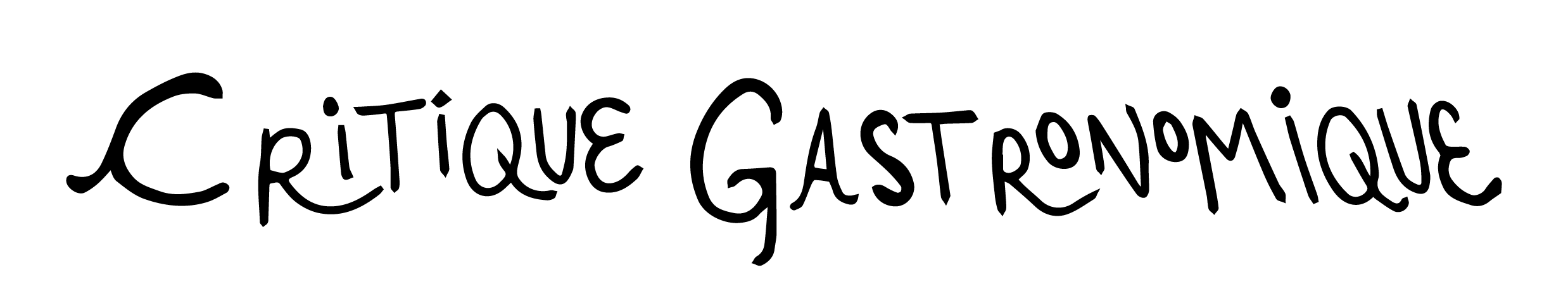
commentaires (1)
N'est-ce pas ainsi que vivent les Israéliens à deux pas de Gaza?
Politiquement incorrect(e)
14 h 57, le 13 mars 2024