
La réalisatrice libanaise Myriam el-Hajj. Photo DR
Georges Moufarrej, Joumana Haddad et Perla-Joe Maalouli. C’est à travers trois personnages et trois générations que Myriam el-Hajj a filmé le Liban de 2018 à 2022. Diaries from Lebanon interroge l’existence et l’espoir dans un pays sclérosé où le présent piétine ; malgré des évènements (re)fondateurs.
Votre premier long-métrage, « Trêve », remonte aux origines de la violence de la guerre civile. « Diaries from Lebanon » semble s’inscrire dans le prolongement de ce film : le passé qui ne passe pas semble empêcher le futur d’advenir. Comment est né ce projet qui questionne le devenir du Liban dans une démarche davantage politique ?
Diaries from Lebanon est né de Trêve. Je viens d’une famille de combattants, mes oncles ont pris les armes, j’ai grandi avec ces hommes-là. Je les ai beaucoup interrogés dans Trêve, mais des choses me dépassaient encore parce que cette histoire n’a pas été écrite et que chacun se l’approprie comme il veut. Le personnage de Georges dans Diaries from lebanon est dans la continuité de ces interrogations. Je n’avais pas pour autant envie de faire un second Trêve : c’est toujours un risque de vouloir faire un second film pour corriger le premier. Et en même temps, des choses bougeant dans le présent, j’ai voulu questionner la société dans laquelle je vis et cette nouvelle génération qui vient défier l’ancienne.
 Perla Joe Maalouli dans « Diaries from Lebanon ». Photo DR
Perla Joe Maalouli dans « Diaries from Lebanon ». Photo DR
C’est là qu’arrive la révolution, que vous avez filmée dès ses premiers instants.
Il m’a paru essentiel de raconter ce qui nous arrivait. Aujourd’hui, nous manquons d’images. Beaucoup de gens ont filmé, mais n’en ont pas forcément fait des films, c’était souvent pour des associations ou des reportages. Le résultat, c’est que ce sont les politiciens qui détiennent le narratif de ce qu’on a vécu. Alors, il est nécessaire que notre point de vue puisse exister, et c’est là que l’on gagne quelque chose.
À travers trois personnages, vous racontez les évènements récents du Liban, mais aussi trois rapports très différents à l’action politique et sociale, comment les avez-vous choisis ?
J’ai rencontré Georges Moufarrej avec un ami, Marwan Chahine, qui écrit un livre sur le début de la guerre civile. J’étais très intriguée par cet homme qui a encore beaucoup de rage en lui, mais qui est très isolé. Comme dans Trêve, il s’agit de personnages qui sont plus gris que noirs ou blancs. Ils ont une grande responsabilité dans ce qu’il s’est passé, mais ils n’ont rien gagné, ni économiquement ni socialement, et vivent aujourd’hui marginalisés. Georges est arrivé dans le récit, car je n’avais pas fini de parler de cette période qui pèse encore tellement sur le présent. Mais on était en 2018 et je sentais un air de changement arriver. J’ai pris ma caméra pour filmer une nouvelle génération qui se présentait aux élections législatives. Joumana Haddad en faisait partie. C’est ensuite chez Joumana que j’ai rencontré Perla-Joe Maalouli dans une assemblée avec des jeunes. Elle était pleine de rage et j’ai reconnu chez elle une blessure que je partage. Elle m’a émue. Je l’ai perdue de vue et ce n’est que quand la révolution a éclaté que je l’ai recroisée dans la rue. Son corps avait évolué, elle explosait, sa voix arrivait à crier, à se libérer. Je ne me suis jamais dit « Je veux un personnage qui habite ici, une autre qui fait ça… » Un personnage tend la main à l’autre : c’est le film qui a choisi les personnages et eux qui sont entrés dans le film.
Aviez-vous dès le départ prévu une temporalité aussi élargie ou s’est-elle imposée avec les évènements imprévisibles du Liban ?
Je n’avais au début pas du tout idée de cette temporalité. C’était un film sur Georges et Joumana, je ne savais pas que la révolution allait éclater ni que Perla-Joe allait entrer dans le film. Bien sûr, quand la thaoura a commencé, je me suis dit que ça allait en être l’aboutissement : on n’a pas gagné avec les élections, mais on va gagner dans la rue. Mais après l’explosion (du 4 août 2020), je n’y croyais plus, je ne voulais pas continuer. Moi-même j’étais dedans et j’étais traumatisée, alors comment faire un film ? C’est Joumana qui m’a appelée en me disant : « Viens, il faut qu’on raconte tout ça. » Le film s’est fait aussi par les personnages. Et c’est ça, la beauté : le film, à un moment donné, ne nous appartient plus. Je ne fais plus un film sur eux mais avec eux. J’ai alors repris la caméra pour tourner.
 Parmi les questions que soulève le documentaire de Hajj, celle de « comment se reconstruire après le désastre et comment le filmer ». Photo DR
Parmi les questions que soulève le documentaire de Hajj, celle de « comment se reconstruire après le désastre et comment le filmer ». Photo DR
Les scènes autour de l’explosion au port sont filmées de manière peu frontale, elles s’intéressent à autre chose que la catastrophe directe. Pour vous, pourquoi et comment filmer le désastre ?
Je n’avais pas envie de filmer une ville détruite. Je n’arrivais pas à filmer quelque chose qui m’affectait autant. Et je voulais rester fidèle à mon point de vue : je n’ai pas vu l’explosion, j’étais dans un sous-sol. Alors j’ai voulu raconter la manière dont l’ont vécue mes personnages, mais aussi tous ces hommes et ces femmes qui ont perdu des gens et qui ont été très seuls. Je les ai filmés chaque quatre du mois, et de plus en plus la foule se réduisait, c’était écœurant. La rage a changé de camp. Au lieu que ce soit la rage des jeunes dans la rue, c’est devenu la rage de ces mères et ces pères qui n’ont pas obtenu justice. J’ai senti que mon angle après l’explosion devait être d’aller voir comment on peut se reconstruire après ça, après que tous nos rêves ont été détruits, après avoir lutté des années pour ce pays. On rebondit avec ce qu’on sait faire pour ne pas mourir. C’est par défaut qu’on rebondit, pas parce qu’on est fort. C’est un moment du film où j’ai voulu ne pas avoir peur de l’émotion parce que c’est comme ça que je l’ai vécu.
Le film se termine finalement sur une note d’espoir avec Perla-Joe qui réussit à faire un concert malgré des obstacles matériels et humains. Conservez-vous une part d’optimisme ?
Oui parce que, si on n’y croit pas, on se tire une balle ! Je pense qu’on est passé à côté d’un très grand moment qui ne reviendra pas tout de suite ou peut-être pas du tout. Peut-être que le changement ne se fera plus dans la rue, mais à travers la politique – ça, c’était le rêve de Joumana. Quoi qu’il en soit, je garde espoir, et c’est pour ça que j’ai fini avec Perla-Joe qui chante. Parce qu’elle reste dans l’action, même si, à un moment donné, elle s’est remise en question et a commencé à se retirer. Malgré ses doutes, un an après l’explosion, elle chante sa chanson et la rage est encore là. Tant qu’il y a de la rage, le changement est possible.
 L'équipe du film documentaire « Diaries from Lebanon » a accompagné la projection à la berlinale. Photo DR
L'équipe du film documentaire « Diaries from Lebanon » a accompagné la projection à la berlinale. Photo DR
Il y a eu beaucoup de critiques des positions de la Berlinale sur la Palestine, que répondez-vous à ceux qui reprochent aux cinéastes d’y avoir participé, alors que cette première internationale est aussi ce qui permettra au film d’être mieux protégé au Liban et peut-être d’éviter la censure ?
Il y a plein de manières différentes de résister à la violence d’Israël. À mon avis, il n’y en a pas de bonne ou de mauvaise. Ma façon à moi, c’est le cinéma, c’est ce que je sais faire. Je pense que le projet d’Israël est non seulement de nous effacer physiquement mais aussi culturellement. C’est pour cela qu’il était important pour moi de participer. Si je reste à la maison avec mon film, ça ne changera rien au monde, le festival continuera et l’Histoire ne se souviendra pas que je n’y suis pas allée, surtout que je ne m’appelle pas Scorsese ! Au contraire, je pense qu’il faut montrer ce qu’on raconte, surtout que mon film parle aussi de ça, que je nomme des choses. Là-bas, on a pu s’adresser à des salles de plus de 500 personnes en leur disant qu’en ce moment même Israël était en train de bombarder le Liban. On était 19 personnes de l’équipe sur scène, à s’adresser à des gens qui ne sont pas tous dans notre camp pour les convaincre sur la nécessité d’agir. Il faut prendre cela comme une plateforme de débats. Je suis contente d’avoir été dans un festival avec un film aussi politique.



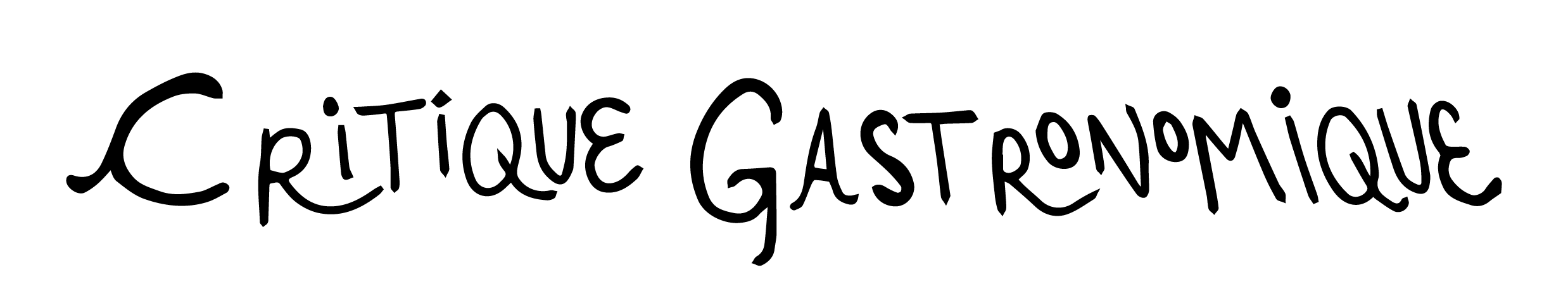
commentaires (0)
Commenter