« Nous sommes tous des réfugiés », peut-on lire sur ce drapeau brandi par des manifestants à Beyrouth, le 18 juillet 2016, pour protester contre le couvre-feu imposé aux réfugiés syriens dans certaines localités. Joseph Eid/AFP
Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, où l’État libanais n’était pas tout à fait la fameuse mosaïque haute en couleur de confessions et de communautés qui ne cesse d’émerveiller certains. Le premier Parlement libanais (1922-1924) comprenait ainsi quatre communautés dites chrétiennes et trois dites musulmanes (contre respectivement sept et quatre pour la législature élue en juin dernier).
En ces temps où la controverse sur les questions relatives aux réfugiés s’entremêle à celle relative au principe même de l’acquisition de la nationalité libanaise et ses modalités, sur fond d’enjeux régionaux, il peut être sensé de se remémorer les termes d’un débat qui eut lieu en 1926. Sous la coupole du Parlement libanais alors fraîchement installé, ce débat, en amont des élections municipales, porta principalement sur la base sur laquelle les « réfugiés » en provenance de plusieurs régions détachées de l’ancien Empire ottoman ont été recensés et incorporés au collège électoral libanais.
Une fois admis, à contrecœur par certains parlementaires, que ces réfugiés sont devenus libanais « par le fait que les nations qui peuvent accorder les nationalités leur ont accordé notre nationalité » (Chibl Dannous), il restait à savoir comment compter, au sens propre comme au figuré, les réfugiés ayant acquis la nationalité en vertu du traité de Lausanne (1923) au nombre des « vieux Libanais » (sic) : sur la base de leur appartenance géographique antérieure à leur implantation ou sur celle de leur appartenance communautaire ? Réponse : « Ils ont été recensés selon leur appartenance communautaire. C’est-à-dire qu’ils forment dorénavant de nouvelles communautés… De même que ce pays abrite des grecs-orthodoxes, il abrite aujourd’hui des arméniens-orthodoxes. Si le gouvernement a fait ce choix, c’est pour éviter (que les réfugiés naturalisés) ne s’accaparent des sièges (municipaux) réservés aux Libanais de souche », expliquait le commissaire du gouvernement Sélim Takla lors de la séance du 6 mai 1926.
(Lire aussi : Décret de naturalisation : après le PSP, les FL présentent un recours en invalidation)
Leçons du passé
La référence à ce débat parlementaire presque aussi vieux que l’État libanais pourrait paraître, au regard de la brutalité des controverses en cours, saugrenue, même hors contexte. Cependant, les termes majeurs de certaines des controverses auxquelles nous assistons sont, volens nolens, les mêmes : comment admettre de nouveaux membres au cercle des Libanais sans empiéter, ou en donner l’impression, sur les « droits acquis » des uns et des autres, ni froisser leur amour-propre communautaire ?
Le Liban ayant fait en 1936 son plein, pour ainsi dire, de communautés et de confessions, il est tout à fait compréhensible que l’admission de nouveaux membres au cercle ne peut se calculer, arithmétiquement et politiquement, qu’en termes (de déséquilibres) démographiques. Les émois que le décret 5247 de naturalisation de masse de 1994 de plusieurs centaines de milliers de personnes a suscités et continue de susciter en offre l’illustration la plus patente.
Dès lors, deux leçons méritent d’être tirées du débat de 1926 et du décret de 1994. La première, et la plus évidente, est que l’admission de nouveaux membres au cercle ne s’est jamais faite au bon gré de tous les Libanais ni dans des conditions pacifiques : les musulmans n’ont pas vu d’un bon œil la naturalisation des vagues de réfugiés chrétiens à la sortie de la Première Guerre mondiale, tandis que ces derniers n’ont pas reçu à bras ouverts la naturalisation en 1994 des sunnites du Wadi Khaled et des chiites des « sept villages » qui, ayant été privés au cours de longues décennies de la nationalité libanaise sous prétexte de ne pas remettre en cause l’équilibre démographique, ont vécu au Liban comme des réfugiés ou presque !
La seconde, et probablement la moins bienvenue, est que le Liban, à la faveur de ces deux grandes vagues de naturalisations, n’en est pas devenu moins libanais que lors de son indépendance, même s’il a subi les conséquences logiques que des migrations ou des assimilations massives peuvent provoquer. Une leçon naturellement difficile à admettre par ceux qui s’accrochent, par candeur ou par calcul, à croire que ce pays est doté, par on ne sait quelle grâce ou providence, d’une composition immuable destinée à remplir un dessein cosmique. Leur résistance pourra prendre toute sorte de forme pacifique ou belliqueuse : au final, ils n’auront d’autre choix que de composer avec le fait accompli !
(Lire aussi : Parmi les naturalisés libanais, Farid Bedjaoui, le "Monsieur trois pour cent" algérien)
Chimérique « droit au retour »
S’il est trop tôt, et même séditieux, de mettre l’exode syrien au Liban – ou, dans les meilleurs scénarios, ce qui s’assimilerait un jour aux résidus démographiques de cet exil – à l’épreuve des deux précédents historiques évoqués plus haut, ce n’est pas le cas avec les résidus démographiques de l’exil palestinien, chiffrés à moins de 200 000 âmes selon le recensement annoncé en grande pompe au Grand Sérail en décembre dernier.
Quels que soient les paramètres, ces « Palestiniens » appartenant largement aux deuxième, troisième et quatrième générations sont voués à demeurer au Liban – sans parler de leur libanisation de facto ! S’accrocher au chimérique « droit au retour », ou marteler ad nauseam le neuvième alinéa du préambule de la Constitution – qui bannit tout partage du territoire libanais et l’« implantation » (« tawtin ») de non-Libanais –, ne changera rien.
Au cours des dernières élections parlementaires, une réfugiée palestinienne, au fait des nuances libanaises, a présenté, par la voie des réseaux sociaux, sa candidature au « siège palestinien dans la troisième circonscription de Beyrouth ». Bien sûr, ni ce siège ni la circonscription n’existent. Ne faudrait-il pas considérer cette candidature virtuelle comme une idée digne de considération plutôt qu’une farce ?
Destinée à toujours être revue à la hausse, la mosaïque libanaise, en état de saturation confessionnelle et communautaire, gagnerait probablement en équilibre et en stabilité à être enrichie par d’autres formes de collectivité… Le processus de complexification de cette mosaïque, via l’intégration politique ou sociale de nouveaux venus, n’est pas un don de la nature ou de l’histoire, mais « nous » revient de droit. C’est donc à nous, héritiers enchantés ou désolés de ce Liban, de la « corriger » au besoin. Sauf à douter du potentiel d’assimilation du Liban en tant qu’expérience humaine en cours de route, vivement le « tawtin » !
Cette tribune reprend quelques idées développées dans l’étude « Lebanon 2017/2018 – Fewer Refugees, More Refugeeism » réalisée par Monika Borgmann et Lokman Slim et publiée par UMAM D&R Documentation and Research grâce au soutien de l’Institut allemand des affaires culturelles extérieures (IFA).
Lokman Slim est essayiste et réalisateur.
Lire aussi
Quand le Liban naturalisait, d’un seul décret, des dizaines de milliers de personnes

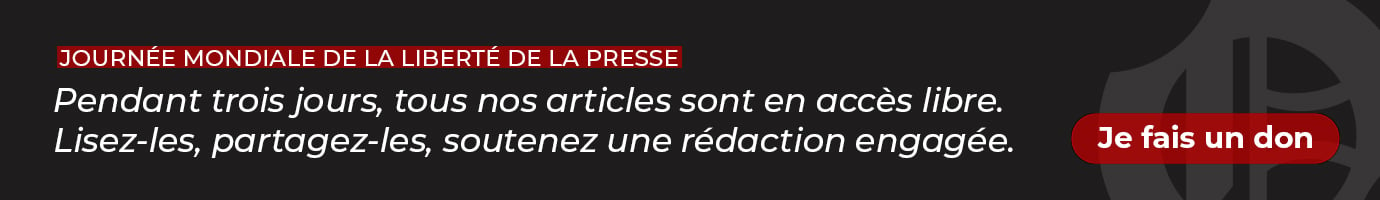
commentaires (8)
Moi je suis libanaise d'origine grecque en 1956 j'ai opté pour la nationalité libanaise et j'ai laissé tombé la grecque , j'aime le Liban c'est mon pays et je souffre de la situation , j'habite l'Italie et j'aide autant que possible par l'intermédiaire de l'église catholique ??????
Eleni Caridopoulou
17 h 16, le 04 février 2021