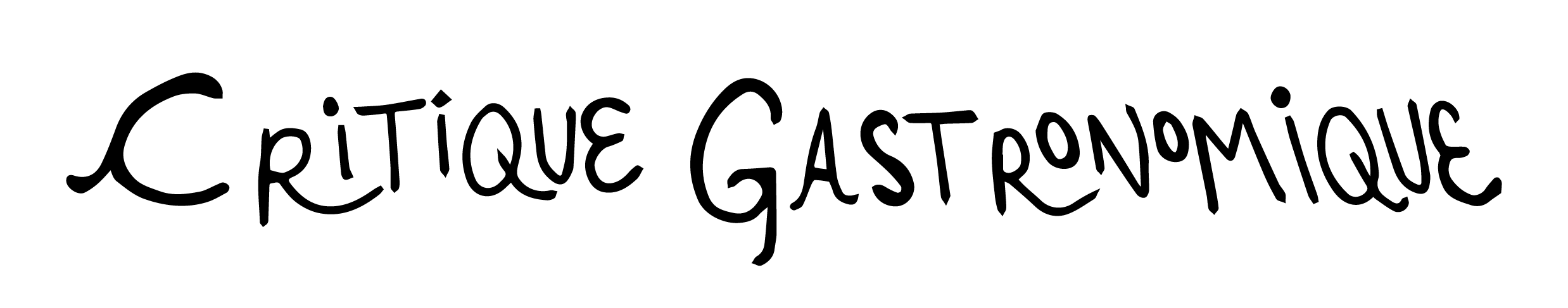Anthony Farah est né en 1948 en Afrique du Sud, à Johannesburg, de deux parents libanais. « Mes parents sont du Nord, précise-t-il. Ma mère était une cheikha de la famille Daher, et mon père originaire de Sebaal. »
À Johannesburg où il a vécu toute sa vie, Anthony Farah étudie le génie électronique, s’essaye à plusieurs emplois puis décide de lancer en 1977 sa propre compagnie, Spescom Group, dans le domaine de la technologie. Et c’est à partir de là que l’aventure commence et que le succès est au rendez-vous.
« J’ai commencé avec trois fois rien, quelques milliers de rands (la monnaie locale en Afrique du Sud), raconte l’homme d’affaires. J’ai développé ma société peu à peu dans le domaine de la technologie et en 1987, je l’ai introduite en Bourse. Auparavant en 1982, j’avais créé une entreprise en Californie que j’ai vendue en 1990, alors que l’Afrique du Sud était en plein apartheid et qu’il était difficile de travailler avec les États-Unis. »
La compagnie fondée par Anthony Farah a mis sur le marché plusieurs services qui ont laissé leurs marques, comme dans le domaine de la communication, avec les « call centers » (la société était n° 1 en Afrique du Sud dans ce secteur). Certains de ces services étaient des premières mondiales, comme l’électricité prépayée, qui a été d’une grande utilité en Afrique du Sud, un pays qui souffrait du problème des factures impayées. « Ce service a connu un très grand succès, précise-t-il. Tant et si bien que Siemens a mis en place une joint venture avec nous, introduisant cette technologie dans plus de 60 pays à travers le monde. C’est une technologie fantastique : les mauvaises dettes disparaissent rapidement. »
Des factures d’électricité impayées ? N’est-ce pas un problème que nous connaissons bien au Liban ? A-t-il jamais pensé à y introduire cette technologie ? « J’ai essayé, répond-il. Ça aurait été le pays idéal pour y mettre en place une telle technologie. Mais le concept s’est avéré trop difficile à appliquer, et notre tentative est restée sans lendemain. »
Spescom a également développé un produit pour British Telecom et signé un contrat pour environ 200 millions de livres sterling, en battant de prestigieux concurrents. La compagnie a été par ailleurs qualifiée de « Technology Pioneer » au Forum économique de Davos de 1998 à 1999, la seule entreprise d’Afrique du Sud à avoir eu ce privilège.
Aujourd’hui, après trente ans de carrière dans ce domaine, Anthony Farah a décidé de quitter la direction de la société tout en y restant grand actionnaire. Il veut, selon ses propres termes, passer à autre chose après toutes ces années. Il se déclare très intéressé par les entrepreneurs, précisant que l’une de ses spécialités est de lancer de nouvelles entreprises. « Ce que j’aimerais faire dorénavant, c’est identifier les personnes très compétentes dans leur domaine et connaissant bien leur clientèle, dit-il. Je leur propose alors de créer leur propre société, les aide à se lancer et prélève un pourcentage sur leur business. En clair, j’investis dans la personne. » Cette nouvelle aventure ne sera pas seulement tentée en Afrique, mais également en Europe et aux États-Unis, tout comme Spescom s’était développée sur trois continents.
Une grande communauté à Johannesburg
Anthony Farah est père de cinq enfants, trois garçons et deux filles, dont les âges varient de 22 ans à 33 ans. Divorcé depuis près de douze ans, il possède une demeure à Johannesburg et une autre au Cap où il aime passer une grande partie de son temps, « l’un des endroits les plus beaux du monde », comme il le décrit.
Étant né en Afrique du Sud, Anthony Farah se considère en premier lieu comme un citoyen de ce pays. Alors que signifient pour lui ses origines libanaises ? « Je suis fier de mon héritage, dit-il. La communauté libanaise a su se distinguer en Afrique du Sud, et a développé sa propre personnalité. Les Libanais sud-africains ne ressemblent pas nécessairement aux Libanais du Liban. »
Qu’est-ce qui le lie encore au pays de ses ancêtres ? « Des liens personnels, répond-il. C’est surtout la famille. J’ai une famille très nombreuse, surtout du côté maternel, et je suis très fier d’eux. J’aime venir les voir, j’aime que mes propres enfants connaissent le Liban, et je trouve que c’est un pays très agréable. Ce pays est une énigme, mais il est fantastique, avec beaucoup de potentiel. »
Contrairement à la majorité des émigrés nés dans leurs pays d’adoption, Anthony Farah s’exprime sans problème en arabe libanais, ses parents ayant pris soin de lui inculquer leur langue maternelle, même s’il avoue n’avoir jamais appris à lire et écrire l’arabe littéraire.
L’homme d’affaires affirme sur un autre plan avoir cherché à établir des liens professionnels avec les fils de son pays. Il a même fondé une Chambre de commerce libano-sud-africaine depuis quelques années, mais sans grand succès parce que, comme il le dit lui-même, « il n’y avait pas un grand intérêt du côté libanais ». « C’est dommage parce que nous avons en Afrique du Sud la plus grande communauté issue du Moyen-Orient, près de 20 000 personnes, déplore-t-il. La présence libanaise ici remonte à 110 ans. »
« La Suisse de l’Orient »
Concernant l’actualité politique locale, Anthony Farah affirme la suivre « raisonnablement bien ». « J’ai mes idées là-dessus, dit-il. Certains membres de ma famille sont entrés en politique. Mais en gros, je pense que c’est très triste. Les Libanais ne savent pas fonctionner en équipe, chacun veut être leader et c’est dommage. »
Pour lui, la comparaison avec l’Afrique du Sud fait ressortir les lacunes du Liban. « Nous avons nos problèmes, bien sûr, mais ce qui s’est passé là-bas s’apparente à un véritable miracle politique, explique-t-il. Nous avions un régime complètement différent, avec une minorité blanche au pouvoir, et l’immense majorité de Noirs n’avait même pas droit à la parole. Ils ne pouvaient pas être propriétaires, ne pouvaient pas vivre là où ils voulaient, être ce qu’ils voulaient… Les Blancs avaient peur de donner plus de liberté aux Noirs et de se voir anéantis. Mais un beau jour, ils se sont rendu compte que ça ne pouvait plus marcher et que le système était mauvais. Il y a eu alors une conscience de la nécessité du changement, renforcée par la présence de grands leaders comme Nelson Mandela. Malgré tous les conflits, quand ce dernier a pris le pouvoir, il a agi humblement et réconcilié tout le monde… sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré. Nous avons fini par avoir une démocratie humaniste. Les mêmes personnes, la même classe politique, ont initié un changement radical. »
C’est l’histoire de son pays qui le rend aujourd’hui critique, voire amer, concernant le Liban. « Bien que les Libanais soient très éduqués, ils ne s’entendent jamais sur rien, souligne-t-il. Ce n’est pas un manque de leadership ni de visions. Je crois qu’historiquement, le problème est lié à la hiérarchie des classes, ce que nous n’avons pas. Le confessionnalisme est, d’un autre côté, à la source de tous les troubles. Sans vouloir manquer de respect à quiconque, pour moi, la religion est une affaire privée, et ne devrait pas être l’affaire du gouvernement ni un prétexte de se retrouver dans la rue. Il est possible de s’unir en tant que Libanais, tout en restant attaché, chacun, à sa religion. » Ne pense-t-il pas qu’un tel comportement se justifie étant donné les craintes des minorités religieuses dans la région ? « Mais c’est exactement ce dont les Blancs avaient peur en Afrique du Sud, et ils ont dépassé cela », fait-il remarquer.
Serait-il intéressé à participer aux élections libanaises si cette possibilité était ouverte aux émigrés ? Croit-il que les Libanais d’Afrique en général seraient mobilisés dans ce cas ? « Cela ne peut pas se passer ainsi, dit-il. Il faut que ce soit accompagné d’une campagne de sensibilisation. Beaucoup de gens sont totalement coupés du pays, ils ne pensent même plus à le visiter, n’y sont pas intéressés. Ils sont peut-être fiers de leur héritage, mais que savent-ils du Liban ? D’un autre côté, permettre à tous ces Libanais de par le monde de voter, est-ce dans l’intérêt de quiconque au Liban, quand on ne peut contrôler leur choix ? Il faut commencer à régler les affaires internes. »
« Le Liban est un petit pays, vous avez besoin de rester unis, conclut-il. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être en paix avec tout le monde. Ce pays devrait devenir la Suisse du Moyen-Orient, uni et neutre. »