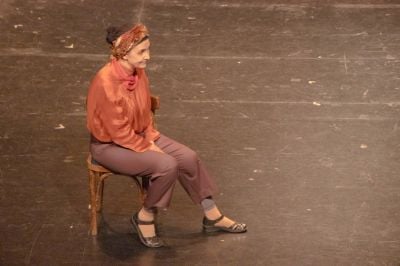Les quatre comédiens interprétant leur propre rôle dans la dernière pièce de Chrystèle Khodr « Ordalie ». De gauche à droite : Roy Dib, Rodrigue Sleiman, Tarek Yaacoub et Élie Njeim. Photo Marie Clauzade
Individus désœuvrés, adultes contrariés, citoyens démunis, mâles en mal de virilité, les quatre personnages nés au Liban dans les années 1980 qui racontent leur présent et leurs souvenirs sur la scène de la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis (MC93 Bobigny) en ce mois de mai incarnent les maux de toute une génération venue du Moyen-Orient et d’ailleurs. Face à eux, un public lui aussi quadragénaire, composé pour la plupart de Libanais, Syriens, ou franco-arabes, artistes ou amateurs d’art, regarde et écoute sa propre tragédie, comme dans un miroir.
Dans son nouvel opus Ordalie, comme dans ses précédentes pièces, Chrystèle Khodr aspire à parler avant tout des personnes – qu’elles soient sur scène ou dans le public –, et de ce qui nous réunit : l’amitié, l’espoir, le deuil, les rêves, les histoires tues, notre mémoire collective, notre imaginaire commun. Pour affronter l’amnésie et l’apathie générale en « passant à l’action », les comédiens s’entraînent à jouer quatre héros tirés de la pièce d’Ibsen Les Prétendants à la couronne (1863) qui raconte un moment de l’histoire norvégienne du Moyen Âge où ont triomphé la paix et l’unité.
Mise en abîme libératrice
« Je me sens tellement démunie que ma seule action passe par le théâtre, la fiction est une forme de résistance à la situation que l’on vit », confie la dramaturge quadragénaire dans un entretien avec L’Orient-Le Jour. L’action de sa dernière pièce se déroule pendant la nuit du 1er septembre 2020 qui marque le centenaire de la création du Grand Liban par la puissance mandataire française. Ce jour-là, le président français Emmanuel Macron est en visite au Liban, et l’ancien Premier ministre libanais Saad Hariri – démissionnaire à la suite d’une insurrection populaire – est reconduit dans ses fonctions. Les proches des victimes de l’explosion au port de Beyrouth, le 4 août 2020, manifestent quotidiennement, et la livre libanaise poursuit sa chute libre. Dans le quartier de Gemmayzé, à Beyrouth, les habitants ont pris l’habitude de se réunir chaque soir autour des ruines. Une rumeur folle persiste : des battements de cœur ont été détectés sous les gravats. Mais celle-ci sera bientôt démentie, laissant place à une immense déception populaire.
Les personnages de la pièce, quatre comédiens, se retrouvent par hasard cette nuit-là. Ils sont de vieux camarades de la faculté des arts dramatiques, issus de la classe moyenne et de régions périphériques, que rien ne prédestinait a priori à devenir artistes. Ces archétypes d’antihéros se rendent sur l’aire de jeux qu’ils fréquentaient enfants, et qui doit être détruite le lendemain. Durant cette nuit, leur mémoire intime entre les années 1990 et 2020 va se déployer. Cette vie qui est une série d’« ordalies ».
Le mot, qui désigne une épreuve censée déboucher sur la révélation d’une vérité, est au cœur de la pièce d’Ibsen Les Prétendants à la couronne. Cette saga historique met en scène des hommes qui se disputent le pouvoir et traite, entre autres, du sexisme de ces milieux. « J’ai été fascinée par cette pièce quand je l’ai lue, confie Chrystèle Khodr. Ce jeu du pouvoir, nous autres, ne l’avons pas expérimenté dans notre vie personnelle. Les hommes comme les femmes sont victimes de ce système. Mais n’avons-nous pas une part de responsabilité ? »
La réappropriation de la mémoire
C’est à cette interrogation que nous renvoie la pièce. Ainsi, par effet miroir, c’est notre propre ordalie que nous subissons. Si les dirigeants sont encore au pouvoir, c’est parce que nous autres ne connaissons rien de ce jeu. C’est notre part de faiblesse, de doute, de passivité, de lâcher prise qui les a gardés en place. Au Liban, la question du pouvoir est liée à la mémoire, explique la metteuse en scène. « En 1990, les anciens seigneurs de guerre ont commencé par tout effacer, affirmant que la guerre était finie et que tout le monde était pardonné. Ils se sont auto-octroyé une amnistie. Comment les corps des enfants qui ont vécu la guerre peuvent-ils encaisser cela ? Comment grandir avec ? »
À l’inverse d’Ibsen, sa pièce s’ouvre sur le rétablissement de la paix. Quatre comédiens vont garder un champ de ruines contre la menace de bulldozers qui doivent venir le raser au petit matin. Ils défendent corps et âme ce territoire qui est la preuve qu’un crime de guerre a été commis, mais incarne aussi toute l’obscénité de la politique de reconstruction mise en œuvre par le gouvernement libanais depuis les années 1990.
Trois événements réels, véritables marqueurs pour une génération tout entière, sont portés au plateau : les premières élections parlementaires après la guerre civile en 1992, le concert de la star mexicaine de télénovelas Lucia Mendez en 1993 et la visite du pape Jean-Paul II à Beyrouth en 1994. L’observation de ces faits et leur mise en opposition avec trois autres actions des Prétendants à la couronne – le couronnement de Haakon Hakonson, la rébellion du Jarl Skule et sa fuite – forment l’ordalie que ces quatre acteurs s’imposent, afin de s’affranchir de leur statut de victime et devenir des survivants capables de rendre justice aux petits garçons qu’ils étaient.
Si, dans la pièce d’Henrik Ibsen, l’individu opposé à la paix est mis en échec et si l’auteur choisit résolument de partager avec le public un moment de l’histoire norvégienne où triomphent la paix et l’unité en donnant au peuple un rôle déterminant, la pièce de Chrystèle Khodr questionne la possibilité d’une paix sans justice en posant un regard critique sur la défaite de la génération d’après-guerre face aux séries de catastrophes qu’elle a subies en période de paix.
Prochaines dates :
Festival Colline Torinesi, Turin, Italie, 30 et 31 octobre 2024.
Théâtre Joliette, Marseille, 12 et 15 mars 2025.
Théâtre Garonne, Toulouse, 18 et 20 mars 2025.
Beyrouth, avril 2025.