
Dans le film « Batata », le personnage de Maria laboure les champs de pommes de terre. Photo DR
Noura Kevorkian, qui a grandi au Liban et qui s’est installée au Canada depuis ses 18 ans, n’a pas eu peur de se pencher dans son dernier documentaire, Batata, sur la délicate question des réfugiés syriens au Liban. N'est-ce pas justement l'une des fonctions du cinéma que de permettre de poser sur la table des questions d’actualité sensibles, en les affranchissant des connotations taboues qui y sont d’emblée attachées ? Tout est dans la manière de le faire, certes, et Noura Kevorkian le fait avec douceur et poésie quand bien même il s’agit d’un documentaire. Elle vise la cinématographie et pas seulement l’information réaliste. Et c’est sans doute autant le sujet que la beauté des images, des couleurs, de la musique et un déroulé qui ressemblerait à celui d’un road-movie — bien que l’on soit dans un périmètre relativement circonscrit, qui lui ont valu les nombreux prix et le chaleureux accueil des festivals internationaux dont le prestigieux Peabody Award, le Amnesty Award, le Human Rights Award, le meilleur film Fipadoc, les accolades du Festival de Carthage et de Malmö jusqu'à être pressenti pour les Oscars 2024, sans toutefois être retenu.
 La réalisatrice libano-canadienne Noura Kevorkian. Photo DR
La réalisatrice libano-canadienne Noura Kevorkian. Photo DR
Le film suit le quotidien de Maria, une femme lumineuse et charismatique qui vit dans un camp de réfugiés de la Békaa et qui au départ, comme beaucoup de ses concitoyens travailleurs agricoles, faisait l’aller-retour entre le Liban et la Syrie, jusqu’à ce qu’éclate là-bas la révolution puis la guerre civile. Depuis, Maria qui rêve de retourner en Syrie un jour continue à travailler dans les champs, à cuisiner pour tous, à prendre soin de ses parents et à suivre les nouvelles de son pays natal ainsi que celles de son pays d'accueil, depuis que tout y a basculé aussi. Tout comme Maria n’avait pas prévu de camper au Liban dans une tente où ils sont nombreux à cohabiter – la promiscuité ne permettant aucun épanouissement –, Noura Kevorkian n’avait pas prévu, lorsqu’elle avait commencé ce film en 2009, d’y passer dix ans. Issue d’un père libanais arménien et d’une mère syrienne, la réalisatrice visait à l’origine « une exploration personnelle d’un sujet politique et culturel, celui des relations entre Syriens et Libanais ».
« Je passais parfois des semaines entières dans le camp »
« J’ai travaillé la relation Liban-Syrie à travers la culture des pommes de terre, qui forment des champs magnifiques, dit-elle à L'Orient-Le Jour. Je ne voulais pas que ce soit des interviews orientées vers la politique uniquement. (…) Quand je terminais de tourner, la révolution syrienne a commencé. Je ne m’attendais pas à ce que ça se transforme en guerre civile. Je m’étais engagée sur le terrain. J’avais prévu de filmer Maria et sa famille rentrer en Syrie, ce qui n’a jamais eu lieu. » La cinéaste décide alors de continuer à suivre l’histoire de l'ouvrière agricole : « Je suis revenue à Anjar et j’ai emmené mes enfants avec moi afin de poursuivre le travail (…) Je me suis attachée à ces réfugiés, car je passais parfois des semaines entières dans le camp », indique celle qui note au passage la difficulté de filmer à cause de l’environnement culturel et l’importance de créer la confiance, « les réfugiés étant effrayés de parler politique et craignant pour leur sécurité » ? Ceci la pousse à mener par elle-même toutes les phases liées au développement du film : l’écriture, la réalisation, la photographie et le montage. Batata sera nominé pour meilleur DOP (Director of Photography ou chef opérateur) à la Canadian Academy. Il est en effet porté par la lumière de la Békaa, ses paysages et ceux de l’Anti-Liban au loin et par les couleurs des vêtements et des voiles des femmes. Les couleurs, justement, de même que les scènes d’amitié et de grande fraternité, d’enfants qui s’amusent en plantant les pommes de terre, de culture de la terre – puisque « l’agriculture, c’est comme tomber amoureux, comme dit Moussa, parce que vous espérez bêtement que ça va marcher » – font que le film n’a rien de misérabiliste. La cinéaste réussit à relater, sans faire de voyeurisme ni verser dans une esthétisation de la pauvreté, mais avec poésie, la vie d’une communauté qui pâtit, à l’instar de tant d’autres, de la crise économique et des conflits au Moyen-Orient.
 Dans « Batata », Moussa est la figure paternelle qui protège les réfugiés/ouvriers syriens du champ de pommes de terre. Photo DR
Dans « Batata », Moussa est la figure paternelle qui protège les réfugiés/ouvriers syriens du champ de pommes de terre. Photo DR
Moussa est le propriétaire terrien arménien qui les fait travailler, qui veille sur eux et qui sait de quoi il tient, car il vient d’une famille qui a vécu le génocide arménien. « Moussa prend soin de nous tous, raconte Maria. Même si nous sommes syriens, nous sommes devenus comme sa famille. Ses parents étaient très pauvres. Il comprend notre situation, ils sont venus à Anjar, ils ont vécu dans des tentes comme nous. » Les liens qui se créent sont ce qui permet à Maria de tenir le cap. « Moussa est là. Quoi qu’il arrive, il y a Dieu là-haut et Moussa sur terre », témoigne-t-elle dans le film. La descente aux enfers du Liban en décidera autrement…
De son côté, Moussa est admiratif de la femme « qui a plus de force que les marines américains », dit-il. Pour la réalisatrice, Maria est en effet « une guerrière. Elle représente des femmes que nous n’avons pas l’occasion de valoriser ». Aussi, a-t-elle voulu voir dans ce film, « une œuvre féministe et célébrer la personnalité unique de Maria, son indépendance et les sacrifices qu’elle fait pour faire tenir la communauté ». Mais si l’image de la femme qui conduit le tracteur avec des talons, qui prend soin des siens et qui arbore un large sourire, est séduisante, et que la Békaa vire au rose en fin de journée ou aux aurores, il ne faut pas s’y tromper, sa situation et celle des siens est loin de l’être. Seuls le travail de la terre, la musique et la voix de Feyrouz semblent adoucir ou rendre supportable ce siège.
Et si le film traite essentiellement de la vie d’un groupe bien spécifique de réfugiés syriens, à savoir les travailleurs agricoles, la cinéaste fait allusion par ailleurs, avec doigté et humour, par des séquences radio ou télé, au point de vue des Libanais quant à la présence syrienne dans le pays, sur fond notamment de la contestation d’octobre 2019 et de la crise financière. « En tant que conteuse, il est important que je dise la vérité », observe Noura Kevorkian. Elle dit avoir tenu à faire entendre les deux sons de cloche. Le second est bien plus timide.
Identités orientales multiples
Noura Kevorkian, qui concentre en elle des identités orientales multiples, confirme que l’objet de son film est politique, mais qu’elle cherche à « transmettre cet aspect d’une façon humaine et avec respect et sans vouloir donner de leçon. La politique est dans notre sang surtout si on a vécu au Liban (...) Je me soucie des histoires des autres. Je veux dire les histoires de la condition humaine, ce que les guerres font à la vie des gens ». Elle en vient, elle sait ce que c’est. Ses grands-parents sont des survivants du génocide. « Les Arméniens ont vécu dans des tentes, la moitié d’entre eux sont morts, les autres sont venus à Aanjar. » Tout son cinéma traite de « sujets sociaux, de droits de l’homme et de questions de femmes ».
Son court-métrage Veils Uncovered (Les voiles dévoilés) sur les femmes voilées qui achètent de la lingerie au Souk el-Hamidiyé à Damas avait été récompensé par l’International Documentary Festival et par Half Docs. Est venu ensuite Anjar, Flowers, Goats and Heroes (Anjar, les fleurs, les moutons et les héros), un hommage aux Arméniens qui se sont installés dans ce village et y ont reconstruit leurs vies.
On l'aura compris, la réalisatrice n'est pas étrangère à la Békaa. Loin de là. C'est à Anjar qu'elle a grandi. Son père, né dans les camps de la Quarantaine et cherchant la sécurité – le village étant une base militaire syrienne –, avait choisi de s’y installer avec sa famille un an avant que n’explose la guerre au Liban. Dans son opus intitulé 23 km, Noura Kevorkian a d'ailleurs rendu hommage au pater familias qui emmenait sa tribu tous les dimanches à Zahlé déjeuner sur les berges du fleuve Berdaouni et ensuite au cinéma voir des westerns, des productions bollywoodiennes et autres. La jeune femme en nourrira un rêve qu’elle décidera de suivre après un passage par des études d’économie et de finances. Et c’est cette géographie qui continue à inspirer tout son travail de documentariste et d’artiste.
Les images, les mots, la musique… la beauté et les multiples témoignages d’humanité, d’artistes, de cinéastes, d’écrivains, à supposer qu’ils ne tombent pas dans des oreilles de sourds et des yeux d’aveugles, permettront-ils un jour d’interrompre la répétition de la violence dans cette partie du monde ? Batata se termine sur un chant liturgique chrétien servi par la sublime voix de Fadia Tomb el-Hage et par une vue surplombant le camp de fortune, immobile et isolé dans la vaste plaine. Cette vue permet de voir la délicatesse de la situation et son inadéquation…
Il est, certes, des questions de dignité humaine qui ont besoin d’être regardées et traitées, et pas que par les cinéastes. Le pouvoir de ceux-ci, toutefois, est de rendre certaines réalités plus palpables et de sensibiliser un public large, notamment occidental, à la question des déplacements de populations.


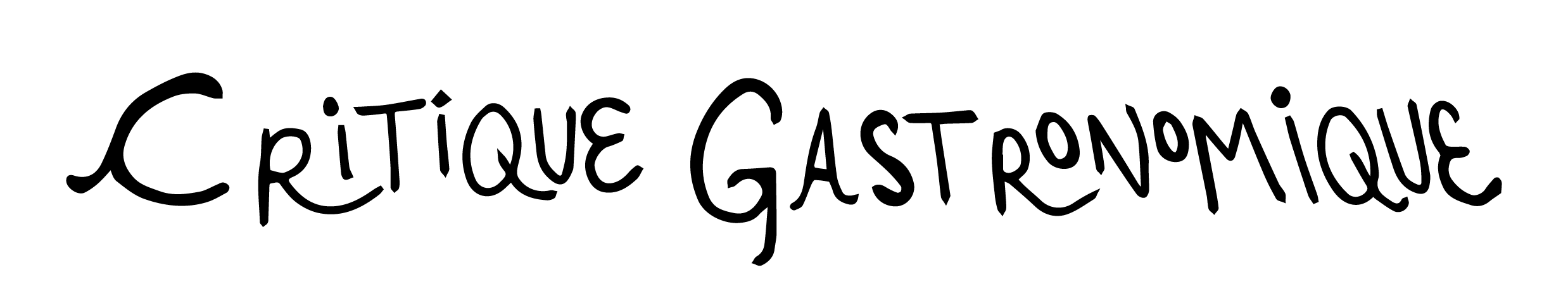
commentaires (0)
Commenter