
Olivier Darrioumerle arborant le maillot des Beirut Phoenicians 15 ans plus tard, dans le centre-ville de Bordeaux aux couleurs de la Coupe du monde de rugby 2023.
Avril 2008. Damas, stade des Abbassides. En short de rugby sur une pelouse brûlante, nous attendions l’arrivée des joueurs syriens. La première rencontre du tournoi du Machrek allait débuter. Le rugby avait toujours été un jeu pour moi. Ce match avait changé mon goût pour l’affrontement. Quelques semaines plus tôt, vue mer, je digérais ma dernière rupture sentimentale. La Méditerranée me souriait. Son odeur poissonneuse m’ensorcelait. Exilé à 24 ans au Liban, je tuais le temps au café noir. L’arrachement me paraissait être un problème insoluble. Je commençais à dépérir, si loin de mes racines bordelaises, quand une réflexion interrompit mon ennui : « Qu’est-ce que je cherche dans ce pays ? »
Beyrouth n’est pas une destination choisie au hasard. Je ne fuyais pas, je ne cherchais rien. Mon inscription à l’Université Saint-Joseph (USJ) était une énigme. J’écoutais les cours de droit des affaires d’une oreille distraite. Je regardais mes sandales en cuir. J’adorais ces nu-pieds achetés à Bourj Hammoud. Lorsque la sonnerie retentissait, elles me portaient dans les couloirs de l’USJ. J’avançais au cœur d’un tourbillon d’héritiers multiconfessionnels qui partageaient la même croyance dans le dollar. Je passais mes journées en vacances. Ils jouaient des coudes pour entrer dans le sérail. Leur temps était précieux. Mon dilettantisme les fascinait. Leur camaraderie me suffisait jusqu’à ce café vertigineux, sur la Corniche de Beyrouth, qui m’imposa une réponse existentielle. La vérité m’est apparue à l’improviste.
« Le jeu du paradis »
Je traînais mes sandales en cuir entre deux salles de cours lorsqu’un camarade me proposa de rejoindre l’équipe de rugby de l’USJ : les Beirut Saints. J’étais à la fois excité de retrouver le ballon ovale et inquiet de jouer à XIII (Rugby League). Je savais l’engagement plus frontal. Disons-le : plus brutal. Je m’étonnais que le sport national en Australie ait pu faire des émules au Liban. La fiche Wikipédia du rugby libanais explique rapidement la raison de cet attrait. « C’est le jeu qui se joue au paradis. Il est donc normal que les premiers colons (en Australie, NDLR ) et leurs descendants originaires du pays du Cèdre de Dieu puissent (y) prospérer. » Je glanais quelques informations sur les « Cedars », cette équipe de wallabies issue de la diaspora. S’ils avaient raté de justesse leur ticket pour la Coupe du monde 2008, le temps leur donnera raison. Ils disputeront les quarts de finale des deux dernières éditions, 2017 et 2022.
Le contraste de ces guerriers aborigènes avec l’équipe des Beirut Saints était saisissant. Mes camarades de l’USJ avaient moins l’air de chasseurs de crocodiles que de gros bébés qui auraient trouvé une balle sur un carré d’herbe. Seul l’entraîneur me fit forte impression. Tim était australien et ressemblait à Captain America. Ce surhomme bodybuildé, joueur emblématique des Cedars, m’enseigna, dès le premier entraînement, sa technique défensive. Le secret : le plaquage, à la découpe, en planche, sous la jugulaire. « Tough as old boots » (« dur comme des vieilles bottes »), disait-il. La seule manière de jouer au rugby à XIII, selon lui.
Je n’ai jamais compris son rôle d’éducateur à la tête du commando croquignole de l’USJ. Je ne comprenais pas davantage l’organisation de leur championnat universitaire « à l’américaine ». Après le premier match, j’ai lâché les Beirut Saints. Voilà ma grande culpabilité. J’aurais pu faire le tour du Liban et rencontrer les « Razorbacks » de Balamand (ALBA), les Eagles de Tripoli (LIU) , les « Lions » ( AUST) ou les « Immortals » de Beyrouth (LAU). Ceux-ci, « considérés comme les rois incontestés de la Rugby League libanaise, ont remporté cinq des onze titres possibles », rappelle leur fiche Wikipédia. Mon seul match à XIII aura été une débâcle avec les « Beirut Saints » de l’USJ contre les « Wolves » de l’AUB.
De XIII à XV
À la sortie du minibus, sans un mot, Tim nous distribua le maillot blanc floqué d’un saint Georges terrassant le dragon. Dans les vestiaires de l’Université américaine, il resta silencieux. Il s’enroula les épaules, les genoux et les coudes, de straps, comme un catcheur désenchanté. Il avala une demi-bouteille de Synthol et nous annonça, crachant par terre, que le jour était venu d’apporter la preuve de notre masculinité. Au coup d’envoi, chauffé à blanc, il s’élança seul, en tête de ligne. Il se fit exploser au plaquage, littéralement télescopé par son propre impact. K.-O. Tim sortit du terrain, titubant, comme un poulet sans cou. Trois peureux l’ont suivi à l’infirmerie. Leurs blessures, réelles ou supposées, nous obligèrent à diluer les équipes. Les « Wolves » de l’AUB nous prêtaient des joueurs. La défaite était lourde.
À la fin de ce match-catastrophe – dont je ne fus pas le héros –, j’entendis parler d’une équipe de rugby à XV ( Rugby Union), les « Beirut Phoenicians ». Je sautais sur l’occasion de quitter Tim et le rugby à XIII. J’avais honte de fuir devant l’adversité. J’essayais de me convaincre que ce jeu de massacre n’était pas pour moi. Je n’avais pas l’âme d’un coupeur de têtes. Je trimbalais ma blessure narcissique : étais-je encore un homme ? Je me persuadai qu’il fallait un grand combat pour guérir. Le Dieu des cèdres m’a-t-il entendu ? Deux semaines plus tard, je défendais le Liban contre la Syrie, dans le stade des Abbassides.
En l’absence d’organisation officielle, les Beirut Phoenicians représentaient le pays dans les compétitions internationales. L’année suivante, la Fédération libanaise de rugby sera créée. Quelques années plus tard, affiliée au World Rugby, elle aura son équipe nationale attitrée. The Phoenix. Ces derniers ne brilleront jamais comme les Cedars, mais ils auront le mérite d’être les artisans de leur propre championnat, avec les « Dragons » de Jounié ou les « Black Lions » de Jamhour. Si j’ai eu des scrupules en fuyant le XIII, j’ai regretté de ne pas jouer davantage à XV. Je me console, aujourd’hui, en me disant que j’ai eu la chance – et l’honneur – d’être à Damas, au centre des lignes arrières libanaises, entre un banquier irlandais et un Anglais taciturne. Deux joueurs rusés qui ne parlaient qu’entre eux. Ils venaient pour s’amuser, rien de plus. Ils formaient un commando de mercenaires à la solde du beau jeu. Dans le pack d’avants, un des piliers était français. Un petit gros, barbu et casqué, avec des mains comme des parpaings. Militant royaliste, surnommé « La Bûche », il aimait les drapeaux et le Christ. L’idée de se battre pour le Liban lui plaisait. Les autres étaient des autochtones. Certains fréquentaient les salles de muscu. D’autres étaient plus trouillards, mais ils ne se trahissaient jamais au combat.
« Kulluna lil watan »
Dans les gradins, pas un supporter, mais un portrait de Bachar el-Assad placardé tous les dix mètres. Au troisième tour d’échauffement, son visage s’était imprimé dans nos rétines. Les Syriens sont entrés sur le terrain. Je cherchais le numéro 13. Je dévisageais l’individu qui partagerait mon après-midi : une gueule d’anglais, genre biker, les biceps tatoués, des cuisses comme des poteaux d’autoroute. Un mètre cube de jambon blanc. Dans la famille British, j’avais pioché l’Idiot des îles. On se regarde. On s’évalue. On se mesure. On se nargue. Clemenceau ne disait-il pas que « le meilleur moment de l’amour, c’est quand on monte l’escalier ».
De retour aux vestiaires, l’entraîneur attendait nerveusement. Quand la porte se ferma sur le dernier joueur, il commença son discours. « S’il avait été libanais, jamais Jésus n’aurait été crucifié ! Ses apôtres auraient été armés ! Armés jusqu’aux dents, et prêts à mourir pour lui. » Les larmes aux yeux, il nous accrochait du regard. Chacun son tour : « Aujourd’hui, les apôtres de Jésus, c’est vous ! » J’enfournais mon protège-dents. Je limais les crampons de mes chaussures sur un coin d’asphalte comme j’aurais fourbi mes armes avant d’entrer sur un champ de bataille. Ce n’était plus un match, c’était une guerre.
Soudés, des bras aux épaules, un seul compatriote connaissait l’hymne national. Cela suffisait. À quelques minutes du coup d’envoi, je pleurais sous le drapeau qui flottait dans le ciel désertique des grandes victoires militaires.
Nous sommes entrés sur le terrain du stade syrien comme des guerriers païens. Chacun dans son camp, face à face. Mon biker anglais s’est craché dans les mains et m’a tendu un doigt d’honneur. J’avais appris un truc lors d’un échange scolaire avec un collège néo-zélandais : il n’y a que l’impact initial qui compte. Tout est dans la première impression. Les All Blacks dansent le Haka, rituel de combat maori, sûrs de la terreur qu’ils font naître dans le cœur de leurs victimes. J’ai demandé à mon coéquipier irlandais de taper le coup d’envoi, très haut, très fort, sur mon vis-à-vis. Le Biker anglais a tendu les bras, je l’ai plaqué à l’australienne : « Tough as old boots ». L’arbitre a sorti un carton jaune. Dix minutes dehors : le temps que la peur infuse.
De retour sur la pelouse, je lui glissais quelques insultes à l’oreille. D’expérience, je savais qu’à l’évocation des mamans, la réaction est immédiate. Une petite bagarre éclatait. Je profitais du désordre pour lui masser les c... avec mes crampons aiguisés. Je l’achevais d’un coup de poing à travers le nez qui lui fit moucher rouge. Un bigleux édenté remplaça l’Idiot des îles. Il ne devait pas manger à sa faim. Son visage gris flottait sur un corps sans muscles. Mais quel plaisir de lui enfoncer la tête dans l’herbe. Le Syrien crachait de la terre.
La Syrie, et ses ruses florentines
Dans le bus du retour, nous étions heureux et soulagés. Nous rentrions au Liban avec une victoire aussi précieuse que celle du 26 avril 2005. Mais la surprise fut brutale, au passage de la douane. Pris d’une nausée collective, le fond de l’œil jaune comme un œuf pourri, nous vomissions à l’unisson. Les analyses médicales décelèrent des helicobacter pylori, sous-titré en syrien : la torture de l’hélice intestinale. L’eau servie pendant le match était contaminée. Les Syriens avaient gagné. Mais l’empoisonnement produisit, chez moi, un effet secondaire, qui se caractérisa par une certaine fascination pour ces ruses florentines. Quelques minutes avant le déclenchement des vomissements, j’ai noté que mon visa fut prolongé gratuitement de trente jours. J’économiserais les 300 dollars du tampon « long séjour » en retournant une fois par mois en Syrie. Une aubaine. Je pourrais visiter les temples de Palmyre, les remparts d’Alep, les souks de Damas. Mon visa « provisoire » serait renouvelé à chaque retour au Liban. Ainsi, je programmais des allers-retours mensuels. J’allais et venais allègrement en Syrie jusqu’au jour où un douanier libanais mit en doute la sincérité de mon goût du voyage. Il confisqua mon passeport en échange d’une convocation à la Sûreté générale. Je me rendis dans cette imposante tour jaune et vitrée, où je fus reçu par un moustachu vêtu d’un treillis en tissu de camouflage gris qui se fondait parfaitement avec les murs de son bureau. Il feuilletait mon passeport d’un air contrarié. Comment pouvait-on économiser de l’argent en partant en vacances ? Il me harcelait de questions en arabe. Je lui répondais invariablement « ma baaref ». Son insistance devait me pousser à avouer des activités clandestines. Je lui répondais invariablement : « Ana faransi, ana talib fi lubnan. » Le moustachu était persuadé que je mentais. Mon passeport taché de visas syriens en était la preuve. Les heures passaient. Son insistance à me parler arabe était sûrement une technique d’interrogatoire des moukhabarat.
Après quatre heures d’une discussion blanche, je ressentis le besoin irrépressible de savoir si nous parlions la même langue. « Je vous dirai tout ce que vous voulez lorsque vous cesserez de me parler en arabe avec ce balai à chiottes qui vous sert de bouch-stache. » J’ai compris que le militaire était francophone à sa manière de tapoter nerveusement sur le combiné de son téléphone fixe à cadran rotatif sorti des années 90. Je sentais que j’avais marqué un point. J’ai aussitôt voulu le mettre échec et mat. J’ai exigé un appel à l’ambassade de France. Stratégie gagnante à laquelle il répondit par l’appareil lui-même, qu’il me jeta au visage. « Qu’est-ce que tu fais dans ce pays ? » m’a-t-il demandé dans un français parfait, mâtiné de cet accent libanais qui en adoucit les rugosités. Je ne lui ai pas raconté qu’une rupture amoureuse primitive était l’inéluctable cause inconsciente de ma présence au Liban. Alors, je n’ai rien dit. « Appelle l’ambassade. Dis-leur que tu rentres chez toi. » J’aurais pu dire que j’avais défendu les couleurs du Liban contre la Syrie. Il ne m’aurait pas cru. Alors, je lui ai répondu : « Vous n’allez pas me renvoyer en France, je suis orphelin, là-bas… Le Liban est le seul pays du monde où je me sens comme à la maison. Ici, je me sens chez moi. On est tous des voyageurs, tu le sais : tu es phénicien. Ya khayé, on a le même sang ! » Il a levé les yeux, la mine dépitée, il m’a rendu mon passeport et m’a dit : « Yalla, bye. Rentre en France. » J’ai su, à ce moment précis, que le Liban était mon utopie. Cet ailleurs. Ce désir impossible. Ce lieu fantastique à la fois idéal et invivable. Je suis rentré à Bordeaux, persuadé qu’un jour, le Liban sera mon pays.


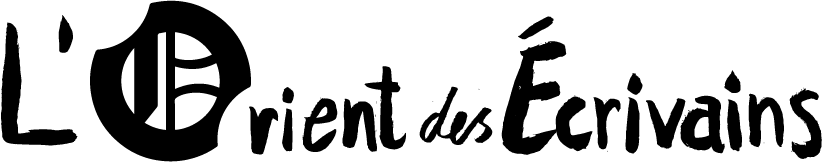
commentaires (6)
« S’il avait été libanais, jamais Jésus n’aurait été crucifié ! ».... erratum magnus, comme auraient dit les romains: s'il avait été libanais, il aurait sûrement émigré aussi loin que possible... euh, ... les iles canaris par exemple...
Wlek Sanferlou
16 h 04, le 08 octobre 2023