
Une poignée de femmes afghanes tenant des pancartes lors d\'une manifestation devant l\'ambassade d\'Iran à Kaboul en soutien au mouvement de contestation en Iran, le 29 septembre 2022. Photo Wakil Kohsar/AFP
Le souvenir de ne pas savoir si elle rentrera chez elle après une manifestation. Si elle sera tuée dans les rues de sa ville. Ou arrêtée par les agents du régime. Ce sentiment, Wafa Mustafa le connaît si bien. En voyant les scènes de protestations qui secouent l’Iran depuis plus de trois semaines, il a refait irruption. « Cette peur qui vous habite, c’est ce qu’on partage avec les Iraniens. Ce qu’il se passe là-bas semble si familier », confie l’activiste syrienne ayant fui son pays en 2013.
De la Tunisie à l'Afghanistan, en passant par le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen : pour de nombreuses voix de la région, le mouvement de contestation en Iran réveille des souvenirs pas si lointains. « Je m’efforce cependant de ne pas ramener les événements à la Syrie », précise Wafa Mustafa depuis Berlin. « Cela ne mène nulle part », poursuit celle qui, sans nouvelles de son père depuis plus de neuf ans, alerte quotidiennement sur le sort des disparus du régime Assad. Certes, les peuples syrien et iranien ont un ennemi commun, rappelle la trentenaire en référence au régime de Téhéran, l’un des principaux parrains de Damas. Certes, la chute espérée du pouvoir iranien pourrait entraîner son lot de rebondissements en Syrie. « Mais ce n’est pas pour ces raisons que je ressens un tel attachement au cri de colère des Iraniens, dit Wafa Mustafa. Je crois avant tout au fait que tout le monde mérite d’être libre ».
Une réaction à rebours du silence observé par les leaders du Moyen-Orient et du monde arabe, craignant un scénario similaire à celui des printemps arabes. De son côté, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, avait dénoncé le 3 octobre un complot des États-Unis et d’Israël, lorsque le secrétaire général du Hezbollah, milice libanaise pro-Téhéran, avait qualifié la mort de Mahsa Amini d’ « incident mystérieux ».
Les retombées dans les pays alentour
Depuis le décès suspect de cette jeune kurde de 22 ans le 16 septembre dernier, c’est tout le pays qui s’est embrasé. Trois jours plus tôt, elle avait été arrêtée par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire de la République islamique. Ce qui avait commencé comme un soulèvement féministe s’est rapidement transformé en une remise en question inédite du régime des mollahs. Réprimés dans le sang, au moins 154 manifestants ont perdu la vie depuis la mi-septembre, selon l’ONG Iran Human Rights basée à Oslo. S’il est encore trop tôt pour prédire l’issue du mouvement de contestation, il ne fait nul doute que le point de non-retour a été atteint pour les autorités iraniennes. Ces derniers jours, les scènes qui se déroulent dans les rues du pays sont d’une ampleur jamais vue depuis 2009, lorsque la révolution verte avait échoué. Révolte ou révolution, le soulèvement actuel reflète des mutations profondes qui traversent la société iranienne depuis les dernières années.
Ces images revêtent une dimension particulière pour les acteurs des pays où sont présents les mandataires de Téhéran. « Je ne crois pas à la chute du régime iranien dont les racines sont presque inébranlables. Bien plus fortes que celles du régime de Saddam Hussein en Irak », estime Ali al-Mikdam, journaliste irakien et fondateur de l’Irak Future Center for Democracy Support. Pour autant, les retombées pourraient déjà se faire sentir en Irak, suggère-t-il. « Plus il y a de problèmes en Iran, qu'ils soient sociaux, économiques ou même politiques, plus le pays est obligé de se concentrer sur la gestion de ses affaires intérieures, ce qui affaiblit sa mainmise sur la région que ce soit en Irak, au Yémen, au Liban ou en Syrie », pense le journaliste.
Suivant avec ferveur et admiration les protestations en Iran, Baraa Shiban, activiste yéménite, ne croit pas non plus à la chute du régime de Téhéran. « Il dispose d'une structure policière importante et solide et ne se laissera pas abattre aussi facilement », estime-t-il. L'activiste se réjouit malgré tout que le mouvement de contestation se poursuive en dépit de la répression exercée par les autorités iraniennes. Actif durant les manifestations ayant secoué son pays dès 2011, le jeune homme a été contraint de quitter le Yémen en 2015 lorsque les rebelles houthis – soutenus par Téhéran – ont pris le contrôle de la capitale, Sanaa. Pour lui, les protestations menées par une partie de la population iranienne dévoilent au grand jour une réalité que le régime cherche à tout prix à dissimuler. « L'Iran clame depuis longtemps que la révolution islamique ne s'arrête pas à ses frontières et qu'il est important pour les autres pays de suivre le modèle iranien. Il est donc nécessaire pour Téhéran de montrer que tout va bien. Or, les manifestations prouvent exactement le contraire », explique Baraa Shiban.
Pour l’activiste yéménite, le timing est symbolique. En pleines négociations sur le nucléaire pour réactiver l’accord de Vienne dont l'ancien président américain Donald Trump s'était retiré, c’est un peu comme si le régime de Téhéran était rattrapé par ses vieux démons. Au cours des derniers jours, l’Union européenne et les États-Unis ont annoncé que de nouvelles sanctions seraient bientôt prises contre l’Iran face aux violations des droits de l’homme commises dans le pays, sans pour autant vouloir compromettre les pourparlers sur l’accord de Vienne. « Les Occidentaux doivent suspendre les discussions », s’indigne Baraa Shiban.
Changement structurel du régime
Au Liban, où la question iranienne fait office de ligne de fracture politique depuis des années autour du clivage pro et anti-Hezbollah, les protestations iraniennes ont une résonance toute particulière. D’autant plus que les événements interviennent tout juste trois ans après le soulèvement libanais, dont beaucoup de jeunes n’ont pas encore digéré la fin en queue de poisson. Si Dima Ayache, membre du réseau politique de la jeunesse au Liban, Mada, et active durant la "thaoura", estime qu’on ne peut comparer un soulèvement à un autre, elle voit pourtant des points communs entre la révolte au Liban et le mouvement de contestation en Iran. « Que nos revendications soient similaires ou différentes, nous demandons tous deux un changement structurel du système, pour notre liberté », affirme-t-elle.
Au-delà du Proche-Orient, la vague de soutien à l’égard de l’Iran a touché le Maghreb, où les femmes participaient aux côtés des hommes aux manifestations ayant éclaté en Tunisie dès 2011 puis en Algérie dès 2019. Alors que Najet Zammouri, vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, s’est immédiatement indignée en voyant les scènes de colère en Iran, elle n’a pas été surprise. « Les régimes autocratiques religieux sont capables de tout acte violent à l’égard des femmes », dit-elle. Bien que les situations soient très différentes, le combat actuel de la population iranienne pour ses droits l’inspire à ne pas céder dans son pays. « Si la Tunisie est considérée à l'avant-garde des pays musulmans et arabes en relation avec les droits de la femme, nous avons ressenti des tentatives de régression à partir de 2011, explique-t-elle. Le parti islamiste qui avait la majorité électorale à cette époque a essayé d'amender le code du statut personnel en vue de supprimer des droits tels que la monogamie et le mariage civil. Certains adeptes de ce parti politique appelaient même au port obligatoire du voile ».
Optimiste quant au fait que le pays connaîtra bientôt une révolution aboutissant à un changement de régime, ce point de vue est loin d’être partagé par Zahra, ayant quitté il y a huit mois l’Afghanistan pour se réfugier au Pakistan voisin. Si elle a été informée du mouvement de contestation en Iran par des amis vivant dans le pays, elle est vite passée à autre chose. « Je suis aussi une femme et ma situation est horrible ». L’été dernier, elle a assisté à distance et sans grand espoir aux manifestations d’une poignée de femmes dispersées par les autorités talibanes dans son pays. « Je savais que rien n’allait changer. Tout est politique, lorsque le gouvernement entier est contre toi, rien ne changera ».
Au-delà des émotions qu’il réveille, le soulèvement iranien remet au goût du jour des questionnements ayant travaillé les pays de la région des années durant. Le peuple a-t-il le pouvoir de changer le destin d’une nation ? Comment transformer une révolte populaire en révolution politique ?

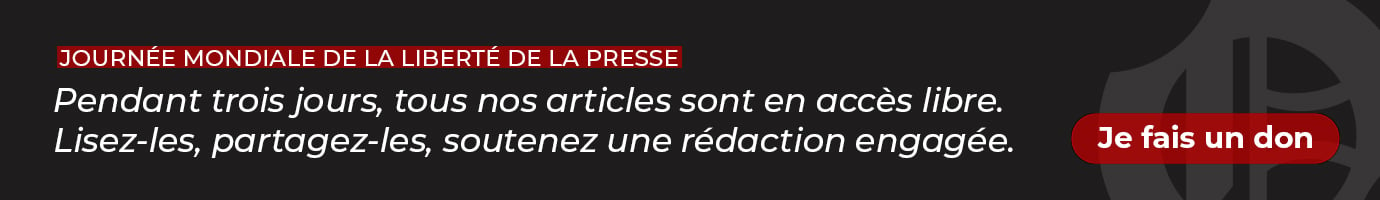





commentaires (4)
Toute l'entité néo-safavide n'est qu'une gigantesque pyramide de Ponzi géo-politique et ce qu'on commence à voir en Iran n'est que le début de son effondrement. Je m'explique: le peuple iranien n'a jamais vraiment adhéré à la "république islamique" et au dogme du wilayet el faqih inventé par elle-même. Même si les révolutionnaires de 1979 demandaient mot pour mot une république islamique, de l'aveu de nombre d'entre eux ils ne voulaient pas du tout une application stricte de la chari'a dans ses détails les plus pharisaïques tel que l'a fait le wali el faqih. Le terme de "république islamique" n'était d'ailleurs que le troisième d'un slogan d'alors. Et les 2 premiers termes étaient indépendance et liberté. Indépendance pour dénoncer la dépendance relative du régime du Shah vis-à-vis des Etats-Unis et liberté pour dénoncer son caractère autocratique. Khomeiny et les mollah étaient quand à eux dans un monde proche du parti Da'wa iraquien et des Frères Musulmans, complètement étranger à l'Iran. Leur régime n'ayant jamais eu l'adhésion de la population ne pouvait donc survivre qu'en s'appuyant sur des milices chiites non-iraniennes qui établissent un Israël chiite au coeur du Moyen-Orient. Tout comme le régime néo-safavide laïc des Assad. D'où la création en premier lieu du Hezbollah en 1982. Le coût économique d'une telle politique étrangère ultra-expansionniste a fini par jeter les iraniens dans la rue depuis décembre 2017 sans vraiment s'arrêter jusqu'à maintenant. Et voilà.
Citoyen libanais
22 h 59, le 10 octobre 2022