
Dans le film « Dirty, Difficult, Dangerous », de Wissam Charaf, Ahmed et Mehdia, deux réfugiés que le destin a jetés dans un pays étranger et dans les bras l’un de l’autre. DR
Le Liban est au cœur de Dirty, Difficult, Dangerous, le deuxième long métrage de l'auteur franco-libanais, né à Beyrouth et enfant de la guerre civile, un Liban qui accueille avec réticence les réfugiés syriens qui se sont pressés à ses portes il n’y a pas si longtemps, meurtris par un régime prêt à sacrifier les siens.
Ahmed est l’un d’entre eux, jeune adulte à la beauté christique, dont la survie dépend de la ferraille qu’il quémande en criant sous les balcons (fer, cuivre, batteries !) pour la revendre ici ou là. Un visage de rock star plutôt tendre, une dégaine longiligne et nonchalante (joué par Ziad Jallad) et, sous la peau, les éclats de métal provenant d’une bombe qui a laissé dans son épaule une empreinte indélébile qui gagnera bientôt son bras puis son corps tout entier. Et c’est l’une des grandes idées du film, qui n’assène aucun discours sur la guerre, qui n’en propose aucune narration, ni aucun lamento, que de montrer comment sa violence se propage et étend ses tentacules en un bras de fer qui ne laisse aucune chance à quiconque d’en sortir indemne.
Mehdia vit dans un quartier cossu de Beyrouth, jeune et belle Éthiopienne également en exil, domestique dans une famille libanaise, privée de son passeport et de toute liberté d’aller et venir.
Wissam Charaf nous épargne la rencontre entre Ahmed et Mehdia. Quand le film commence, leur histoire d’amour existe déjà, tout s’est joué hors champ, comme l’essentiel de cette histoire qui puise une partie de sa force dans ce qui n’est pas dit, seulement évoqué, et qui permet au spectateur d’être pleinement happé par ces deux réfugiés que le destin a jetés dans un pays étranger et dans les bras d’un de l’autre.
Mehdia (jouée par l’éblouissante Clara Couturet) a la charge d’un vieil homme sénile, ancien colonel dont la mémoire semble figée, capté par les films diffusés à la télévision, se rêvant en Dracula, un Dracula qui projette son ombre sur les murs de l’appartement et passe parfois à l’acte sur sa jeune garde-malade.
Ahmed et Mehdia n’ont pas d’espace pour s’aimer, et cette quête d’un lieu intime permet au réalisateur d’explorer les contours de l’exil et de mettre en scène le statut d’indésirable perpétuellement traqué. Le film tout entier est une recherche d’un lieu à soi, d’un refuge, d’un abri. Il y est question d’une maison détruite par la guerre, d’une chambre de domestique, d’un lit que les exilés syriens louent quelques heures à tour de rôle pour y dormir en sécurité. Jusqu’à ce que la caméra ouvre sur un vaste camp de réfugiés où la vie s’organise tant bien que mal, sous des bâches et des poutrelles montées à l’improviste, où la souffrance est contredite par l’énergie vitale des enfants et les tentatives de reconstruire un espace accueillant où il est parfois possible de planter quelques arbrisseaux comme pour délimiter son espace privé.
Puisqu’il n’est question dans le film que d’intime et de collectif, de ce passage obligé de l’un à l’autre, pour trouver la voie vers un devenir où l’un n’est plus une entrave pour l’autre.
L’originalité du cinéma de Wissam Charaf est de ne jamais enfermer les réfugiés dans un misérabilisme de circonstance mais de les faire évoluer dans la lumière, dans des cadrages conçus parfois comme des tableaux, où chaque détail a son importance, où chaque couleur, chaque harmonie souligne l’intensité et la sensualité qu’inspirent l’amour et la foi en l’avenir. Le plus bel exemple étant le soin apporté à la composition du refuge qu’Ahmed s’est bricolé dans une ruine où coexistent un matelas et un auvent de branchages, visités par la lumière du jour ou celle de la lune, antre dans lequel il reprend force, comme si la beauté du monde veillait malgré tout sur lui.
En écho à tous ces lieux de précarité, l’auteur a ce trait d’humour ou plutôt d’ironie (le film n’en est pas dénué) en imaginant Mehdia en gagnante d’un tirage au sort lui donnant le droit de séjourner dans un hôtel de charme avec la personne de son choix. Ce sont ici les images les plus osées que nous propose Wassam Charaf. Plutôt que de nous montrer le jeune couple faisant l’amour dans des draps soyeux, il les filme en petits bourgeois au bord de la piscine de l’hôtel, masque de beauté sur le visage, en touristes qu’ils ne sont pas, scène subversive qui déplace le regard, alors que quelques jours plus tôt, Ahmed tentait de voler une orange, et que le lendemain il prend rendez-vous avec un médecin pour vendre un rein. Pour payer le passage vers la Turquie, dont on apprend le montant indigne au détour d’une conversation.
Dirty, Difficult, Dangerous est aussi un film sur le corps, les corps mutilés, rongés par le phosphore, les armes chimiques (rapide allusion au détour d’une scène), corps changés en force de travail, capable de porter sur son dos une machine à laver, corps désirants, corps fourbus, corps vêtu d’un sempiternel jogging, pour Mehdia, et d’un pull rescapé d’un carton pour les nécessiteux, pour Ahmed. On notera au passage que dans ce carton confectionné dans la famille chic du colonel fou (lui-même vêtu d’une robe de chambre d’un jaune vif clinquant), se trouve un tee-shirt à l’effigie du groupe de rock Bauhaus. Clin d'œil à ce lien qu’entretient certainement le réalisateur à cette culture occidentale post-punk. Puisqu’il se met brièvement en scène comme le fils de la famille. Quand on se souvient que l’un des morceaux cultes de Bauhaus est le sublime Bela Lugosi’s dead on se demande si le film n’est pas finalement une métaphore du vampirisme. Qui terrorise qui ? Qui suce le sang de qui ?
Le film, plutôt bref, 1h20, est ce temps de latence pour que la métamorphose s’accomplisse, temps d'un deuil impossible, temps que le corps d’Ahmed rejette le métal, sans que l’on sache qui va l’emporter, le métal ou la chair humaine. C’est aussi l’histoire du Liban contemporain qui charrie mille destins venus de l’étranger. C’est dirty, difficult et dangerous. Mais par la grâce de la caméra de Wissam Charaf, la douleur et la rage sont d’autant plus palpables qu’elles demeurent presque invisibles, transcendées par l’harmonie du style parfois un brin burlesque de l’auteur, et filmées avec l’intelligence d'un regard souvent décalé, toujours poétique.
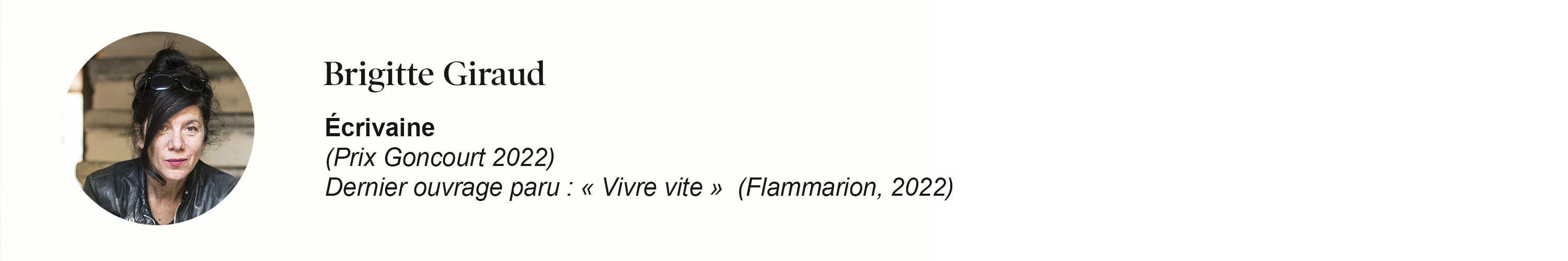

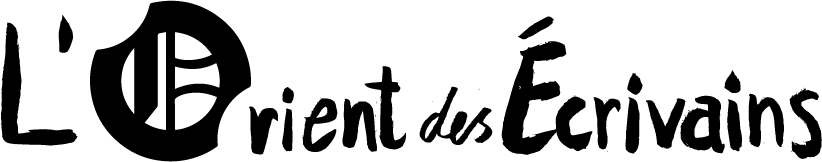
commentaires (0)
Commenter