
Michel Moawad, lors de la séance de l’élection du président, hier. Photo Mohammad Yassine
Son destin ressemble tragiquement à celui dont a été affligé son adversaire politique à Zghorta, Sleiman Frangié, un des principaux présidentiables. Très jeune, Michel Moawad perd son père, René, assassiné le 22 novembre 1989, alors qu’il avait été élu président 17 jours auparavant. Un sort que connaît également M. Frangié dont le père, la mère et la sœur sont assassinés en 1978 à Ehden par un commando Kataëb.
Nayla Moawad, mère de Michel, qui n’avait que onze ans à l’époque, prend le relais de son époux en se lançant en politique, en attendant que le fils parvienne à l’âge mûr. Ministre des Affaires sociales de 2005 à 2008, plusieurs fois députée à partir de 1991, égérie de l’insurrection souverainiste du 14 mars 2005 – on se souvient de son cri de triomphe au moment de la chute du gouvernement Omar Karamé dans la foulée de cet événement – elle a largement pavé la voie au jeune Michel. Héritier politique, ce dernier l’est assurément. Mais il n’aura de cesse d’apporter sa touche personnelle, en mettant en avant ses idéaux réformistes.
Sur le plan diplomatique, très tôt déjà, Nayla Moawad a tissé des liens solides avec les États-Unis. Son fils va hériter de cette relation privilégiée avec Washington, en approfondissant un peu plus les relations avec plusieurs membres du Congrès américain. La famille prend alors le pli d’inviter à sa résidence à Ehden les officiels américains de passage au Liban. Ce fut notamment le cas lorsque le secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait été reçu chez les Moawad en mars 2019, en présence du sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques, David Hale, et du secrétaire d’État adjoint, David Satterfield.
Après des études en droit public effectuées à Paris II-Assas, Michel Moawad retourne au Liban pour assumer le legs politique de la famille, avec toutefois l’intention de moderniser son approche. C’était notamment l’objectif recherché lorsqu’il a fondé, en 2005, le Mouvement de l’indépendance, né dans le sillage de la révolution du Cèdre après l’assassinat de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri.
En 2018, lors des élections législatives, il tente l’expérience d’une alliance avec les aounistes sans pour autant rejoindre politiquement leur camp. L’argument qu’il s’est évertué alors à mettre en avant est le fait qu’il avait été séduit par le slogan du « président fort » que martelait le camp de Michel Aoun. Il en est assez rapidement revenu, notamment après le déclenchement de la révolution d’octobre 2019 et surtout après l’explosion du 4 août 2020, une tragédie qui le pousse, à l’instar d’autres députés, à démissionner de l’hémicycle. Dans une autocritique exprimée publiquement, il a prononcé son mea culpa au sujet de son alliance électorale de 2018.
Au scrutin de 2022, il retourne à ses bases quatorze-marsistes en s’alliant avec les Kataëb, Majd Harb, fils de l’ancien député Boutros Harb et d’autres figures de l’opposition.Aujourd’hui, à la présidentielle, il est parvenu à se faire le porte-étendard des principales formations de l’opposition traditionnelle (FL, PSP, Kataëb), mais pas encore de la contestation issue du mouvement d’octobre 2019. Les députés de cette mouvance sont jusqu’ici convenus d’orienter leur choix vers des figures qui se situent hors de la polarisation politique entre le 8 et le 14 Mars. Pour eux, Michel Moawad est aujourd’hui trop marqué dans le camp du 14 Mars. « Si on refuse de voter pour Sleiman Frangié, comment pouvons-nous accepter de voter pour Michel Moawad ? Ce n’est pas une question de personne, mais de principe », dit Paula Yacoubian. D’autres lui reprochent, en sa qualité de membre de la commission des Finances, des prises de position jugées trop proches des intérêts des banques.
En revanche, pour les Forces libanaises, qui ont voté pour M. Moawad, leur choix est justifié par son ancrage dans le camp souverainiste. « Pour nous, l’assassinat de René Moawad a été la première tentative de putsch contre l’accord de Taëf (1989, qui a mis fin à la guerre civile). Voter pour son fils est une manière de rectifier le tir », commente le porte-parole des FL, Charles Jabbour.
Le legs chéhabiste
Premier président post-Taëf, René Moawad était compté à ses débuts parmi les proches du président Fouad Chéhab (1958-1964). Au-delà, il s’est distingué par une modération politique tout au long de son parcours. C’est ce legs que son fils Michel a revendiqué hier à sa sortie du Parlement, se proclamant « aussi bien fils du chéhabisme que de René Moawad ». L’assassinat de ce dernier, dans un quartier de Beyrouth quadrillé par les forces syriennes, a été depuis imputé à Damas. Ironie de l’histoire : Michel Aoun, qui occupait alors le palais de Baabda en qualité de chef d’un gouvernement de militaires chrétiens, avait refusé de reconnaître son élection et de quitter le palais présidentiel, fragilisant ainsi René Moawad. Or les Syriens voulaient de celui-ci une autorisation officielle pour que leur armée prenne Baabda d’assaut et déloge Michel Aoun. Une requête que le nouveau président a refusé catégoriquement de leur accorder, ne pouvant se résoudre à permettre à une armée étrangère d’investir la présidence et de défaire l’armée libanaise.
Michel Moawad est marié à Marielle Kosremelli, et est père de quatre enfants.



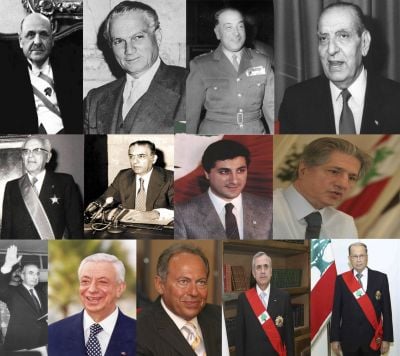

commentaires (6)
Michel Moawad est né en 1972. Il n'avait pas 11 ans à la mort de son père. Il est diplômé de l'escp et à fait un Master à la Sorbonne...je n'ai pas vérifié le reste!
Marie
15 h 15, le 20 octobre 2022