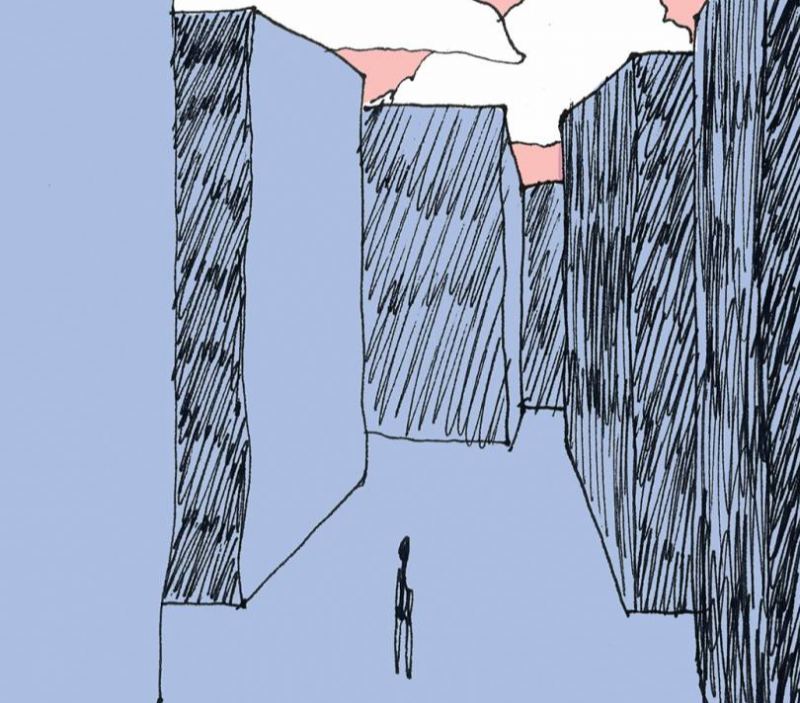
Si la volonté de réforme de la justice est réelle, l’organisation de l’accès à la magistrature pourrait bien en être la clé de voûte. Cette question se pose avec d’autant plus d’intérêt si l’on songe à augmenter le nombre de tribunaux, comme le législateur en avait l’intention en 2000 en prévoyant de créer des tribunaux administratifs dans les régions.
Cependant, l’examen minutieux de la nomination des juges du Conseil d’État au cours des dernières décennies montre de nombreux problèmes. Il y a deux manières d’entrer au Conseil d’État. Si l’obtention d’un diplôme de l’Institut des études judiciaires (IEJ) demeure le moyen d’accès principal à la fonction de juge au sein du Conseil d’État, le parachutage des présidents du Conseil d’État ou de ses chambres au sommet de la pyramide hiérarchique affecte, voire parasite la performance du Conseil.
Les présidents du Conseil d’État ou de ses chambres sont nommés par un décret du pouvoir exécutif alors qu’ils siègent dans les tribunaux judiciaires. Ils ont généralement une grande influence sur la performance de cet organe compte tenu des pouvoirs élargis dont ils disposent du fait de l’organisation hiérarchique au sein du Conseil d’État. Hormis le fait que ces nominations par l’exécutif peuvent renforcer l’influence du pouvoir politique sur le président du Conseil, cette modalité suscite un sentiment de frustration chez les juges du Conseil d’État. Ceux-ci sont surpris du parachutage de certains magistrats dépourvus de toute expérience en droit administratif, tandis que leur espoir d’accéder à des postes élevés s’amenuise.
Par ailleurs, la suspension dans la nomination de nouveaux juges a pour conséquences d’augmenter le nombre de postes vacants au sein du Conseil, mais également d’empêcher certaines réformes essentielles, comme la création de tribunaux administratifs dans les régions.
En outre, malgré la garantie d’impartialité affirmée par les autorités judiciaires aux concours d’entrée à l’IEJ, l’examen des conditions du concours soulève de nombreuses questions, notamment en termes de discrimination sociale. Il convient également d’examiner d’autres considérations qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme celles liées à la confession, au genre ou à l’origine socio-familiale, avec notamment la possibilité de voir la fonction de juge se transmettre de père en fils. Autant de critères qui ont un impact certain sur les résultats des concours.
La dualité des moyens d’accès au Conseil
Le statut du Conseil d’État énumère les moyens de nomination au poste de juges. Lorsque l’on étudie ces nominations au cours des dernières décennies, il ressort que les nominations, notamment les régulières, se font par deux procédés. Le premier – et le plus répandu – consiste à nommer les juges qui ont réussi le concours d’entrée à l’IEJ puis obtenu leur diplôme à l’issue des trois ans d’études (ils étaient au nombre de 59 entre 1991 et 2020, et leur nombre pourrait grimper à 65 en 2021). Plus de 80 % du total des nominations de juges sont effectuées au sein du Conseil depuis 1991 par ce procédé qui est donc le plus répandu. Une proportion qui atteint 92 % si l’on déduit de ce total les nominations effectuées à des postes de haut niveau.
L’autre moyen de siéger au Conseil d’État est d’y être nommé directement à des postes généralement de haut niveau, sans passer par les concours ou par l’Institut. Ces juges sont exclusivement nommés parmi les magistrats des tribunaux judiciaires, sur décret du Conseil des ministres. C’est ce qui a été observé avec la nomination des quatre derniers présidents du Conseil d’État depuis près de vingt ans, à savoir respectivement les juges Ghaleb Ghanem (2000), Chucri Sader (2008), Henri Khoury (2017) et Fadi Élias (2019). Ou encore avec les deux derniers commissaires du gouvernement auprès du Conseil, à savoir les juges Abdellatif Husseini (2010) et Férial Dalloul (2017), ainsi qu’avec la nomination des juges des tribunaux judiciaires qui ont été nommés au poste de président de chambre, dont le dernier en date a été le juge Antoine Breidi.
Par conséquent, l’on peut affirmer que les nominations régulières au sein du Conseil d’État sont régies par une dualité. Les juges aux postes de base sont nommés et sélectionnés par concours et intégrés au sein du Conseil d’État via l’Institut, alors que les juges du haut de la pyramide sont choisis parmi les magistrats des tribunaux judiciaires, puis parachutés via un décret du Conseil des ministres à un poste de haut niveau, dans le but de contrôler le Conseil d’État.
Pour mémoire, la nomination du juge Ghaleb Ghanem à la présidence du Conseil s’est accompagnée de l’amendement de la loi portant sur l’organisation du Conseil d’État en 2000 de manière à ce que les qualifications requises en matière juridique pour occuper ce poste soient conformes à ses propres qualifications. Ghanem était réputé proche du ministre Michel Murr, qui a été l’un des principaux acteurs de la nomination des juges chrétiens. Quant au juge Chucri Sader, il a été nommé à ce poste en 2008 sous la pression du mouvement du 14 Mars afin de le récompenser pour ses efforts dans la mise en place du Tribunal spécial pour le Liban, dont le mandat est de poursuivre les personnes présumées responsables de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri. La nomination du juge Henri Khoury, quant à elle, se distingue de celles de ses prédécesseurs car il n’a pas été nommé pour pourvoir à un poste vacant, mais plutôt après avoir poussé Sader à la démission en 2017. Une nomination intervenue sous la pression du parti du président Michel Aoun (CPL). Le ministre de la Justice de l’époque, Salim Jreissati, avait justifié le changement intervenu à la tête du Conseil d’État par le « souhait du régime de changer l’approche judiciaire ». Le Legal Agenda lui avait alors répondu par une phrase empruntée au défunt juge Nassib Tarabay, qui avait déclaré lors d’une conférence : « Le régime ne nomme pas ses juges comme il nomme ses ministres et conseillers. »
Le choix de juges parmi les détenteurs de doctorat est un autre procédé de nomination négligé : seuls trois juges ont été nommés par ce biais dans les années 1998, 2001 et 2004. Il convient de signaler que leur nomination effectuée sans concours ne les dispense pas de l’obtention du diplôme de l’Institut, comme pour les juges qui ont réussi le concours d’entrée. Le législateur est intervenu de manière explicite en 2000 pour consacrer cette obligation. Si l’on peut attribuer cela à la crainte d’une ingérence politique dans le processus de nomination des candidats sans concours, notamment avec la baisse de la qualité de l’enseignement à l’Université libanaise rendant l’obtention d’un doctorat relativement aisée, elle constitue en revanche un obstacle qui empêche d’attirer les diplômés des universités pouvant constituer un levier important pour le travail et les efforts du Conseil d’État. Le bureau du Conseil d’État peut évidemment déterminer des critères objectifs connus à l’avance pour se protéger et faire en sorte que ce pouvoir soit exercé de manière positive, plutôt que de quasiment renoncer à cette prérogative. Cette situation est contestable d’autant plus qu’il n’existe pas d’incitations encourageant les diplômés des universités à briguer un poste de juge au Conseil d’État. Deux juges administratifs ont indiqué au Legal Agenda que les dirigeants du Conseil d’État sont préoccupés en général par toute distinction au sein de cette instance fondée sur les études universitaires, ce qui se reflète par leur exaspération face aux « théories formulées » lors des délibérations. Cela conduit à l’absence d’opinions jurisprudentielles ou doctrinales dans les délibérations ou décisions du Conseil d’État, entravant le développement du droit administratif dans son ensemble, d’autant plus que ce droit s’appuie principalement et de manière coutumière sur la jurisprudence des juges administratifs.
Neuf ans sans concours : les vacances de postes au sein du Conseil entravent la création de tribunaux administratifs
Comme déjà démontré, le concours d’entrée à l’Institut et l’obtention du diplôme constituent le moyen d’accès principal à la fonction de juge au sein du Conseil d’État, avec plus de 80 % des juges ayant été nommés par ce moyen depuis 1990. Par conséquent, l’organisation régulière de ces concours devient non seulement une condition pour fournir les ressources humaines au Conseil d’État et pourvoir aux postes vacants, mais aussi pour permettre aux diplômés des universités de droit de passer le concours d’entrée au Conseil s’ils le souhaitent, sans qu’ils ne soient forcés d’attendre plusieurs années après l’obtention de leur diplôme.
L’examen des dates de ces concours révèle une autre faille importante dans l’organisation du Conseil d’État. Ces concours lancés en 1985 – le dernier en date ayant eu lieu en 2018 – ne sont pas organisés régulièrement. Au cours des dernières décennies, les sessions ont été suspendues pendant 12 ans (de 1986 à 1998) puis pendant 9 ans (la période allant de 2004 à 2013), et aucun concours n’a été organisé. Une réalité qui suscite de nombreuses critiques, car la première suspension est intervenue au cours de la période d’après-guerre. La seconde suspension est intervenue après que le législateur eut décidé d’augmenter les effectifs du Conseil d’État pour créer des tribunaux administratifs régionaux. À l’époque, le président du Conseil d’État Chucri Sader n’a pas hésité à justifier son incapacité à créer ces tribunaux en raison du nombre insuffisant de juges administratifs, par le défaut d’organisation de concours par le Conseil d’État.
Un concours non impartial ?
Nous abordons dans cette partie les conditions du concours, notamment la question de son intégrité et de son impartialité. Cela est important étant donné que le concours constitue le principal moyen d’accès au Conseil d’État et le plus répandu, comme préalablement expliqué.
Nous nous contenterons de signaler certains aspects préoccupants susceptibles de nuire à l’impartialité du concours, notamment :
Il est demandé aux postulants de remplir un formulaire de candidature au concours. En évaluant celui de 2018, nous avons pu constater qu’il comprend deux types d’informations injustifiables et sans rapport avec les exigences de la fonction judiciaire. Il est par exemple demandé au postulant de préciser la nature et les motifs de ses voyages personnels à l’étranger. Il doit également fournir des informations détaillées concernant les membres de sa famille : l’emploi précédent et actuel des parents, des frères, des sœurs et du conjoint. De quoi s’interroger sur la pertinence de telles informations quant à la validation de la candidature et sur les risques de leur utilisation abusive à des fins de discrimination sociale entre les candidats.
Le bureau du Conseil d’État peut exclure un grand nombre de candidats de l’épreuve écrite du concours sur la base de critères subjectifs ou du moins non transparents, sans que les candidats exclus n’aient la possibilité de contester cette décision. Le pourcentage de candidats exclus du nombre total de candidats a récemment connu une hausse considérable, qui pourrait porter atteinte au principe d’égalité d’accès au poste de juge et ouvrir la voie à toutes les formes de discrimination, notamment à la discrimination sociale et de classe. Lors de la session de 2018, 90 candidats ont été exclus sur un total de 153 postulants, soit 59 % du nombre total de candidats. Une pratique critiquable en raison des mécanismes sur lesquels elle repose.
Cette exclusion se déroule principalement à la suite des épreuves orales organisées par les membres du bureau du Conseil d’État. Au cours de cet oral, des questions d’ordre général, de langues et personnelles sont posées, qui concernent rarement le droit. L’ancien président du Conseil d’État Chucri Sader nous l’a d’ailleurs confirmé lors d’une entrevue qu’il nous a accordée en 2015 : « Ils doivent répondre à des questions dans les trois langues. Je les interroge sur leur famille, leurs études, leur enfance, leurs proches. »
Pire encore, le processus de sélection se base aussi sur des rapports fournis par les services de sécurité et annexés aux dossiers des candidats, sans que ces derniers ne puissent les consulter au préalable et discuter de leur validité. M. Sader a indiqué au Legal Agenda qu’il demandait à la Sûreté générale de vérifier l’identité de chaque candidat. « Nous avons découvert que l’un des candidats avait des antécédents de falsification de chèques. Un autre candidat soudoyait des membres de la Sûreté générale pour obtenir les papiers d’employés de maison. Je sélectionne environ 70 de ces candidats pour passer les épreuves écrites. Je sélectionne des candidats qui ne sont pas soupçonnés de corruption. »
La maîtrise du français ou de l’anglais est requise pour participer à l’épreuve écrite. Bien que la maîtrise des langues étrangères soit importante, cela pourrait, compte tenu de la baisse de la qualité de l’enseignement public, constituer un autre motif de discrimination sociale dans le concours. Il serait peut-être préférable de considérer la maîtrise de la langue comme un atout sans pour autant que son défaut devienne un motif de disqualification.
Bien qu’un certain nombre de ministres de la Justice (dont Bahige Tabbara) aient souligné que le critère confessionnel n’avait pas été retenu dans le cadre du concours d’entrée à l’Institut des études judiciaires après l’accord de Taëf, et dans la pratique depuis la première session consacrée aux juges administratifs qui s’est achevée par la suite (1998), et que « la nomination dépend des résultats obtenus par le juge diplômé, indépendamment de sa confession et ses affiliations », nous constatons une répartition égale des candidats ayant réussi le concours par confession, que ce soit au cours de la même session ou après deux sessions consécutives. Pour le démontrer, le nombre total de chrétiens et de musulmans ayant réussi au concours lors des sessions (1998-2015) est de 23 juges, et la répartition des musulmans du total des diplômés de l’IEJ depuis sa première session après la dernière fournée de diplômés en 2021 sera comme suit : 12 sunnites / 12 chiites / 4 druzes. Nous nous contentons de signaler ce fait sans nous risquer à tirer de conclusion.
En revanche, en ce qui concerne la répartition par genre des postes de juges, il ressort que l’entrée des femmes à l’Institut a connu une évolution depuis le début de ce siècle. Alors que les hommes étaient majoritaires lors des différentes sessions jusqu’en 2003, celle de 2004 a connu un changement significatif, avec la réussite de 7 femmes pour un seul homme. En 2021, à l’issue de la dernière promotion, un total de 36 femmes seront juges diplômées de l’Institut, contre 29 hommes.

commentaires (0)
Commenter