A l’orée du vingt et unième siècle, sept villages du Akkar (Akroum, Kfartoun, Qanayé, Mounsa, Mrah el-Khaoukh, al-Bassatine et al-Sahlé), comptant au total près de 18.000 habitants, ne sont toujours pas approvisionnés en eau potable courante. Ployant sous une pauvreté chronique qui ne leur laisse que des moyens rudimentaires de subsistance, les habitants de ces localités — situées dans la région de Jabal Akroum — sont obligés de transporter à dos de mulet l’eau potable vers leurs logements. Pour ce faire, ils doivent parcourir, accompagnés de leurs ânes et munis de leurs bidons, une distance de trois kilomètres pour atteindre un réservoir d’eau qu’ils ont eux-mêmes construit, à leurs frais, afin d’y emmagasiner l’eau de la source dite «Aïn Sabeh». Notre correspondant dans la région, Michel Hallak, rapporte qu’avant la construction de ce réservoir, il fallait parcourir cinq kilomètres pour accéder à l’eau de la source en question.
Ironie du sort: à l’époque de l’empire romain, des canalisations en terre cuite avaient été construites dans cette même région du Akkar afin de transporter, sur une distance de cinq kilomètres, l’eau potable de Nabeh el-Harik jusqu’à la citadelle de la localité d’Akroum. A l’époque des Romains, cette région était ainsi plus développée et mieux nantie en matière d’approvisionnement en eau qu’elle ne l’est actuellement.
Depuis près de 30 ans, les responsables qui ne succèdent au pouvoir s’engagent à effectuer les travaux nécessaires afin de canaliser les eaux de Nabeh el-Sabeh. En 1994, le ministère des Ressources hydrauliques et électriques avait effectué les études requises afin d’éxécuter ce projet et assurer l’approvisionnement des villages déshérités de Jabal Akroum en eau potable. Un don avait été octroyé à cette fin par l’Arabie Séoudite. Les travaux prévus (qui devraient s’étaler sur deux ans) englobent la construction de stations de pompage, de canalisations, de puits artésiens et de plusieurs réservoirs.
En 1994, le coût de ces travaux avait été estimé à 6 milliards de livres libanaises. Ce coût s’élève aujourd’hui à 7 milliards de L.L.. Mais la concrétisation de ce projet se fait toujours attendre en dépit des belles promesses prodiguées par les responsables. Le recours au transport de l’eau à dos d’âne est jugé sans doute plus économique.

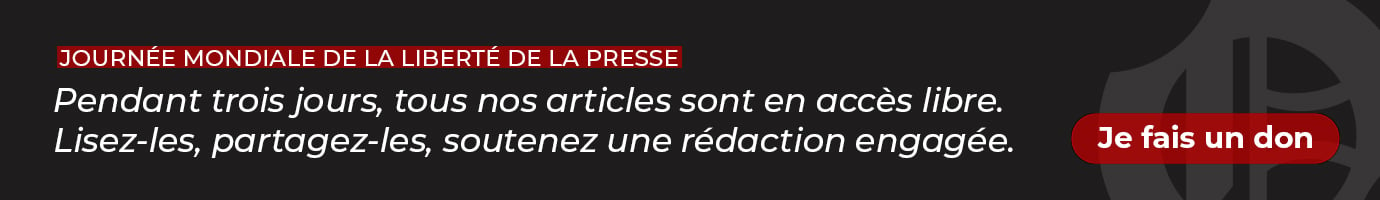
Les plus commentés
Après Bou Saab, Alain Aoun : la démarche de limogeage mise sur les rails
Oussama Hamdane : Nous avons accepté l’accord de trêve sans renoncer à nos constantes
Billets froissés, déchirés ou tachés : ces dollars dont personne ne veut au Liban