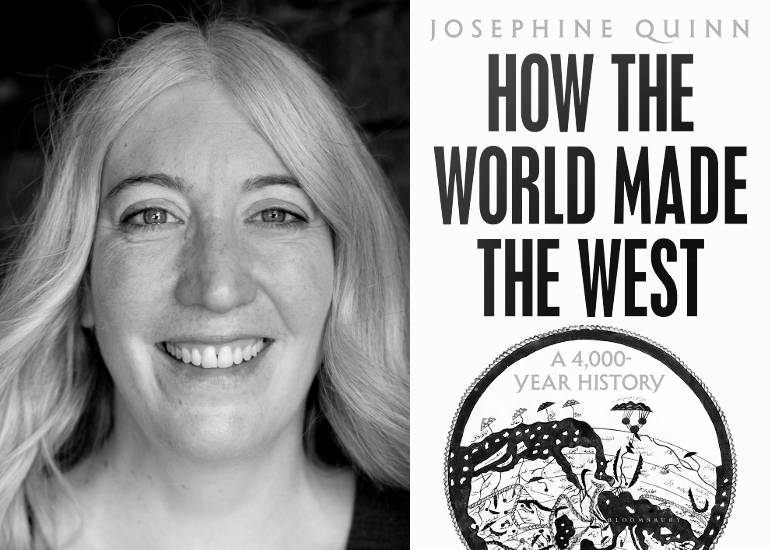
D.R.
Dans son précédent ouvrage qui a remporté une reconnaissance mondiale, Joséphine Quinn s’était lancée dans une quête des Phéniciens qu’elle avait finalement jugés introuvables. Elle s’est distinguée par sa brillante déconstruction de l’idée préconçue des Phéniciens en tant que « nation antique », démontrant qu’il s’agissait, dans un premier temps, d’une projection des Grecs sur ceux venant de la côte levantine, ainsi que d’un « mythe d’origine » entretenu à Carthage lors de son essor. Cependant, dans son œuvre actuelle intitulée How the World Made the West, on pourrait dire que Quinn est en train de phéniciser l’histoire de notre planète : elle n’accepte rien d’autre que de voir congédier une fois pour toutes le concept de « civilisations » et entend le substituer systématiquement par une histoire faite d’interactions et de connexions, de diffusion et d’échanges.
L’archéologue britannique part d’une vision du monde antique dès l’âge de bronze comme d’un patchwork de petits royaumes s’influençant mutuellement dans des liens de vassalité changeante. Elle entend ainsi bouleverser de manière définitive toute « perspective civilisationnelle » qui promeut l’idée d’un système de cultures partagées et distinctes de leurs voisines. Selon elle, la réalité historique réside dans le fait que les distinctions émergent à une échelle plus restreinte et humaine, exploitant des ressources venues d’ailleurs. Alors que la perspective civilisationnelle tend à appréhender un espace géoculturel en observant ce qui est en vigueur notamment dans son centre puis dans son ampleur, Quinn affirme que les nouvelles idées et innovations émergent rarement du centre d’un système, mais plutôt aux frontières de structures plus vastes, en communication avec des individus et des collectivités jouissant d’un moindre contrôle sur leur vécu ou leur circulation. Contrairement à la logique des « civilisations » en tant que bastions autosuffisants d’amélioration de soi, ce sont ceux qui pullulent en périphérie, moins enclins à rester attachés à leurs habitudes et ayant davantage à gagner, qui peuvent plus aisément opérer des changements.
Quinn rappelle que si de nos jours, prévaut en Occident une certaine vision de la Grèce comme marquant le début de la culture policée, de la philosophie et même de l’historiographie, les anciens Grecs eux-mêmes percevaient les choses différemment. De leur point de vue, ils se situaient à la fin de traditions étrangères beaucoup plus anciennes : Platon attribuait aux Égyptiens l’invention des mathématiques, de la géométrie, de l’astronomie et de la littérature, tandis qu’Hérodote rapportait les origines en Égypte, d’une grande partie du panthéon grec et de la culture religieuse, avec des degrés variables de plausibilité. Les auteurs grecs s’intéressaient particulièrement aux liens avec les Phéniciens, qui sont systématiquement dépeints comme des voisins, des enseignants et même des ancêtres : c’est que la pureté ethnique avait rarement la valeur dans l’Antiquité que lui sera accordée dans les temps modernes. « Ces Grecs antiques insistaient sur le fait que les Phéniciens ont colonisé la mer Égée, fondant des établissements sur plusieurs îles. Et ils racontaient des histoires particulièrement vives sur les enfants tyriens du roi Agénor, des princes et des princesses qui entourent cette mer dans un diamant d’origine phénicienne légendaire. »
Au début du VIIe siècle, les auteurs grecs considéraient les murailles environnantes comme un élément standard au sein de toute communauté politique digne de respect, une perception largement influencée par les paysages urbains entourant les ports levantins. Beyrouth et d’autres cités avaient déjà érigé des fortifications dès le Xe siècle, tandis que Beyrouth, Tyr et Sidon présentaient tous des nécropoles situées en périphérie. De surcroît, selon Quinn, les établissements levantins offrent des modèles pour le « partenariat des citoyens dans une constitution », soit dit en d’autres termes, pour l’émergence de la démocratie en Grèce.
Quinn avance ainsi à travers un récit embrassant quatre millénaires d’histoire mondiale, attestant d’un travail d’érudition exceptionnel visant à s’approprier l’histoire de longue durée chère à Fernand Braudel, tout en déliant cette histoire de son cadre braudélien, à savoir « la grammaire des civilisations » conçue comme des interactions entre des espaces dotés de frontières, bien que perméables, et chacun développant une continuité propre, une physionomie et un imaginaire distincts. Si le travail de Quinn est remarquable pour son développement de l’importance de la connexion et de la circulation, et si elle a raison de ne pas limiter les antécédents de l’Occident à l’intersection entre l’héritage gréco-romain et le legs judéo-chrétien, mais plutôt d’étendre la dette de cet Occident au monde méditerranéen antique dans son ensemble ainsi qu’à une histoire hellénistique s’étendant du Nil jusqu’à l’Indus, on peut toutefois se demander si Quinn ne sous-estime pas quelque peu les craintes, les méfiances et les périodes de repli qui ont émaillé l’histoire. De plus, on peut se demander si le prisme adopté par l’archéologue est fonctionnel à tous les niveaux pour interpréter une histoire où la connectivité n’a jamais été constante ni uniforme d’une époque à une autre, et d’un lieu à un autre.
How the World Made the West de Joséphine Quinn, Random House, 2024, 592 p.
commentaires (0)
Commenter