
Le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et l’ancien président, alors chef du CPL, Michel Aoun, lors de la signature de l’accord de Mar Mikhaël en février 2006. Photo d’archives L’OLJ
À présent que la page du mandat du président Michel Aoun est tournée laissant la place à une crise présidentielle dont le Liban est coutumier, il est bon de s’interroger sur le type de gouvernance qu’aura représenté le aounisme. Inauguré après une vacance au sommet de l’État qui aura duré près de deux ans, le mandat présidentiel qui échut en 2016 au général Michel Aoun, à la trajectoire politique oblique, fut le résultat d’un travail abrasif, de sape et de blocage institutionnel. Lié au « parti de Dieu » par un accord signé dix ans plus tôt avec le chef de la milice chiite, le destin du fondateur du Courant patriotique libre (CPL) fut ainsi porté par l’opiniâtre volonté d’une milice en mal de légitimité institutionnelle.
Rien, en effet, ne pouvait laisser présager qu’un général de brigade, autrefois proche de Bachir puis d’Amine Gemayel, et ayant été renversé de la présidence du Conseil des ministres par l’occupant syrien contre lequel il avait déclenché une « guerre de libération », puisse, un quart de siècle plus tard, se frayer un chemin vers le sommet de l’État. A fortiori après deux visites à Téhéran puis Damas à son retour d’exil, et en se posant en tant que protecteur et garant de la ligne défendue par le Front du refus constitué par ces deux capitales et ordonnancée sur place par un clerc exalté. L’élection au forceps du général Aoun doit plus à la couverture institutionnelle qu’il offrait qu’à l’orientation politique jamais élucidée qui fut la sienne.
De ce fait, son parcours restera singulier. S’il a pu s’inscrire un moment dans le cadre classique du maronitisme indépendantiste, par la suite, l’alignement de Michel Aoun sur des positions régionales intransigeantes et en contradiction frontale avec les amitiés traditionnelles du pays ne laisse pas d’intriguer. S’il explique une partie des choses, le poids de l’environnement régional n’explique cependant pas tout. Deux anciens présidents de la République (Élias Hraoui et Émile Lahoud), placés par la Syrie dans l’immédiat après-Taëf, avaient, certes, choisi de collaborer pour mieux tempérer les prises de position que leur imposait le procurateur syrien au Liban. Avec le général Aoun, c’est l’inverse qui s’est imposé… De sorte qu’à la fin de son mandat, il ne laisse qu’un État en friche où ne règne qu’un seul maître. Un appareil administratif parasite aura phagocyté l’administration publique, une milice se sera imposée à l’armée et, sur les décombres de la République, prospère à présent un État de l’ombre… Comment expliquer qu’un président, doté au départ d’une assise populaire enviable en milieu chrétien, adulé et auréolé de la gloire de la résistance à l’occupation, en soit arrivé à faire jouer à son pays le rôle de supplétif, à peine déguisé, d’un État étranger déployant au vu et au su de tous une présence massive par le biais d’une organisation armée ?
Traits similaires
En réalité, le contrat de gouvernement établi entre le Hezbollah et le CPL était dans la nature des choses. En effet, en dépit de leurs implantations communautaires différentes et de leurs orientations idéologiques a priori opposées, les deux partis partagent des traits politiques étonnamment similaires.
En premier lieu, ils ont réussi à s’imposer au sein de leur milieu communautaire respectif comme des forces dominantes. Le Hezbollah, à la faveur de son succès dans la libération du Sud libanais, a fait l’unité de la communauté chiite autour de lui. Il a arrimé solidement le parti Amal autour de son leadership et, à eux deux, ils ont achevé de marginaliser les anciennes notabilités communautaires. À sa manière, le général Aoun s’est progressivement imposé comme le chef d’un parti majeur au sein de sa communauté confessionnelle. En rupture de ban avec les Forces libanaises qu’il a combattues par les armes, en opposition avec le patriarcat maronite lors de l’adoption de l’accord de Taëf, le général Aoun a lui aussi, pour le moins, bousculé le camp chrétien et a réussi, en se plaçant à la tête de l’État, à placer son mouvement au centre du jeu politique national. Gouvernant en tandem, le Hezbollah et le CPL ont réduit le champ de manœuvre des forces établies de leurs communautés et ont su se rallier un public nouveau galvanisé par un discours de rupture.
Le deuxième trait caractéristique de la conduite politique de ces deux partis est, de fait, leur utilisation abondante d’un discours qui se situe en décalage par rapport au langage convenu nourri au lait du consensualisme et rompu à l’usage des mots fétiches des sociétés dites de pacte national. Pour le Hezbollah, c’est le vocable de « résistance » qui devient la référence suprême dans sa pyramide des normes. Le secrétaire général du parti en dicte le sens. C’est lui qui en a l’usage à l’instar d’une marque déposée. Lui encore qui en fixe les contours au point d’en faire l’unité de mesure du patriotisme ou de la traîtrise. Quant au discours aouniste, supposé inspirer une politique « différente », il a sans cesse oscillé entre une insistance sur le renforcement et la modernisation des institutions, voire la transformation du Liban en État civil, et une revendication de recouvrement des droits des chrétiens spoliés par l’accord de Taëf. On serait bien en peine de dessiner le fil de continuité qui lie les thématiques du « aounisme de gouvernement ». Ne subsiste que la volonté de maintenir une image protectrice d’un « père » de la nation, équanime et impartial, soucieux du bien de tous, mais que démentent des sorties incontrôlées et une certaine distance face au malheur des citoyens.
Enfin, ce qui achève de brosser le tableau de la similarité entre les deux formations politiques est leur manière de passer outre les institutions et de s’adresser directement à la population. Ces pratiques définissent le populisme qui est précisément le fait de contourner les instances établies de prise de décision dans les régimes parlementaires et de leur substituer une interaction directe avec le « peuple ». Le premier s’adresse ainsi régulièrement à la société libanaise et, par-delà, à la « oumma » tout entière (sans distinctions confessionnelles) pour énoncer des considérations sur l’actualité et orienter le débat public à l’instar d’un guide suprême. Le second avait l’habitude de saluer, en début de discours lors de rassemblements militants de soutien, le « grand peuple du Liban ». L’adresse venait ensuite pour assurer que le pays était tenu et dirigé selon une guidance attentive. Dans ce type de relation que le chef charismatique entretient avec le peuple, les références au rôle des institutions paraissent secondaires. Ce sont là des variables que des responsables jouissant de la confiance populaire ajustent à leur guise. Dès lors, pourquoi les mentionner ? ! L’essentiel est de river les foules à l’écoute de propos hallucinés et d’explications infantilisantes tirées de garde-meubles nationalistes, guerriers ou cléricaux encombrés. Tel dans les régimes fascistes, un décorum de rassemblement ou de procession quasi sacral – de sacralité assumée en ce qui concerne le Hezbollah – parachève le caractère mystique de la harangue du chef à « son » peuple.
Philosophie du ressentiment
Pour autant, tel est l’improbable attelage qui a tiré le char de la République libanaise durant les six dernières années. Ce n’était pas là à proprement parler un gouvernement des égaux. C’était une alliance asymétrique dans laquelle l’un des alliés poursuivait son ample stratégie à déclinaison régionale que l’autre couvrait par une politique de la feuille de vigne. À l’un la direction, à l’autre la représentation, et aux deux, ainsi qu’à leurs affidés, les retombées et les prébendes.
Plus profondément, on peut penser que l’affinité élective qui liait les deux formations trouvait ses racines dans une même philosophie du ressentiment. De fait, les deux alliés poursuivaient des rêves de revanche sur leur histoire passée. La formation chiite, avec son allié, tendait à effacer son passé perçu de communauté marginalisée, laissée pour compte par les élites au pouvoir issues du pacte national. Sa rivalité, pour mieux assurer sa domination, est avec les chrétiens qu’elle divise et instrumentalise, avec les sunnites qu’elle enfonce et avec les druzes qu’elle observe. Le aounisme est, lui aussi, fils du ressentiment. Généré dans la défaite et l’exil de son fondateur, frustré d’une victoire contre la Syrie qui finit par se produire sans lui, celle-ci retirant ses troupes du Liban du fait du choc provoqué par l’assassinat de Rafic Hariri, le aounisme souffre originellement de cette non-reconnaissance de l’importance de son rôle par les fils de sa communauté. Son problème n’est pas avec les autres communautés mais avec la sienne propre, la chrétienne, dont une partie l’a combattu, ignoré et l’aurait empêché de gouverner. Mais si les deux formations se ressentent de « l’ingratitude » des Libanais qui n’ont pas su reconnaître leurs sacrifices, leur tonalité psychologique est différente : le revanchisme des formations chiites est volontariste, optimiste et de conquête ; le aounisme, lui, est mortifère. Il s’alimente des espérances déçues du petit peuple chrétien, victime selon lui d’ostracisme et de complots que le général, son gen dre et son parti ne cessent courageusement de combattre.
Reste, en définitive, le bilan du mandat. Il est en forme de désastre systémique, d’ampleur inédite pour le pays. Trois catastrophes majeures le dominent. La crise financière et l’effondrement bancaire, avec la misère sociale et les souffrances indicibles infligées à une population accablée par des responsables irresponsables ; l’explosion au port et les odieuses gesticulations et manœuvres pour étouffer toute investigation concernant son origine et ses causes ; et la vague submersive de réfugiés syriens dans les villes et les villages libanais.
Certes, on dira, à juste titre, que de tout cela, le aounisme n’est pas l’unique responsable. Mais la corruption, la gabegie, le laisser-faire, le dysfonctionnement institutionnel et l’absence de réaction, la démission et le blocage de l’État, l’étouffement des réformes et des revendications démocratiques sont des causes subtiles et sournoises d’assassinat d’un peuple. Une complicité coupable peut aussi couvrir par son inaction des pratiques qui conduisent au naufrage de la démocratie. Ou couvrir tous ceux qui pensent, selon une formule éculée, que le meilleur moyen de résoudre les questions est de faire taire ceux qui les posent.
Par Joseph MAÏLA. Professeur de relations internationales à l’Essec (Paris). Ancien recteur de l’Université catholique de Paris et ancien vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’USJ.

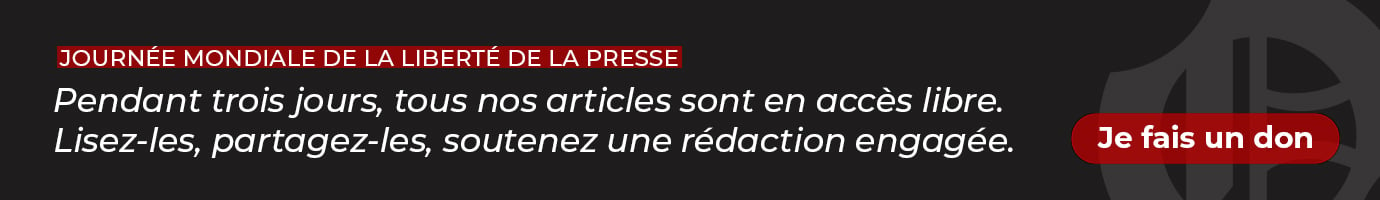
commentaires (27)
Bravo M. Maila, vous avez eu le courage de nommer les crimes contre la nation, par leurs noms et leurs auteurs. Comme vous avez vos entrées au Quai d'Orsay, vous pourriez envoyer cette analyse à M. Le Drian -qui ne semble pas vous avoir consulté- et à son président girouette qui ne trouve pas la direction du bon vent pour venir en aide au Liban.
GM92190
14 h 13, le 29 août 2023