Pour le régime de Bachar el-Assad, les rebelles sont désignés comme « terroristes ». Khalil Ashawi/Reuters
Le terme « terrorisme » est utilisé ces jours-ci par tous les acteurs engagés dans la lutte contre les jihadistes de l'État islamique (EI) mais avec un sens et des arrière-pensées bien différents selon qu'il est prononcé à Washington, Damas ou Téhéran.
Le mot « est tellement utilisé qu'il est devenu aujourd'hui synonyme de ''mon ennemi'' », explique à l'AFP Marc Sageman, ancien analyste de la CIA, psychiatre et auteur de plusieurs livres sur ce sujet. « Chacun voit les choses de son point de vue : ce que l'un considère comme un combattant de la liberté est classifié par un autre comme un terroriste. » Ainsi, la conseillère du président syrien Bachar el-Assad, Bouthaina Chaabane, a estimé que son pays aurait dû être associé aux efforts internationaux contre les jihadistes car il est une « victime du terrorisme depuis quatre ans », date du début du soulèvement populaire contre le régime en mars 2011. A contrario, la coalition de l'opposition syrienne accuse le régime de Damas d'être un « État terroriste » et d'avoir favorisé l'éclosion des mouvements jihadistes pratiquant les pires exactions.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé de son côté que son pays ne menait pas une guerre contre l'EI mais « une vaste action d'antiterrorisme ».
Dans le même temps, à Téhéran, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian déclarait que « la meilleure façon de lutter contre le terrorisme » était « d'aider les gouvernements irakien et syrien qui luttent de manière sérieuse contre le terrorisme ».
« Le mot terroriste est devenu subjectif. Le fait que l'Onu a passé des dizaines d'années à tenter d'arriver à un accord sur une définition montre la nature très controversée du concept », souligne Sarah Marsden, maître de conférence au Centre Handa pour l'étude du terrorisme (CSTPV) à l'Université Saint Andrews en Écosse. L'Onu a cherché depuis 1972 à établir une définition de ce terme sans y parvenir. Elle a adopté 13 conventions sur la lutte contre le terrorisme depuis 1996 sans jamais parvenir à un traité global à cause des divergences.
(Lire aussi : L'État islamique, ce mouvement qui sème la terreur et fascine les jihadistes)
Depuis le 11 septembre
Le mot « terrorisme » est né en 1790 durant la Révolution française pour dénigrer Maximilien Robespierre qui envoyait à la guillotine ses adversaires durant la Terreur. Il a toujours eu un sens péjoratif, et seuls les anarchistes russes qui assassinèrent le tsar Alexandre II en 1881 ont revendiqué fièrement le titre de « terroristes ». Son emploi est resté longtemps limité. Au début du XXe siècle, les Français en Syrie comme les Italiens en Abyssinie traitaient les rebelles de « bandits » tandis que les communistes russes qualifiaient leurs adversaires de « saboteurs ».
L'historien du Maghreb Benjamin Stora rappelle que les militaires français appelaient les indépendantistes en Algérie « rebelles » ou « fellaghas », un terme désignant « les coupeurs de routes ». Le terme « terroriste » est entré dans le vocabulaire journalistique français pendant la bataille d'Alger de 1957. Il a ensuite servi à qualifier l'Organisation de l'armée secrète (OAS), favorable à l'Algérie française.
Durant la guerre du Vietnam, les Américains appelaient les Vietcongs par les initiales VC, tandis que les régimes militaires d'Amérique latine des années 1970 parlaient de « subversifs » en référence aux guérilleros.
Pour Sarah Marsden, le label « terroriste » s'est véritablement imposé internationalement après les attentats du 11 septembre 2001. « C'est devenu un terme générique pour designer les ennemis de toute sorte ». Il est ainsi employé en Afghanistan pour qualifier les talibans, par le gouvernement de Kiev pour parler des séparatistes et par Israël pour cibler le Hamas.
Illustrant la complexité du terme, le chef de l'opposition modérée syrienne, Ahmad Moaz al-Khatib, avait appelé en 2012 les États-Unis à revenir sur leur décision de placer les jihadistes d'al-Nosra sur la liste des organisations terroristes, estimant qu'ils étaient des combattants efficaces contre le régime.
Pour Jens David Ohlin, professeur à l'école de droit Cornell, dans l'État de New York, les dirigeants auraient tout intérêt à se montrer le plus précis possible. « Les États-Unis doivent faire attention à ne pas définir le conflit actuel comme un conflit contre l'islam et même contre l'islam radical. Car cela risque d'aliéner beaucoup de monde. Il faut mieux déterminer l'ennemi en faisant référence aux noms spécifiques des groupes comme el-Qaëda ou l'État islamique ».
Lire aussi
À Paris, la communauté internationale promet « bien plus que des frappes » contre l'EI...
Obama, à qui perd gagne, le point de Christian Merville
Repères
Tout ce qu'il faut savoir sur l'État Islamique
Offensive des jihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie : les dates-clés
Le mot « est tellement utilisé qu'il est devenu aujourd'hui synonyme de ''mon ennemi'' », explique à l'AFP Marc...

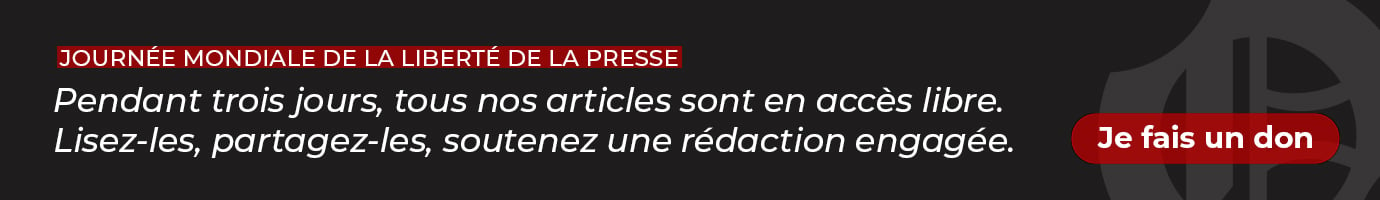
commentaires (4)
les plus grands spécialistes et connaisseurs en terrorisme au Moyen-Orient sont les "moukhabarat" frérotes. Je me permets de suggérer à l'AFP d'aller faire un reportage, basé sur les témoignages du Syrien Ali Mamlouk et du Libanais Michel Samaha.
Halim Abou Chacra
12 h 57, le 16 septembre 2014