Actualités - CONFERENCES ET SEMINAIRES
Conférence - Exposé du célèbre journaliste américain sur la globalisation Thomas Friedman : le plus rapide dévore le plus lent
Par J. Je, le 12 juillet 2000 à 00h00
C’est une intervention remarquée qu’a faite hier le célèbre journaliste américain, Thomas Friedman, de passage à Beyrouth après une brève visite en Égypte. Invité par l’ambassade des États-Unis, l’éditorialiste du «New York Times» a parlé une heure et demie durant de la globalisation, un thème d’actualité, qui a fait l’objet de nombreuses analyses et spéculations. Avec Thomas Friedman, le message passe différemment : métaphores et humour à l’appui, il a brillamment réussi à captiver son public autour d’une question complexe dont les répercussions n’ont pas fini de transformer les sociétés du monde. Se fondant sur son dernier ouvrage The Lexus and the Olive Tree, (La Lexus et l’Olivier), en allusion à la production des voitures japonaises et au conflit israélo-palestinien, le journaliste explore le nouvel ordre économique que génère la globalisation, égrenant une série d’images puisées dans la réalité de tous les jours. Celle-ci l’a souvent mené aux quatre coins du monde, dont le Proche-Orient où il a vécu une longue et enrichissante expérience dans les années 80. «La meilleure façon de comprendre la globalisation est de la comparer au système de la guerre froide, dit Thomas Friedman. Ce dernier était fondé sur l’ idée de la division, et il s’agissait alors de savoir qui était du côté de qui. Cette époque avait pour symbole la guerre alors que la globalisation est fondée sur l’idée de l’intégration à un moment où les gens sont connectés les uns aux autres, le symbole étant le réseau Internet». Du temps de la guerre froide, poursuit le conférencier, deux hommes menaient le jeu, alors que maintenant personne n’est au gouvernail, et deux jeunes étudiants philippins peuvent dérégulariser tout le système en envoyant un virus sur le réseau qui va affecter des millions d’utilisateurs, dit-il en faisant allusion au fameux «Love Virus». Les temps ont bien changé, les critères de puissance et les outils également. Du temps de la guerre froide, c’était la force qui décidait, la grandeur du missile qui commandait. Avec la globalisation, c’est le modem le plus rapide qui s’impose. Par conséquent, le plus lent sera d’emblée éliminé, car c’est un système qui est fondé sur la promptitude par excellence. Citant, à titre humoristique, une conversation qu’il avait récemment eue avec un responsable égyptien, qui lui avait fait part de son souhait de «rattraper» le train de la globalisation, disant au journaliste : «Pourriez-vous seulement le ralentir un peu ?». «Je voudrais bien, lui avait répondu Thomas Friedman, sauf que là, il n’y a pas de conducteur». Bref, deux systèmes absolument différents, insiste à dire le journaliste, une différence qui est clairement illustrée par la manière dont le pouvoir est structuré au sein de ces deux systèmes. Alors que durant la guerre froide, le système reposait sur le concept de l’État-nation, le phénomène de globalisation a engendré un système où il existe trois piliers (qu’il a appelés balances), ce qui rend la situation encore plus complexe, dit-il. Tout d’abord c’est la balance d’État à État, telle qu’elle existait à l’époque de la guerre froide, à savoir l’Iran servant de contre balance à l’Irak, ou les États-Unis à la Russie, le Japon à la Corée, etc. En second lieu, et là réside la nouveauté, «c’est la balance entre les États et les “supermarchés” (un terme propre à lui) qui sont les 25 plus grandes sociétés financières au monde et qui sont devenues aujourd’hui des acteurs géopolitiques autonomes, indépendants des États et dans certains cas, bien plus puissants que les États eux-mêmes», souligne-t-il en rappelant que c’était précisément les «supermachés» qui avaient réussi à évincer le président indonésien Suharto il y a quelques années. En troisième lieu, viennent «les États et les personnes extrêmement puissantes». «Vous et moi pouvons un jour devenir potentiellement puissants et pouvons directement agir sur la scène internationale, sans passer par l’intermédiaire d’un État», avance Thomas Friedman en donnant l’exemple de Jodie Williams, qui avait obtenu le prix Nobel pour avoir créé un mouvement pour l’interdiction des mines sur réseau Internet. Mais parmi les personnes extrêmement puissantes, «il existe les bons et les mauvais». Et le journaliste de donner l’exemple d’un Ben Laden «qui a déjà fait sauter deux ambassades américaines» et qui a monté son propre réseau, «une sorte de “Jihad on line”». «En guise de réponse, les États-Unis ont tiré sept missiles Cruise d’un million de dollars chacun sur une seule personne, souligne le journaliste sur un ton ironique. C’est l’exemple type d’un État contre une personne extrêmement puissante, de surcroît, animée de mauvaises intentions». Et M. Freidman d’ajouter : «Le plus inquiétant dans tout cette affaire n’est pas le fait que des types comme Oussama Ben Laden ou Ramzi Youssef ( un autre terroriste) représentent une menace permanente, mais la question est de savoir combien il en existe dans le monde».
C’est une intervention remarquée qu’a faite hier le célèbre journaliste américain, Thomas Friedman, de passage à Beyrouth après une brève visite en Égypte. Invité par l’ambassade des États-Unis, l’éditorialiste du «New York Times» a parlé une heure et demie durant de la globalisation, un thème d’actualité, qui a fait l’objet de nombreuses analyses et...



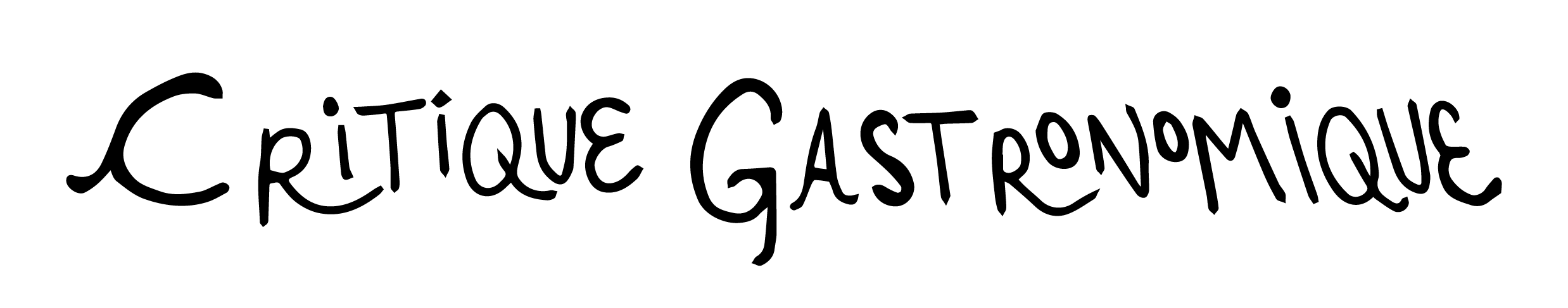
Les plus commentés
Le professeur en pédiatrie Robert Sacy emporté par une crise cardiaque
La comédienne Shaden Fakih accusée de « blasphème » par Dar el-Fatwa
Oui, non, peut-être ? Comment le Liban a répondu à la feuille de route française