Actualités - OPINION
Le mur du silence
Par Issa GORAIEB, le 20 avril 2000 à 00h00
Bien mal accueillis par les inconditionnels de l’alignement sur Damas, les derniers propos du ministre français de la Défense, qui ont été endossés et même propagés par le Quai d’Orsay, traduisent une nette évolution, du moins dans sa formulation officielle et publique, de la politique proche-orientale de Paris : évolution qu’annonçaient déjà, il est vrai, la «bombe Jospin» de février et d’autres déclarations ministérielles plus récentes. En affirmant sur les ondes de France-Inter que la Syrie rejette toute solution susceptible de remettre en cause sa domination sur le Liban, quand bien même elle lui restituerait le Golan, M. Alain Richard a très peu diplomatiquement dévoilé en fait ce qui, dans les couloirs des chancelleries, est secret de Polichinelle. Pour le monde entier, l’«influence» syrienne au Liban, pour reprendre le terme consacré, est depuis longtemps devenue une évidence géopolitique, une de ces incontournables réalités qu’il serait tout à la fois lassant, périlleux et parfaitement inutile de contester : ce confort moral, la communauté internationale se le procure à bon prix, sous la forme de routinières proclamations d’attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de notre pays. Depuis la fin des années 80, la France elle-même a dû sacrifier à ce morne rituel, renonçant avec soulagement ainsi à une fort coûteuse compétition, paraissant s’accommoder du fait accompli, multipliant les marques d’égard pour Damas jusque dans ses démarches et initiatives les plus étroitement «libanaises». La France serait-elle en train de revenir peu à peu à l’ère de l’émulation, sinon de la confrontation ? Ne fait-elle qu’apporter sa contribution à la campagne de pressions initiée par les États-Unis, au lendemain de l’échec du récent sommet américano-syrien de Genève ? Son actuel franc-parler s’explique-t-il plutôt par la quasi-certitude que du train où vont (ou ne vont pas) les choses, le Liban, qu’elle porta sur les fonts baptismaux, est voué à faire les frais d’un arrangement contre nature d’une paix scélérate, avec l’assentiment du Ponce Pilate américain ? En attendant que soient apportées des réponses à ces angoissantes questions, force est de constater objectivement que dans l’ordre des priorités syriennes, la question territoriale, malgré son extrême importance, est loin de prévaloir sur ces deux dossiers proprement capitaux que sont la stature régionale à laquelle aspire la Syrie et la continuité de son régime. Non point évidemment que Damas soit disposé à renoncer au moindre pouce de territoire s’il obtient les assurances recherchées par ailleurs : en exigeant un impossible compromis, en chicanant à la Syrie quelques centaines de mètres, en la rendant responsable de l’impasse actuelle, Israéliens et Américains font preuve, en fait, d’une surprenante méconnaissance psychologique et politique de son chef, le président Hafez el-Assad. Comment en effet le Raïs syrien, qui détenait le portefeuille de la Défense durant la guerre de 1967 ( il devait renverser peu après le gouvernement radical et aventureux de l’époque ), pourrait-il se satisfaire d’une revanche incomplète sur l’histoire militaire de la région ? Comment l’homme qui a longtemps incarné l’irrédentisme arabe pourrait-il accepter un règlement moins avantageux que celui décroché, il y a plus de deux décennies déjà, par l’Égyptien Anouar Sadate ? À cela s’ajoute le fait que la libération du Golan ne revêt aucune espèce d’urgence politique ou militaire pour les Syriens, qui ne cessent de claironner d’ailleurs qu’ils ont tout le temps pour eux : un temps habilement employé à consolider leur présence au Liban, présence d’autant plus vitale pour cette fameuse envergure régionale que Damas s’est laissé dessaisir, au fil des ans, de ses autres cartes, palestinienne et jordanienne. On peut dès lors présumer que dans la dure partie d’échecs qui se joue aujourd’hui, la négociation porte au moins autant sur ce statut spécial de la Syrie que sur le tracé des frontières, que l’on croyait pratiquement résolu depuis l’éphémère reprise fin 1999, après trois ans d’interruption, des pourparlers de paix syro-israéliens. Les dernières prises de position françaises pourraient traduire, par ailleurs, une volonté d’interpellation de l’État libanais pour l’inciter à gérer de manière responsable et crédible la délicate situation que va créer le retrait israélien annoncé du Sud. À Beyrouth qui ne jure que par l’unité des deux volets, et qui va jusqu’à entretenir délibérément le doute sur le maintien de la sécurité à la frontière, Paris veut vraisemblablement signifier que si la guérilla devait se poursuivre – pour le seul Golan cette fois – et si Israël devait riposter massivement, même les plus proches amis du Liban ne pourraient se porter à son secours. Reste à savoir quelle suite l’État veut ou peut donner à cette sorte de messages. Les autorités sont trop absorbées en effet par des questions autrement importantes pour prendre le temps de répondre aux légitimes interrogations des citoyens. Comme d’avancer éventuellement la date de ces élections dont la seule perspective, et plus précisément la petite cuisine à fabriquer les tickets gagnants, a étendu à la classe politique tout entière l’assourdissant silence des agneaux. Comme de s’acharner, avec autant de sauvagerie que de balourdise, sur une poignée d’étudiants ; qui, eux, avaient quelque chose à dire.
Bien mal accueillis par les inconditionnels de l’alignement sur Damas, les derniers propos du ministre français de la Défense, qui ont été endossés et même propagés par le Quai d’Orsay, traduisent une nette évolution, du moins dans sa formulation officielle et publique, de la politique proche-orientale de Paris : évolution qu’annonçaient déjà, il est vrai, la «bombe...



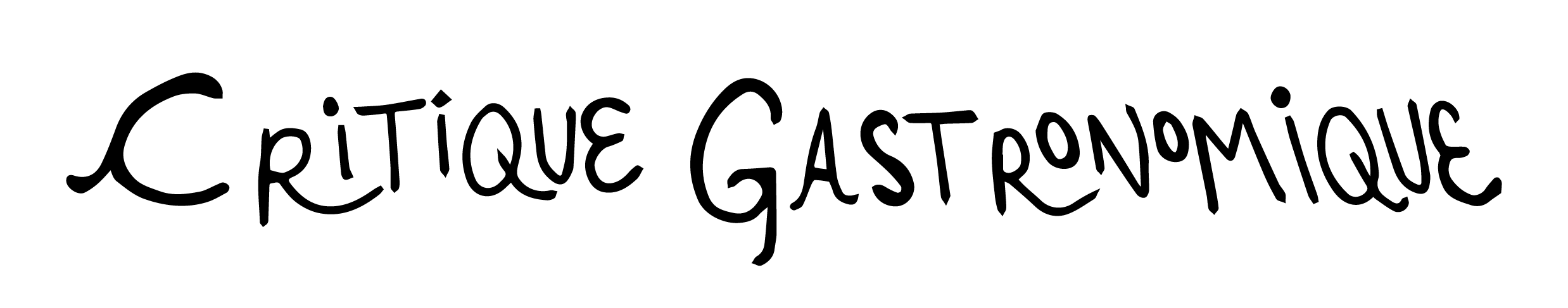
Les plus commentés
La comédienne Shaden Fakih accusée de « blasphème » par Dar el-Fatwa
Le professeur en pédiatrie Robert Sacy emporté par une crise cardiaque
L’Eurovision, outil de « soft-power » préféré d'Israël ?