Actualités - CHRONOLOGIE
Exposition Frida Debbané et May Sobh, fantasmes et humour Quand deux artistes iconoclastes subliment le non-art
Par ABOUDIB FIFI, le 09 décembre 2000 à 00h00
Frida Debbané et May Sobh. Deux gros pavés dans la mare des artistes. Inqualifiables, inclassables. Elles font leur travail en douce. Mères de familles, doubles vies. Leurs cinq à sept, elles les passent à l’ombre de leurs ateliers. Escapades laborieuses, rencontres secrètes avec leur véritable ego. Là s’épanouissent leurs fantasmes, leur humour acide, des mondes tels qu’elles les auraient voulus. Dans ces moments-là, Frida s’improvise menuisière (au féminin depuis elle !), mercière, brodeuse, petite main – calleuse, à force ! –, musicienne, rêveuse professionnelle et surtout archiviste d’un imaginaire tactile, enfoui dans près de deux cents tiroirs sous forme de photos et de miniatures en tout genre. Cela s’appelle un délire organisé. Cette mémoire-là, à portée de tiroir, à fleur de plastique, de verre ou de bois, la déleste majestueusement de l’autre, celle qui vous noue le plexus de moins en moins solaire, celle qui vous revient sans crier gare, celle qui vous fait faire des choses à votre insu. Cela s’appelle une thérapie. Qui a dit que Frida n’est pas une artiste ? Journaliste, elle a manifesté un amour passionnel et absolu pour certaines œuvres faites par d’autres. Et puis elle a voulu, à partir des infiniment petits objets dont elle aimait s’entourer, se faire, à l’échelle, un univers respirable. Qui se souvient de Jinny, la petite fée en noir et blanc, télé des années 60, dans une carafe décorée comme un palais ? Aujourd’hui, c’est elle. Elle prend une photo. Prenez une photo. C’est là qu’elle voudrait être. Sur le Normandie, dans la savane, chez Hermès dont elle collectionne les carrés avec autant de passion que tout le reste, dans l’atelier de Picasso, dans une bibliothèque odeur de papier vieilli, dans un bar, chez un violoniste, dans une mercerie pour l’amour des couleurs, dans une chambre d’enfant envahie de nounours... et on en passe, il y en a plus de cinquante. Elle les met en boîte et selon le thème les encadre et y ajoute, puisant dans sa collection irremplaçable, des objets qui semblent alors tombés de là, sortis de là – quelqu’un a-t-il perdu quelque chose ? – Son petit violon, son petit bateau, son bout de ficelle, son doudou, son bout d’enfance. Ils sont là avec leur tendresse, leur goût de paradis perdu, et cela s’appelle de l’art, n’en déplaise aux grincheux de la profession. May Sobh, quant à elle, s’interroge sur la folie des femmes et la sagesse des vaches. Après une solide formation à la BUC (actuelle LAU), où elle s’est souvent distinguée (la modestie est la vertu des imbéciles), elle a eu des jumeaux et par la même s’est dédoublée, séparant en elle l’épouse-et-mère de l’artiste. Etait-ce son côté femme au foyer ? Elle s’est toujours intéressée au Functional Art , entendre l’art adapté aux objets quotidiens, à distinguer du design par son aspect exclusif. Tout est donc parti d’une réflexion sur un abat-jour. Qu’est-ce qui peut être à la fois rigide, résistant à la chaleur, suffisamment translucide pour laisser passer la lumière, un rien rugueux pour sculpter l’ombre, résistant pour durer longtemps, franchement blanc pour supporter la couleur, et parfaitement maniable dans un atelier dépourvu de fours sophistiqués et d’appareillages pointus ? Après plusieurs tentatives, c’est le plâtre médical qui s’est avéré le plus probant. Et tant qu’à soigner, c’est vers les bobos de l’âme et de l’humeur qu’elle l’a détourné. Faire rire. Pour en revenir à l’abat-jour, qu’est-il sinon un jupon ? Pour May, c’était l’évidence : un gros jupon de femme étêtée, écervelée, toute la lumière sous la jupe. Puis le jupon devint vase, soliflore à partir d’une éprouvette camouflée. Il a pris des couleurs de plus en plus vives, des couleurs sensuelles de fruits d’été. Il a reçu sur les bords des broderies minuscules, des perles et des paillettes. Et même deux petites boules tout en haut, attributs de séduction. Et puis il lui est poussé des jambes. De longues jambes de danseuse de tango géante avec les escarpins idoines. Cheveux noirs, buste banc, jupe carmin. La pose : suivez-moi jeune homme, pour l’éternité. On la ferait virevolter. Pour les vaches, le glissement était naturel. On s’arrache leur belle robe tachetée. On s’en ferait des pelisses entières. Étrange identification entre les femmes et les vaches. Et peut-être pas tellement pour le côté nourricier. Ça peut être gracieux, une vache. May Sobh le montre : elles ont les jambes fines autour des mamelles roses et de l’énorme panse haute-couture. La tête, toute petite. Sans ça, on ne verrait pas qu’elles en ont une. Une tête qui rumine . L’artiste leur donne aussi des jouets, des balles, les fait danser pour oublier la folie des hommes. On leur devait bien ça, aux vaches. May Sobh l’a fait. Avec sérieux, comme tout ce qu’elle fait. Les œuvres de May Sobh et de Frida Debbané seront exposées dès dimanche 10 décembre chez «La puce à l’oreille», Sodeco. Vernissage loufoque à prévoir. Fifi ABOUDIB
Frida Debbané et May Sobh. Deux gros pavés dans la mare des artistes. Inqualifiables, inclassables. Elles font leur travail en douce. Mères de familles, doubles vies. Leurs cinq à sept, elles les passent à l’ombre de leurs ateliers. Escapades laborieuses, rencontres secrètes avec leur véritable ego. Là s’épanouissent leurs fantasmes, leur humour acide, des mondes tels...



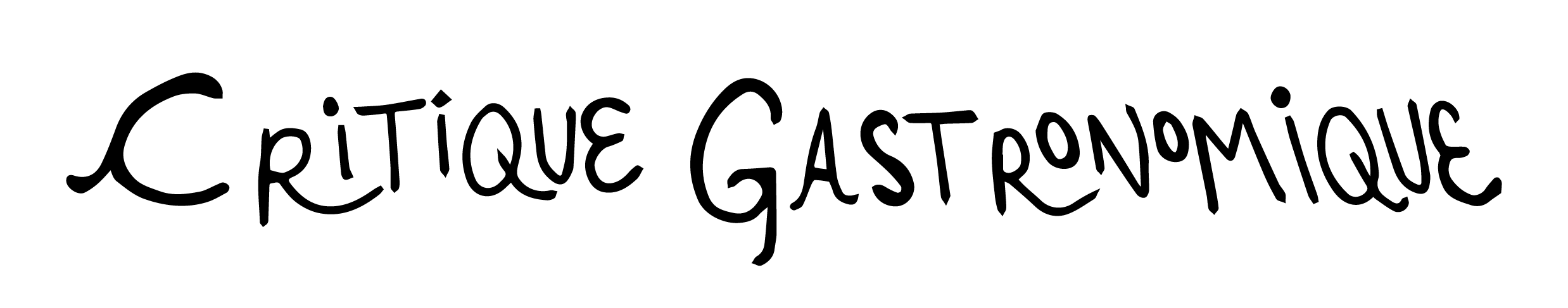
Les plus commentés
La comédienne Shaden Fakih accusée de « blasphème » par Dar el-Fatwa
Le professeur en pédiatrie Robert Sacy emporté par une crise cardiaque
L’Eurovision, outil de « soft-power » préféré d'Israël ?