Actualités - REPORTAGES
HISTOIRE - Une science qui avait atteint un stade avancé - II - Essais de synthèse de quelques éléments de médecine phénicienne
Par BOUSTANY Hareth, le 01 mars 2001 à 00h00
Il est difficile d’écrire actuellement une histoire de la médecine phénicienne ou cananéenne. Non seulement les études faites à ce sujet par les spécialistes sont pratiquement d’une portée tout à fait limitée, mais aussi, si l’on veut s’y intéresser de près, parce que les éléments sont épars ou non divulgués et les données rares et fragmentaires. (Voir L’Orient-Le Jour du 22 février). Certes, on peut résumer un telle histoire en disant qu’à l’époque classique, c’est-à-dire durant les quatre ou cinq siècles qui précèdent l’ère chrétienne, la médecine dans les pays de la Méditerranée orientale devait être à quelques nuances près partout la même. À Tyr, à Sidon, à Jbeil, à Arouad, comme à Thèbes, à Athènes et à Corinthe. Mais même pour l’époque classique, nous manquons de traités de médecine spécifiquement phénicienne, comme on en trouve par exemple pour l’école hippocratique. Toutefois, grâce à l’archéologie, nous avons aujourd’hui l’assurance que la science médicale avait atteint en Canaan un stade avancé et relativement perfectionné, au moins un millénaire avant l’époque classique, soit au XVe siècle avant Jésus-Christ. De plus, la Bible nous permet d’avoir certaines indications à ce sujet, un peu vagues et déformées il est vrai, mais suffisantes pour nous donner une idée relative sur la question. Il ne faut surtout pas penser que nous attribuerons aux Phéniciens ce qui revient aux Hébreux. Aujourd’hui, il ne fait plus de doute que les Hébreux ont presque tout emprunté aux Phéniciens. Jusqu’à leur langage. «La transcendance spirituelle ches les Hébreux, lit-on dans le dictionnaire de la Bible, n’implique pas une coupure totale avec le vaste fond commun de culture et de technique qui a conditionné leur histoire. On ne s’étonnera donc pas de retrouver dans la Bible des connaissances médicales et des procédés thérapeutiques en usage dans le Proche-Orient». A.G. Barrois précise de son côté, dans son Manuel d’archéologie biblique, que «l’orthodoxie (c’est-à-dire hébraïque) ne fit guère qu’adapter les opinions médicales cananéennes à sa croyance en un Dieu unique». Cela dit, nous nous proposons de traiter ici de la science médicale en Phénicie sous les aspects suivants : 1 - la médecine dans les croyances religieuses ou la médecine sacerdotale; 2 - La médecine scientifique : description clinique des maladies, diagnostics, thérapeutique et prévention. La medécine dans les croyances religieuses A) La médecine sacerdotale Nous savons par les textes anciens que, parmi les divinités importantes qui constituent l’Olympe de la mythologie phénicienne, se trouve le dieu Eschmoun, dieu guérisseur ou dieu de la médecine. Eschmoun est, selon Sanchoniation (prêtre-historien beyrouthin du IXe siècle avant le Christ), le huitième des cabires, enfants de Saddik, fils de Baal Shamaïm ou seigneur des cieux. Les cabires étaient au nombre de sept, chiffre sacré chez les Phéniciens. Mais le huitième, c’est-à-dire Eschmoun (c’est, croyait-on, le sens étymologique de ce nom mais les résultats des recherches actuelles proposent d’autres explications à ce nom), en est un complément. Il est possible qu’Eschmoun ait réellement existé à une époque très reculée et qu’il ait été divinisé après sa mort pour avoir inventé l’art médical en Phénicie, car dans l’inscription d’Eschmounazar découverte à Sidon, il est qualifié de «prince saint». Sidon, Beyrouth et Carthage vouaient un culte particulier à ce dieu, dont l’attribut est le serpent, symbole de la longue vie et de la santé. Les Macédoniens, après la conquête de la Phénicie par Alexandre le Grand, adoptèrent Eschmoun sous le nom d’Asklepios. Et Damascius précise à ce propos que «Asklepios qui est adoré à Beyrouth n’est ni grec ni égyptien, mais phénicien». Le nom d’Asklepios a été donné à la rivière connue aujourd’hui sous le nom de Nahr Awali, près de Saïda, où se trouve également un magnifique temple dédié à Eschmoun, datant certainement des VIIe-VIe siècles avant J-C. B) Le temple d’Eschmoun Les malades se rendaient au temple d’Eschmoun et se baignaient dans les bassins spécialement aménagés, dont les eaux avaient, croyait-on, des vertus miraculeuses. Et c’est à Eschmoun que la princesse Shitmanat adressa ses prières pour qu’il guérisse son père Keret, roi des Sidoniens. Le récit qui s’y rapporte nous apprend que ce dieu exauça ses prières. Dans le temple d’Eschmoun, ont été retrouvées, offertes en ex veto, de très belles statues représentant des enfants qui ont été guéris et montrant les infirmités dont ils étaient atteints. Les prêtres d’Eschmoun, à force de voir des malades et de s’occuper d’eux, de plus ou moins près, avaient sans doute acquis une expérience non négligeable en matière médicale. Mais comment agissaient-ils en dehors de l’exercice de leur métier officiel ? Ont-ils contribué au développement de la médecine en Phénicie ? Autant de questions qui, jusqu’à présent, demeurent sans réponse. Toutefois, nous devons logiquement voir dans la médecine sacerdotale l’ancêtre de la médecine scientifique. C) Le malade est un pécheur Si Eschmoun est le dieu de la médecine, il y a également des divinités secondaires qui sont à l’origine des maladies ; car dans la médecine sacerdotale cananéenne, «La plupart des maladies relèvent plus ou moins directement d’agents surnaturels. Elles sont l’effet du courroux des dieux, ou bien elles représentent la malignité des mauvais esprits qui affligent l’humanité». Il était inévitable que l’on vit dans les crises d’épilepsie, dans diverses manifestations historiques, dans l’agitation des maniaques et éventuellement dans le délire causé par la fièvre, autant de cas de possession, fussent-ils temporaires. Le patient, comme on dit encore de nos jours, n’était plus le même et ses actions ou ses paroles étaient attribuées à l’esprit dont son corps était devenu l’habitude. La peste et les épidémies étaient également regardées comme des châtiments collectifs. Ici ce n’est pas tellement la nature spécifique de la maladie qui trahit son origine surnaturelle mais la rapidité avec laquelle elle se propage sans raison apparente et s’abat, non seulement sur les coupables, mais parfois sur les innocents. La lèpre, relativement fréquente en Orient, était parfois considérée comme un châtiment de Dieu. Elle est une des principales causes d’impureté rituelle. Le caractère bien spécial du sang fluide vital, qui appartient à Dieu, rendait pareillement impropres aux actions rituelles les individus atteints d’hémorragie. De même, les fonctions génitales étaient tenues pour sacrées. L’impuissance et la stérilité étaient considérées comme des effets de malédiction de Dieu. Ainsi donc, l’organisme, perpétuellement sous la protection d’une divinité générale ou personnelle de l’individu, sera véritablement mis en état de moindre résistance dès que ce dieu se détourne du pécheur en qui il résidait et l’abandonne. C’est alors qu’intervient le démon maladie. Ce sont le «namtarou» (la peste), la fièvre, le mal de tête, le «pazouzou» ou vent sud-ouest et les chaleurs brûlantes, le «lamashtou», qui est l’infection puerpérale. Après l’abandon de la divinité, le démon maladie prend possession de la place libre. «Celui qui n’a pas de dieu lorsqu’il marche dans la rue, le mal de tête le couvre comme un vêtement». Il s’agit donc de découvrir quels péchés a commis le malade et quel démon peut le posséder. Pour cela, le médecin, qui est le plus souvent un prêtre conjurateur, passe en revue la liste des péchés que le patient a pu commettre. La liste est longue car il importe que la faute soit nommée ; cela seul suffit à en donner la connaissance, rend licites l’invocation et la supplication aux dieux et permet d’atteindre le démon possesseur. À partir de ce moments cette expulsion est obtenue par l’exorcisme. Dans un des textes anciens, c’est le dieu de la médecine qui prescrit à un malade le rituel à suivre. C’est un rituel à l’origine purement magique. Il comprendra des actes symboliques, des lustrations, des frictions qui sont justement ceux que l’on emploie pour nettoyer et purifier un objet, l’usage de liens noués sur la partie malade que l’on dénouera en souhaitant qu’il en soit de même du mal dont souffre le patient. Puis le rituel s’enrichit d’une pharmacopée antidémoniale variable d’un démon maladie à un autre : le suppose-t-on de nature différente de celle de l’homme ? Rien ne pourra lui être plus désagréable que ce qui plairait à un être humain. Exemple : sucreries. Si au contraire on juge que son essence est la même que celle de l’homme, on fera ingurgiter au malade les remèdes les plus étranges et les plus nauséaux : aliments pourris, brûlés, excréments… de quoi dégoûter l’occupant et lui faire quitter la place. Enfin, un dernier moyen, c’est le principe de la compensation : on présentera au démon une victime de substitution pour l’engager à en faire son lieu d’élection. Cette victime sera un chevreau, un cochon de lait ou même un réseau de la taille du malade. Prochain article : Description clinique de la médecine scientifique
Il est difficile d’écrire actuellement une histoire de la médecine phénicienne ou cananéenne. Non seulement les études faites à ce sujet par les spécialistes sont pratiquement d’une portée tout à fait limitée, mais aussi, si l’on veut s’y intéresser de près, parce que les éléments sont épars ou non divulgués et les données rares et fragmentaires. (Voir...



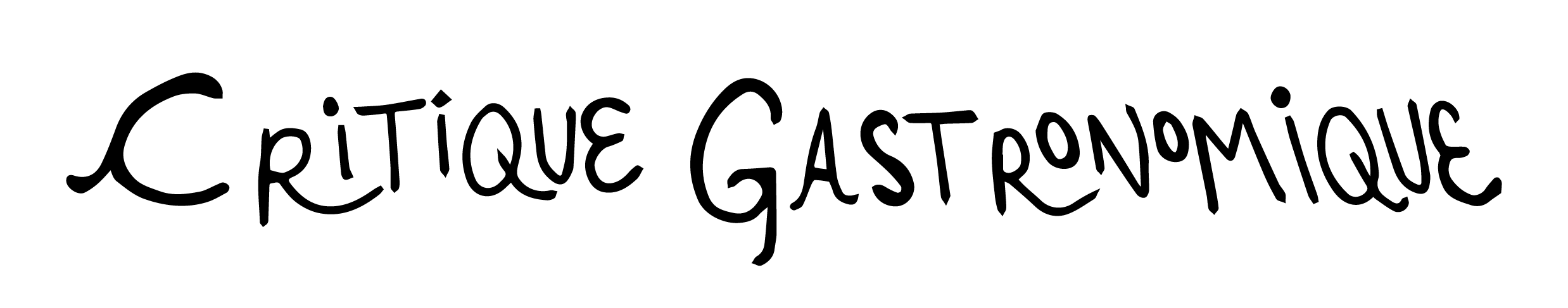
Les plus commentés
Le professeur en pédiatrie Robert Sacy emporté par une crise cardiaque
La comédienne Shaden Fakih accusée de « blasphème » par Dar el-Fatwa
L’Eurovision, outil de « soft-power » préféré d'Israël ?