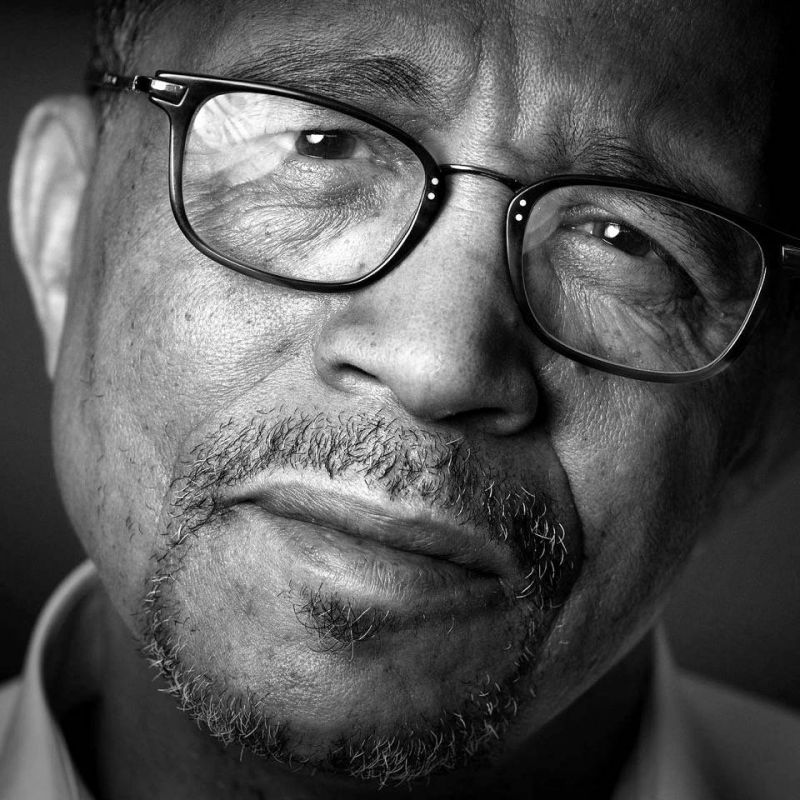
D.R.
Le roman de Yasmina Khadra, Les Vertueux, développe une fiction particulièrement subtile, puisqu’il ne s’agit pas de qualifier l’objet de la vertu elle-même, mais de mettre en jeu ce qui s’en estime redevable. L’auteur fait ainsi le pari de la fiction et de ses débordements, contre la neutralisation par l’abstraction et l’expression stéréotypée des bons sentiments : le mal sanctionné, la bonté d’âme récompensée. En vrai, ça ne fonctionne pas vraiment ainsi. Khadra, en renouvelant l’art romanesque, met en évidence le dérèglement du monde, et l’absurdité qu’il y aurait à croire en son équanimité.
Le point de départ en est un prétendu accommodement insupportable : un jeune homme, Yacine Cheraga – un quasi simple, à qui le caïd local, Gaïd Brahim, homme puissant et dont pouvoir, richesse, et territoire constituent la frontière mentale de Yacine – enjoint de prendre la place de son fils lors de la conscription de 1914. L’homme puissant lui assure que sa famille, pauvre entre les pauvres, sera récompensée pour ce sacrifice. Yacine Cheraga devient Hamza Boussaïd et part mener une guerre qui lui est incompréhensible, mais par laquelle peu à peu il va acquérir un savoir sur les autres, sur le combat, sur la géographie, et sur lui-même. Ses camarades et lui porteront en eux la conviction d’être des survivants.
Pendant longtemps, Yacine est immobilisé par l’exigence de soumission, imposée par des menaces et leur corollaire, le respect, qui est bien cette attitude qu’exige des autres un puissant qui les méprise, et Yacine le constatera amèrement tout au long de l’existence. Ses parents seront simplement chassés, et il les recherchera pendant une longue partie de sa misérable existence. La confrontation à la brutalisation générale est alors la seconde étape de cette existence, présentée depuis la conscience de Yacine, désormais Hamza. La guerre au jour le jour constitue ainsi une part importante du roman. Hamza prend conscience brutalement à chaque étape de l’étendue du monde et de la diversité des êtres : train, bateau, marches, paysages de plus en plus déchirés, corps en charpie suspendus aux barbelés, cette conscience est aussi peu à peu celle de la loque qu’il devient quand le feu tombe sur la troupe. Il partage l’héroïsme quotidien des combattants et celui de la survie dans les tranchées, dont l’horreur est appuyée, depuis le premier mort réellement regardé, et qui devient le repère même de la déchéance morale qui le ronge, presque à son insu. L’histoire, ce ne sont pas seulement les faits racontés, mais leur mise en mémoire et l’efficacité de leur agencement narratif. L’art du romancier emporte le lecteur loin de ses certitudes et de ses croyances.
Lorsque la guerre est finie, la joie du retour est tempérée par la séparation définitive : depuis le bastingage, celui qui est encore un temps, Hamza entrevoit ses camarades « au loin, alignés sur les quais par milliers, en train de nous faire des signes d’adieu », comme des spectres abandonnés. L’histoire de Hamza est celle de la survie de Yacine d’abord, et des quelques rescapés du grand massacre. Au retour de la guerre, la situation coloniale constitue le premier plan du panorama.
Le roman de Khadra nous arrive alors comme une fresque sociale, quasi picaresque, qui raconte une histoire souvent méconnue, renvoyée au silence, et qui contrevient à la plupart des clichés activés dès lors qu’il est question de l’Algérie coloniale, qui fut un espace de pauvreté et de misère sans répit. Yacine raconte la construction et la déconstruction de son identité, puis sa nouvelle élaboration, par les autres, tous les intercesseurs qu’il retrouve sur son chemin, en premier les camarades survivants qu’il va croiser dans sa quête. Il est confronté à ces abominations : le mépris des autres, le mensonge, les projets coupables, l’empressement au mal, le faux témoignage, l’exercice de la zizanie, le meurtre. En regard à ce que subit Yacine, il y a l’enseignement reçu d’un éleveur de dromadaires dans la hamada et qui lui sauve la vie. La voie du discernement est étroite et il faut monter sept marches pour espérer accéder à la sagesse : « l’amour ; la compassion ; le partage ; la gratitude ; la patience et le courage d’être soi en toutes circonstances (…) La septième est au bout de ton chemin. » L’art du raconteur d’histoires est de donner sens et vie à ces abstractions, par le truchement d’un récit fondé sur une esthétique de la transformation progressive des situations, et par la récurrence des personnages au long de situations déclinées selon une grammaire qui progresse comme si le personnage était le jouet du hasard, alors que l’écriture suit de près la loi d’airain de la composition de la narration.
« On ne peut pas être trop près du bon Dieu sans se mettre à la merci du diable », lui fait remarquer un intercesseur qui lui enjoint de ne pas déconsidérer les miséreux. C’est sans doute l’expression la plus resserrée de cette quête intime, et de son oscillation dans la réalité du monde. Celles et ceux qui parviennent à se délester de la charge de misère qu’on leur assigne à la naissance, le reconnaissent, et peut-être que c’est ce savoir diffus qui peut les rendre vertueux. Cela n’a plus rien à voir avec la figure stéréotypée du héros. Car le héros n’existe pas tout seul.
Parmi les êtres qui rendent possibles cette accession à l’existence adulte, les femmes occupent des places essentielles. Le roman fait apparaître des figures de femmes lumineuses, toujours en chemin vers leur liberté d’action, de désir, et d’existence. C’est avec Mariem, sa jeune épouse que l’amour va se manifester comme réalité absolue, et paradoxale. C’est une dernière figure médiatrice, et c’est bien par elle, avec elle, et pour elle que Yacine accède à la septième marche, qu’il prend conscience de son accession réelle à l’humanité, et qu’il rejoint l’oasis de Kenadsa, si essentielle à Khadra lui-même.
Les Vertueux de Yasmina Khadra, Miallet-Barrault, 2022, 512 p.
