
Rasha Omran. Photo Mostafa Abdel Aty
On avait fait appel à Kubra Khademi pour imaginer l’affiche du Festival d’Avignon, l’un des principaux festivals internationaux de spectacles vivants, peu avant la chute de Kaboul aux mains des talibans en août 2021.
On peut y voir cinq femmes nues, symboles de liberté. Une liberté que la performeuse et peintre afghane chérit depuis qu’elle a fui son pays en 2015.
Cette année-là, l’artiste de 33 ans s’était promenée pendant quelques minutes dans une rue de Kaboul vêtue d’une armure métallique « antiattouchements » qui épouse la forme de ses seins et de ses fesses, pour dénoncer le harcèlement de rue. S’ensuivirent des menaces de mort qui l’obligèrent à s’exiler.
« J’étais entourée de gens en colère qui se disaient “on va la tuer” », raconte-t-elle. En France, cette féministe originaire de la province de Ghor (centre de l’Afghanistan), passée par les Beaux-Arts à Kaboul, a trouvé « une seconde vie ».
À la Collection Lambert à Avignon, elle présente une exposition avec des tableaux semblables à des fresques mythologiques (deux femmes nues poignardant un dragon) ou plus réalistes (kalachnikov, tête d’un taliban sans visage).
« Je suis d’une génération afghane qui a grandi avec la paix, l’éducation, l’art, internet, la possibilité de faire des choses », rappelle l’artiste qui a aidé des dizaines d’artistes à quitter l’Afghanistan.
« Aujourd’hui, je suis à 200 % libre et je consacre chaque instant à l’art pour faire entendre ma voix. »
 Hanane Hajj Ali. Photo Marwan Tahtah
Hanane Hajj Ali. Photo Marwan Tahtah
Le jogging de Hanane
Deux choses permettent à la comédienne et metteuse en scène Hanane Hajj Ali « de faire face à toutes les catastrophes qui se sont abattues sur le Liban » : la course à pied le matin à Beyrouth et le théâtre. Sa pièce Jogging, qu’elle présente au Festival d’Avignon, est comme un résumé de tout ce qui ne va pas dans le pays méditerranéen miné par une crise financière sans précédent depuis plus de deux ans.
Écrite avant la crise, la pièce était un rien prémonitoire. « À chaque fois que je courais dans Beyrouth, je sentais comme une odeur de corruption et de pourriture. »
Elle y incarne tour à tour elle-même courant pour éviter l’ostéoporose, l’obésité et la dépression, mais aussi Médée. « Il y a des Médées contemporaines, ces femmes qui envoient leurs enfants dans les barques de la mort », poussées par les ravages de la guerre et de la misère.
Hanane Hajj Ali, qui a refusé de soumettre sa pièce au département de la censure au Liban, l’a fait tourner dans une cinquantaine de pays. « Notre présence en tant qu’artistes du Moyen-Orient sur la scène du monde est d’autant plus importante avec la montée des extrémismes », dit-elle.
 Kubra Khademi. Nicolas Tucat/AFP
Kubra Khademi. Nicolas Tucat/AFP
La blessure syrienne
Durant les trois ans qui ont suivi son exil de la Syrie en guerre pour avoir dénoncé la répression du régime de Bachar el-Assad, Rasha Omran n’a pu écrire un seul mot. « Ne plus pouvoir revenir dans son pays, c’est une blessure, un manque », affirme la poétesse syrienne, l’une des plus éminentes de son pays, installée depuis 2012 au Caire.
Au Festival d’Avignon, elle fera partie du cycle de lectures « Shaeirat » (« poétesses » en arabe).
Son recueil Celle qui habitait la maison avant moi évoque une histoire intime, écrite après avoir occupé, seule au Caire, un appartement ayant appartenu à une femme grecque solitaire. « J’ai senti comme si j’étais sa réincarnation », explique-t-elle à l’AFP. Une contemplation dans la solitude mais aussi dans la ménopause, appelée en arabe « l’âge du désespoir », une expression « ridicule », selon elle.
Elle voit son projet poétique comme un « acte de résistance » et garde un mince espoir pour son pays. « Des générations entières sont sous terre ou en dehors de la Syrie, mais la roue tourne. »
Rana MOUSSAOUI/AFP


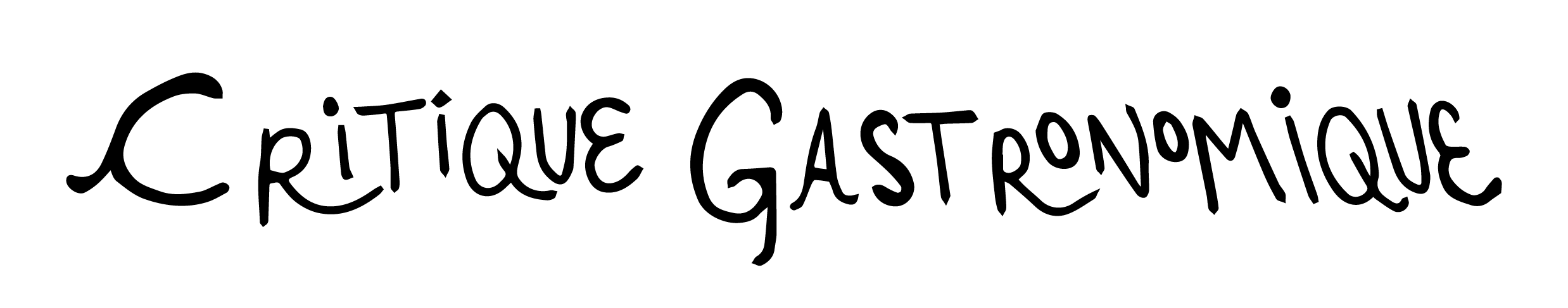

commentaires (0)
Commenter