
Milka Assaf vide son sac dans « L’Ombre du Cèdre ». Photo DR
Face à un livre de cinq cents pages qui s’intitule L’Ombre du Cèdre, on peut s’attendre à de longues envolées lyriques sur les vallées chantantes du nord du Liban drapées dans les feuillages de forêts millénaires. Or, l’histoire commence dans l’Alep cosmopolite et bourgeois de la fin des années quarante, où la famille Aramoun mène une vie mondaine un peu euphorique. Alphonse, le père, homme d’affaires, est originaire d’une « grande famille » du Kesrouan. Il s’est marié avec une danseuse bulgare, au grand dam de ses proches qui considèrent cette aristocrate et ancienne ballerine d’opéra comme une prostituée. Le couple a deux enfants, un fils aîné qui fait ses études au Liban et la cadette, Anya, qui observe son environnement avec curiosité, acuité et sensibilité. Très vite, est révélée la violence physique et verbale d’Alphonse aussi bien sur sa femme que sur ses enfants. Finalement, il les abandonne pour aller rejoindre sa maîtresse, Paula, à Beyrouth. Olga est prête à tous les subterfuges pour préserver sa fille du pathétique de la situation : la fantaisie de l’ancienne danseuse est sans limites pour créer des tenues excentriques à partir de quelques accessoires ou pour organiser des soirées avec des artistes slaves qu’elle a rencontrés à la porte des ambassades, notamment Varbinka, dont les spectacles sont construits autour du fait qu’elle n’a ni bras ni jambes. Anya est emportée par le souffle fantasque de sa mère, tout en développant une analyse fine et nuancée de la réalité complexe qui l’entoure.
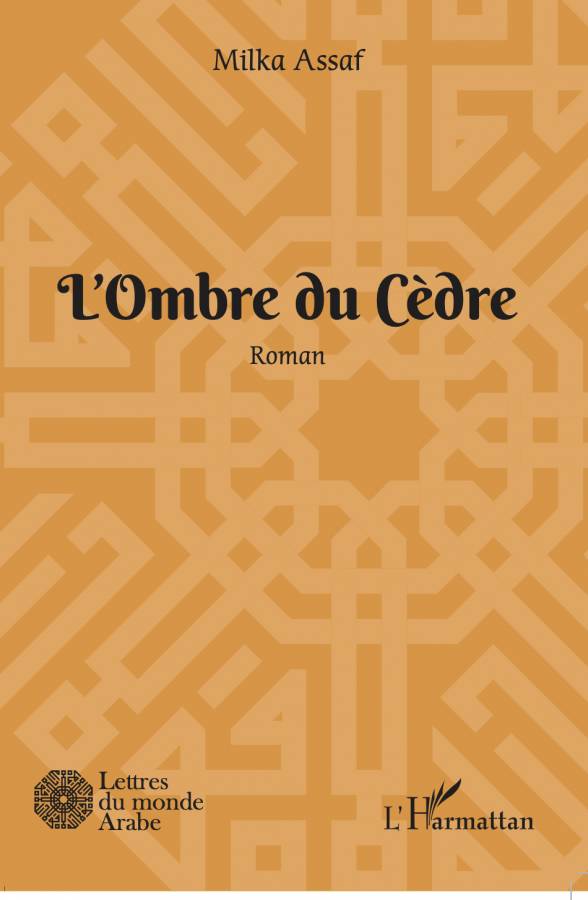 La couverture du roman.
La couverture du roman.
Un jour, son père réapparaît et décide de l’emmener à Beyrouth avec lui pour qu’elle soit scolarisée ensuite chez les sœurs de Saïda. La scène où la petite fille découvre la fameuse Paula est particulièrement réussie, mimant au millimètre près les simagrées et les faux-semblants de la belle-mère, alors qu’Olga est au balcon dans ses plus beaux atours, le regard à la fois incisif et triomphant.
Olga décide alors de s’installer à Beyrouth elle aussi afin d’être plus près de ses enfants, ce qui donne lieu à des scènes cocasses, comme le contraste entre les week-ends de festins pléthoriques et médisants dans la famille Aramoun, et les séjours chez la mère. Installée à Basta puis à Bourj Hammoud, elle vit dans des taudis où règnent une certaine joie de vivre et une véritable solidarité des déclassés multiculturels. Les virées de la mère et la fille au souk américain (qui est en fait une immense friperie) sont rocambolesques. En parallèle, Anya développe ses talents artistiques ; rapidement, elle sait qu’elle veut devenir scénariste, et c’est une religieuse qui va lui parler d’une école à Paris où elle pourra développer ses compétences. Au fil des années, l’adolescente met au point des stratégies pour quitter un pays où elle est à la merci d’un père qui la frappe et qui ne lui laisse aucune marge de liberté dans quelque domaine que ce soit.
L’Ombre du Cèdre se lit comme on regarde un film, les scènes défilent, les personnages sont extrêmement justes et présents, aussi bien dans leurs corps que dans leurs mots, leurs voix, leurs expressions... La trajectoire libératoire fulgurante d’Olga puis de sa fille Anya accompagne une odyssée temporelle dans l’âge d’or alépin puis libanais. Le Liban des années 50 se déroule sous nos yeux, de la pâtisserie Arlequin au restaurant Ajami, de l’hôtel Saint-Georges à la trépidante rue Hamra, des séjours d’été à Dhour Choueir à l’hôtel Korkomaz de Jouret el-Termos. La beauté des paysages, la vie sociale tapageuse et la frénésie ambiante contrastent avec la misère subie par Olga, qui réussit finalement à ouvrir une école de danse et à faire la une de La Revue du Liban. La scène où la famille Aramoun découvre le magazine lors d’un repas orgiaque vaut le détour. Quelques jours plus tard, dépendant de l’autorité de son mari, Olga sera cependant contrainte de fermer cet établissement. Le lecteur assiste d’un chapitre à l’autre à l’évolution d’Anya dans un Liban à la fois magique et cruel, et à la construction d’une personnalité complexe, dans un contexte discordant où sa mère continue de considérer son bourreau comme son grand amour.
Milka Assaf insiste d’emblée sur l’importance dans son parcours de la réalisation de ses documentaires, dont plusieurs ont été primés. « J’en ai fait beaucoup au Liban, dont un film sur l’absence de mariage civil, sur différents couples de confessions différentes qui ont dû s’exiler à Chypre pour se marier. J’ai quitté le Liban à 19 ans, mais j’y suis toujours restée attachée avec la boule au ventre. J’y suis retournée souvent pour mon travail avec le souci de réveiller les consciences », confie la réalisatrice franco-libanaise avec une certaine fougue à L’Orient-Le Jour. « J’ai toujours écrit, parce que, pour un projet cinématographique, il faut convaincre le producteur, et je me suis toujours attachée à trouver les mots pour évoquer les images, les sons. Je crois que le style de mon roman découle de ce travail de documentariste, tout comme l’usage du présent. Comme j’ai décidé de déverrouiller les vannes de ma mémoire pour faire ressusciter ce Liban, il est redevenu présent dans ma tête et j’ai écrit ce que je voyais et ce que j’entendais », poursuit celle qui a également été comédienne, ce qui l’aide à comprendre le processus d’entrer dans la peau d’un personnage et d’en inventer. « Je me suis inspirée de personnages réels dont j’ai changé les noms, même s’ils ont disparu aujourd’hui. Pour le patronyme Aramoun, j’ai choisi le nom du village d’origine de ma famille ; en somme, j’ai brouillé les pistes, et j’ai ajouté d’autres personnages en m’inspirant de ceux que j’ai connus », explique celle qui a reçu le prix Claude Santelli, décerné par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques en 2013, pour sa pièce Les Démineuses.
Ce sont les explosions du 4 août qui ont déclenché l’écriture de L’Ombre du Cèdre. « Quand Beyrouth a explosé, j’ai voulu témoigner de ce monde disparu et j’ai commencé avec l’intention de faire revivre ce que l’on appelait la Suisse du Moyen-Orient, mais très vite, en écrivant, toute sa part d’ombre a resurgi, et j’ai décidé d’aller au bout, de me livrer totalement : j’ai vidé mon sac. La toile de fond étant historique, je me suis beaucoup documentée, car j’avais des souvenirs de bombardements israéliens en Syrie par exemple, mais je ne savais pas à quoi ils correspondaient. J’ai une formation de monteuse et j’ai procédé en sélectionnant les moments importants pour créer une continuité », précise la romancière qui insiste sur son principe de ne pas faire de commentaires dans ses documentaires, ce qu’elle applique également dans son roman.
« Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de point de vue dans la manière dont j’organise les éléments, dans ce que j’ai choisi de filmer, dans la manière dont c’est filmé… C’est au spectateur, et ici au lecteur, de se faire sa propre opinion dans ce roman d’apprentissage, qui est né d’une réflexion que j’ai menée pendant plusieurs années face à un vécu si particulier qu’il peut sembler irréel. À tel point que j’ai mis quelques documents ou coupures de journaux au sein du récit pour attester par exemple de l’existence de Varbinka », ajoute l’auteure, qui affirme qu’en passant son enfance entre la richesse et la pauvreté, elle a très tôt développé une conscience de classe qui a nourri sa participation aux manifestations de 1968 et aux mouvements de libération de la femme.
On peut aussi lire le roman comme un hommage au personnage, qui « se dandinait au son de sa musique intérieure », la pétillante Olga. « Elle s’inspire beaucoup de ma mère, et elle est vraiment morte dans un accident de voiture avec moi. Il a eu lieu en France ; pour des raisons de commodités narratives, je l’ai situé dans la vallée des crânes, où j’ai moi-même eu un accident. Ma mère avait l’esprit des femmes de son époque, comme dans la chanson citée dans le roman : Il me donne des coups, il me prend des sous, mais que voulez-vous, c’est mon homme », confie la réalisatrice, qui s’interroge en filigrane sur les racines du mal, celui de la violence masculine. « Lorsque Nawal, la bonne de Paula, soigne Anya qui a été frappée par son père, elle constate que finalement, son propre père et Alphonse partagent la même barbarie, même s’ils sont de classes sociales différentes. Il y a quelque chose de pourri dans la société libanaise, avec cette violence qui est institutionnelle : les hommes ont le droit d’être violents, et je voulais le souligner. Le côté moderne et occidental de la société bourgeoise de l’époque, c’était du vernis. Il y a quelque chose de profondément archaïque et patriarcal derrière », constate amèrement l’écrivaine, qui d’emblée nuance son point de vue en insistant sur la magie de certains souvenirs. « J’adorais le paysage, et puis, c’était fantastique de faire mes devoirs au Saint-Georges avec un orchestre qui jouait derrière moi, un peu à la Gatsby le Magnifique. C’était aussi un monde fascinant, le meilleur et le pire se côtoyaient allègrement. Et puis, il y avait des anges, comme celui que j’appelle la mère Daccache qui a pris soin de moi », évoque celle qui envisage d’écrire la suite de L’Ombre du Cèdre sous la forme d’un road movie vingt ans plus tard, alors qu’Anya est rappelée au Liban au chevet de son père. « Tout au long du trajet, elle va analyser la manière dont il lui a pourri sa relation aux hommes, c’est l’occasion de faire des flash-back sur les moments importants de son existence », annonce celle qui œuvre en ce moment pour que L’Ombre du Cèdre devienne une série télévisée ou le support d’un texte théâtral. Pourquoi pas ?

commentaires (0)
Commenter