« On est de son enfance comme on est d’un pays. »
Antoine de Saint-Exupéry
Quand je pense à mon enfance, c’est surtout à mon père que je pense. La plupart de mes souvenirs de cette période sont rattachés à lui. Mon enfance, mon père l’a rendue spéciale, excitante, inoubliable. Ma sœur avait dix ans de plus que moi. Elle était déjà dans une autre phase de sa vie quand j’ai commencé à prendre conscience de ce qui se passait autour de moi. Ma mère était prise par les milles choses du quotidien, un quotidien au sortir d’une guerre civile et des multiples difficultés que cela représentait. Je passais beaucoup de temps avec mon père. Je ne sais pas s’il avait du temps libre, ou s’il voulait soulager ma mère par moments, mais il m’emmenait partout avec lui. Faire des courses, voir ses amis, aller à des vernissages ou des signatures de livres. Passer du temps avec Farès, c’était toujours une aventure. C’était être stimulée et apprendre. Nous faisions de longues balades en voiture où nous écoutions de la musique, surtout Brel et Brassens dont il m’expliquait les paroles pour que je puisse les apprécier à leur juste valeur. Nous passions des heures chez le marchand d’art Émile Hannouche à contempler ses nouvelles et anciennes acquisitions : des icônes religieuses, des tableaux de Guiragossian, de Fateh Moudarres, Aref Rayess, Rafic Charaf... Il m’apprenait à reconnaître leur style, à distinguer les différents mouvements, les influences. Des amis le rejoignaient et j’assistais, fascinée, à leurs discussions qui me donnaient l’impression de faire partie du groupe, d’être devenue une adulte, le rêve de chaque enfant. Sur le chemin du retour, je lui posais des questions sur des bribes de conversation que j’avais entendues et il prenait toujours la peine de m’expliquer d’une manière que je pouvais comprendre. Apprendre avec lui était ludique. Un échange qui ne concernait que nous deux et où je cherchais à le battre sans jamais y réussir. À la maison, il me faisait découvrir les grands peintres : de Van Gogh à Egon Schiele, des surréalistes aux romantiques. Il arrivait toujours à me raconter peu mais assez pour attiser ma curiosité et me laissait seule découvrir le reste. C’était la même chose avec la littérature. Soucieux dès ma petite enfance de me faire partager son amour des livres, il veillait à ce qu’un livre m’accompagne à tout moment. De la bibliothèque rose à la bibliothèque verte, il guidait mes lectures, me disant quand je pouvais passer au niveau supérieur. Je me souviens encore du jour où il m’a donné à lire Dix Petits Nègres d’Agatha Christie ou une biographie de Freud. Sa tactique était la suivante. Il me racontait de manière passionnante le début de l’histoire ou une anecdote, puis il s’arrêtait. Je demandais curieuse : « Et puis ? » Il répondait : « Tu n’as qu’à lire le livre. » Le soir même, il me le donnait. J’avais l’impression de vivre dans une bibliothèque car toutes ces œuvres dont il me parlait étaient chez nous. J’admirais sa capacité de retrouver, sans jamais se tromper, parmi des milliers de bouquins, celui dont il venait de me parler. Je parcourais la maison et je rêvais secrètement de lire tous ses livres un jour et d’en parler avec lui.
Le cinéma est une autre histoire d’amour à laquelle mon père m’initia. Il n’a jamais voulu me montrer des films pour enfants. Ceux-là, je pouvais les voir à l’école, avec mes amis ou mes cousins. Avec lui, je voyais de « vrais » films. Mes premiers souvenirs sont des VHS de La Flûte enchantée de Ingmar Bergman et My Fair Lady de George Cukor. Je ne comprenais pas la langue ni je ne pouvais lire les sous-titres, mais j’étais emportée par les images, la musique et les quelques codes qu’il me donnait pour comprendre l’histoire. Un jour, il loua une cassette VHS de Spartacus de Stanley Kubrick du Centre culturel français. Je fis une telle obsession sur ce film, le regardant en boucle pendant quatre jours jusqu’à ce que mon père s’inquièta de ma santé mentale et qu’il retourna hâtivement la cassette. Nous habitions à Jdita, dans la plaine de la Békaa, où il n’y avait pas de salles de cinéma. J’avais 8 ans quand mon père nous prit en famille à Beyrouth au cinéma optant à mon grand désarroi pour The Bodyguard à la place de Home Alone. Qu’importe ! La magie de la salle noire opéra et j’en sortis transformée. Ce jour-là, le cinéma devint mon endroit préféré au monde. J’ai demandé à y retourner et mon père fit un pacte avec moi. À chaque fois que j’aurais de bonnes notes, il m’emmènerait voir un film. Ce pacte, nous l’avons tous deux tenu et il devint un rituel sacré. Le cinéma prit ainsi une place conséquente dans ma vie. Quand j’ai annoncé à mon père mon désir de faire des études de cinéma, il était légèrement déçu : « J’ai envie que tu fasses un métier plus sérieux et que le cinéma soit ton violon d’Ingres. » Lorsqu’il m’a expliqué ce que voulait dire « violon d’Ingres », je répondis que c’était de sa faute si je ne voulais rien faire d’autre. Il défendit alors mon désir devant toute la famille – surtout mon oncle qui voulait que je devienne avocate – à condition que je passe mon bac en option scientifique et non littéraire. J’ai découvert plus tard qu’il espérait que je change d’avis et qu’il voulait que je garde toutes mes options. J’ai passé mon bac, option « sciences de la vie et de la terre », et Farès a gardé sa promesse. Il a respecté ma décision, m’a laissé choisir mon université et n’a plus essayé de me dissuader. Au fur et à mesure que le temps passait, il m’encourageait même à prendre des risques et à suivre ma passion. Quand je suis devenue productrice, j’ai réalisé que j’avais fini par faire le même métier que lui. Il publiait des livres, je produisais des films. Nous deux avons choisi des métiers de l’ombre. Nous deux soutenons des créateurs et leur donnons les moyens de faire aboutir leurs œuvres. Nous deux militons pour la culture. Il a joué un grand rôle dans le milieu littéraire libanais. J’essaie de me battre pour le cinéma libanais. Il voyait tous mes films, je ne lisais pas tous ses livres. Pas un jour de ma vie d’adulte n’est passé sans que je ne pense à lui, à son désir d’excellence, à ma quête de le rendre fier. Je continuerai de penser à lui tous les jours, dans mon travail ou dans mon quotidien, à travers les arts ou en me remémorant les multiples leçons de vie qu’il m’a données et que je raconterai peut-être une autre fois.
Myriam Sassine
* * *
«Laisser un vide »… J’ai longtemps médité sur cette expression.
Un vide dans mon cœur ; un père c’est irremplaçable et un père comme le mien c’est inexprimable. Les conversations, les sorties, les leçons de vie…, grands moments de mon existence qui ont forgé le « moi » auquel je suis confrontée aujourd’hui ; tous ces conseils si précieux distillés avec tant de finesse et d’humour qu’ils ressemblaient à des évidences.
Un vide dans la maison, à l’emplacement de son fauteuil préféré, sur son bureau, parmi ses livres qu’il affectionnait tant et où il pouvait retrouver n’importe quelle phrase ou paragraphe selon les circonstances parmi les milliers d’ouvrages entassés partout.
Un vide dans mon espace sonore, la musique emplissait les lieux… Une musique pointue mêlant l’optimisme infaillible de Mozart à la virtuosité des variations Goldberg par tel ou tel interprète, l’essence du Liban incarnée dans la voix de Fairouz ou l’éternelle lutte du monde arabe perpétuée par Cheikh Imam et la tristesse infinie des chansons de Barbara… à l’espièglerie coquine de Brassens.
Un vide sur mon téléphone pour me rappeler telle ou telle chose ou pour le consulter sur quelconque difficulté, référence ou direction à prendre… Et c’est toujours une façon de voir et de penser qu’il me ressortait, non pas une réponse mais une manière de se positionner, d’être indépendante, d’être moi-même… femme dans le monde contemporain.
Un vide dans ma joie de vivre… « L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre », disait Georges Wolinsky, et Farès connaissait ce chemin avec brio, jonglant avec ironie une pointe de sarcasme et un nuage de culture et des références, mais entrebâillait aussi une fente pour s’introspecter, se remettre en question et conquérir les cœurs.
Mais le vide de mon cerveau, je ne m’y attendais pas, n’ayant jamais été à court d’idées ou de pensées… D’habitude, il me fallait les faire taire, les organiser, les discipliner…, mais jamais les trouver.
Et là je comprends le vide. Cet espace sans contenu et sans matière, imperceptible où il me manque tant.
Ce matin, J’ai retrouvé parmi ses notes ce texte qui, par sa beauté, me le ramène un peu :
« En cette vie, où je suis mon sommeil,/ Je ne suis pas mon sommet,/ Qui je suis est qui je m'ignore et vit/ À travers cette brume que vraiment je suis,/ Toutes les vies que j'ai eues autrefois,/ Dans une seule vie./ Je suis mer ; clapotis faible, rugissement vers les hauteurs,/ Mais ma couleur provient de mon ciel élevé,/ Et je ne me rencontre que lorsque de moi je fuis. » Fernando Pessoa
Rania Sassine


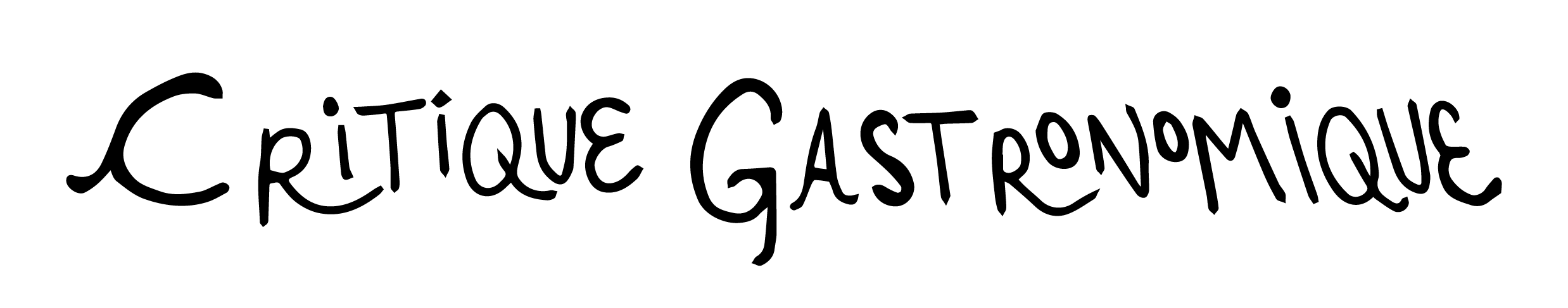
commentaires (0)
Commenter