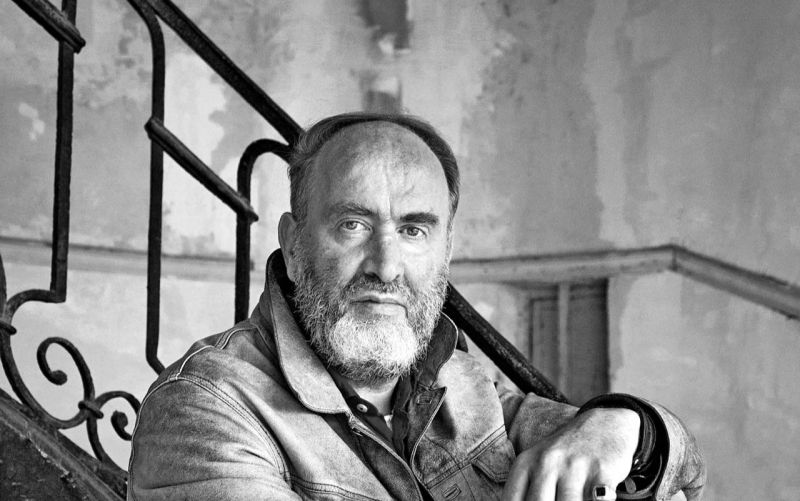
© Philippe Matsas / Opale / Leemage
Lorsque le jeune Alexandre rencontre Constanze à Toulouse, au début des années 80, il est fasciné par cette étudiante pétillante et engagée dans des combats écologiques, venue de RDA. Issu d’une famille de paysans ancrés dans le lot depuis plusieurs générations, le jeune homme qui a grandi avec trois sœurs est destiné à reprendre l’exploitation agricole. Son histoire avec Constanze semble compromise, malgré la construction d’un lien qui semble se renforcer au fil du temps et des kilomètres de distance.
En parallèle, et finement nouée aux destins individuels, se dessine une vaste fresque, celle des trois dernières décennies du XXe siècle qui, dans un emballement progressiste, ont durement mis à mal la nature. Entre la sécheresse de 1976, l’épidémie de la vache folle, la catastrophe de Tchernobyl et la tempête de 1999, la planète semble sans cesse rappeler à l’ordre des êtres humains toujours plus gourmands.
Alors que le personnage principal accompagne la disparition d’une vie paysanne traditionnelle, un nouveau siècle commence, mais le réveillon familial a lieu à la bougie, suite à une tempête sans précédent qui clôt le récit. Le roman propose une radiographie fine et nuancée d’une période qu’il sait faire revivre avec réalisme et acuité : on retrouve les objets, mais aussi les idées à la mode, en passant par la musique, les expressions, les évolutions socio-culturelles... Si les luttes, les progrès, les bouleversements politiques et les catastrophes se répondent à un rythme vertigineux, percutant de plein fouet le quotidien d’une famille française, la nature apparaît de plus en plus comme un refuge, ou un poème, comme dans le regard de l’oncle d’Alexandre, Pierrot. « Avec lui, le coteau était peint du violet éphémère du safran, et le tabac en fleur était un champ de grappes blanches à liseré mauve. »
Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que votre roman recevait le prix Femina de cette année ?
Je garde en tête le fait que ça n’a pas été facile de me faire publier au départ, et que j’ai écrit plusieurs textes avant que mon premier livre ne soit édité. Recevoir ce prix a été un moment de vie très fort, c’est goûter à une forme de reconnaissance par ses pairs, et c’est précieux. Les écrivains sont des êtres qui travaillent tout seuls dans leur atelier, pendant deux ou trois ans, sans la lumière. Subitement le livre sort, et la reconnaissance, quand elle est là, nous porte. J’apprécie de rencontrer mes lecteurs, dans les librairies, les salons, et il y a un moment où on se met à suivre le livre, qui va un peu partout. Malgré cette période complexe, j’ai pu participer à plusieurs de ces échanges de manière traditionnelle, puis à partir d’octobre, par Instagram. J’ai constaté que cet été on avait un peu envie d’oublier la crise sanitaire, et mon lectorat était essentiellement sensible à l’histoire d’amour entre Alexandre et Constanze, qui sous-tend le roman. On n’avait pas envie d’y voir tout ce qui est sous-jacent et tout ce que je remets à la surface, comme le sida, la vache folle, la canicule et tous les méfaits de la mondialisation. Lorsque l’épidémie est devenue plus virulente à l’automne, on a commencé à considérer ces avertissements, aussi bien sur le climat que sur le virus animal, et à percevoir leur écho avec l’actualité. En même temps, l’histoire fait référence à une époque rêvée, celle d’adolescents dont la liberté est assumée, et au regard de notre situation actuelle, cela relève presque de la science-fiction.
Plusieurs producteurs sont intéressés par une adaptation au cinéma de mon texte, ce qui me semble assez complexe, puisqu’on rencontre Alexandre et sa famille à cinq périodes de leur vie.
Le titre de votre roman, Nature humaine, n’est-il pas en lui-même une invitation à la réflexion ?
Nature humaine est une façon de rassembler deux données qu'on a un peu tendance à séparer, alors qu'en fait l'humain est un élément de la nature et donc soumis à ses lois. Le titre le propose, le livre l'expose et le démontre. On avait perdu de vue la profession agricole, et la crise sanitaire nous a remis face à de nombreuses réalités : lorsqu’il a manqué des pâtes dans les rayons en France, on s’est souvenu qu’elles se font avec du blé qui pousse dans des champs… Aujourd’hui, on devient attentif à la manière de travailler des paysans et la société entière se penche sur leur épaule pour connaître leur usage des pesticides et des engrais. Une forme de lien s’est recréée entre les agriculteurs et les citadins, ce qui est manifeste dans le nombre de magasins de producteurs qui contournent la grande distribution qui s’est imposée à partir des années 70, et avec laquelle Alexandre doit composer dans le roman.
Avec le confinement, la campagne a été vécue par beaucoup de Français comme une valeur refuge. Je suis assez attentif aux réseaux sociaux et j’ai vu les plages du bout du monde ou les temples d’Asie disparaître, pour laisser la place aux bourgeons sur les branches ou aux coquelicots dans les champs. Quand j’ai écrit ce roman, j’avais conscience de faire le portrait d’un personnage un peu passéiste, un peu ringard, vivant dans la nature, avec ses vaches et ses prairies, et il est presque devenu avant-gardiste : on a presque tous envie de lui ressembler ! Moi aussi j’ai senti que mon regard sur Alexandre évoluait au moment où le livre est paru.
Dans quelle perspective avez-vous réalisé cette fresque historique dont les questionnements font écho au monde d’aujourd’hui ?
Je voulais attirer l’attention sur ces événements qui adviennent et que l’on oublie, comme les canicules, les tempêtes ou les crises sanitaires. Lorsque Alexandre et Constanze, qui ne se sont pas vus depuis trois ans, se retrouvent au fin fond de l’Aveyron, ils ne peuvent pas faire l’amour car ils n’ont pas de préservatifs. On a oublié à quel point le sida était omniprésent dans les années 80 et 90, pourtant, cette maladie contamine et tue toujours. Il y a une faculté d’oubli qui me fait peur et qui me révolte. Dans le roman, je mets l’accent sur les ammonitrates qui servaient d’explosifs pour les bombes des activistes des années 80. Il y avait à cette époque des attentats plusieurs fois par semaine en France, mais aussi en Italie, en Espagne. 500 tonnes d’ammonitrates ont explosé à Toulouse en 2005, et à Beyrouth ce sont deux mille sept cent tonnes qui ont déclenché les terribles explosions : c’est désespérant. Dans le livre, je mets en scène cette prudence qu’il y avait dans les fermes par rapport à ce type d’engrais ; on faisait attention à ne pas fumer à côté, à ne pas allumer l’électricité… J’ai voulu porter des coups de projecteur sur toutes ces séquences-là que l’on a vues, que l’on a vécues et qu’on a oubliées aussi vite.
Il y a des moments de vie collective qui nous marquent, qui sont une sorte de consigne de nos souvenirs personnels et de nos émotions. J’ai des sensations qui me restent de la sécheresse de 1976, même si j’étais enfant, et je me souviens de l’incompréhension et de la panique qui ont suivi l’annonce de l’accident de Tchernobyl. Ces dates traduisent une forme de divorce entre l’environnement et l’humain.
Comme dans un de vos romans précédents, Repose-toi sur moi (Flammarion, 2016), votre récit tend-il à accompagner la construction complexe du lien amoureux dans la durée, avant qu’il ne soit effectif ?
J’aime bien ces histoires de personnages très différents et même opposés, lui à la campagne et elle en ville, originaire de RDA, où on voit que la rencontre est possible et que ça se passe avant tout d’un être humain à un autre.
Dans la relation entre Alexandre et Constanze, on retrouve la dialectique très actuelle entre local et mondial, et les événements sont polarisés sur la perspective de l’an 2000. Cette date était très présente, même à la fin des années 70 : on se demandait comment serait le monde et, finalement, la tempête de 1999, comme la pandémie actuelle, nous ramène à une prise de conscience, celle d’une humilité nécessaire ; il y a des lois de la nature qui nous dépassent. Pour arrêter ou ralentir un virus, il faut restreindre ses libertés. Les éleveurs et mon personnage Alexandre ne seraient pas étonnés de cela : ils savent comment ça se passe dans un troupeau. Dès le moment où une bête est malade, on l’isole ; le local de quarantaine est un élément du dispositif essentiel. Ce sont des données qui nous renvoient à notre animalité : nous sommes nous aussi des mammifères. D’une certaine façon, c’est la nature qui nous ramène à ses lois.
Nature humaine de Serge Joncour, Flammarion, 2020, 400 p.
commentaires (0)
Commenter