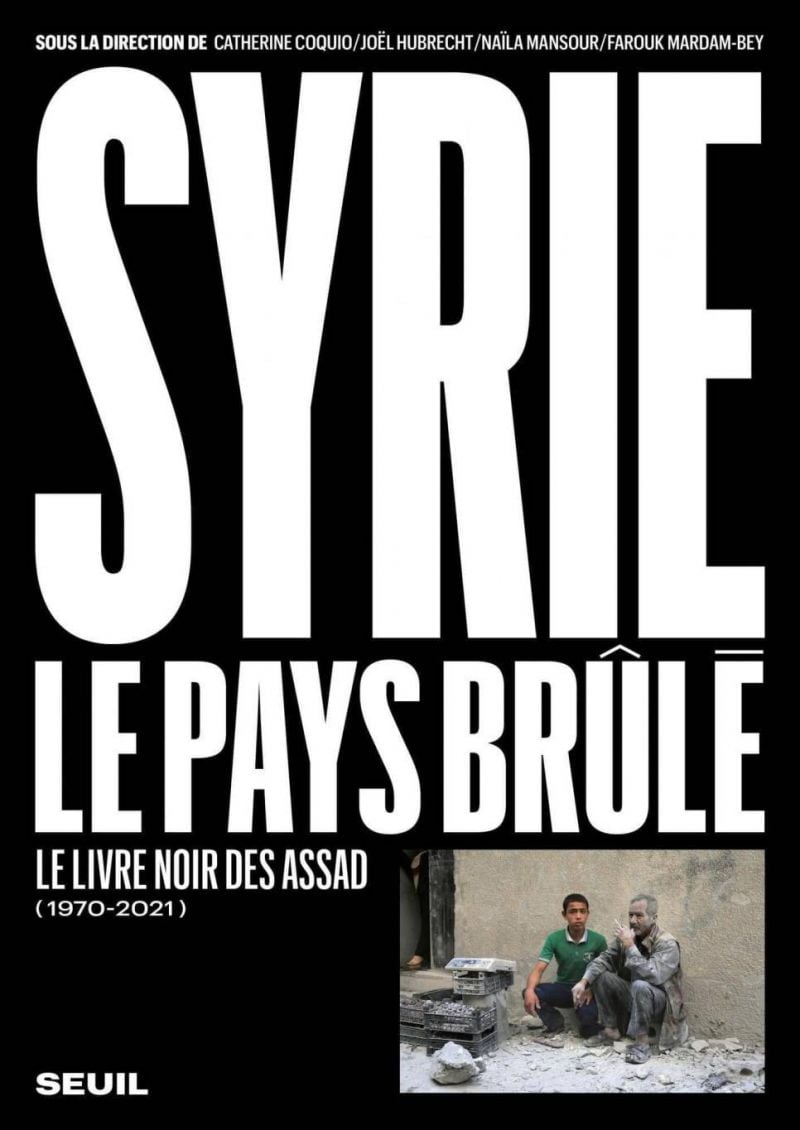
Crédit : D.R
Parler de la Syrie à l’heure de l’Ukraine. Quand le monde lui a tourné le dos, quand la lumière s’est éteinte, quand l’homme de Damas est redevenu fréquentable. L’ouvrage collectif : « Syrie, le pays brûlé – le livre noir des Assad (1970-2021) » (Seuil, 2022) retrace « la mise à mort d’un peuple et de son élan de liberté ». L’inventaire d’un demi-siècle de dictature qui, au détour de centaines de pages de témoignages et d’analyses, dresse en filigrane le portrait d’une époque qui a laissé faire. Farouk Mardam-Bey, ancien conseiller culturel à l’Institut du monde arabe, directeur de collection chez Actes Sud et coauteur de l’ouvrage, revient pour « L’OLJ » sur les conséquences politiques, sociales et mondiales de cette tragédie.
OLJ / Propos recueillis par Stéphanie KHOURI, le 19 novembre 2022 à 00h00
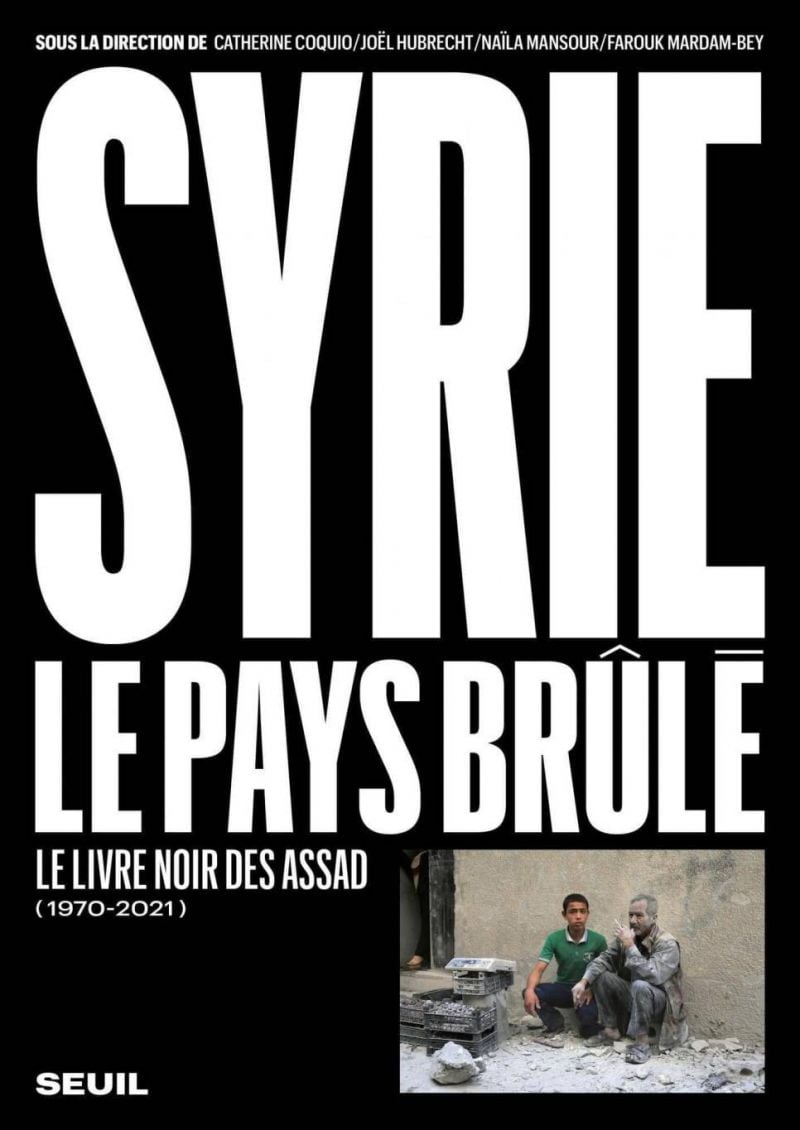
Crédit : D.R
Nous ne pouvons pas nier que tant qu’on a : Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH ) basé à LONDRES, une OeDH( Egypte ) , OtDH ( Tunisie ) ,OaDH (Algerie ) , ET, ET , POURQUOI PAS OkDH (Kenya ) ,ObDH ( Bresil ) ET MÊME OfDH ( France ) nous avons les mêmes risques de RAVAGES : TOUJOURS NE PAS OUBLIER : BASÉE A L O N D R E S …..
Intéressant
commentaires (2)
Nous ne pouvons pas nier que tant qu’on a : Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH ) basé à LONDRES, une OeDH( Egypte ) , OtDH ( Tunisie ) ,OaDH (Algerie ) , ET, ET , POURQUOI PAS OkDH (Kenya ) ,ObDH ( Bresil ) ET MÊME OfDH ( France ) nous avons les mêmes risques de RAVAGES : TOUJOURS NE PAS OUBLIER : BASÉE A L O N D R E S …..
aliosha
11 h 08, le 21 novembre 2022