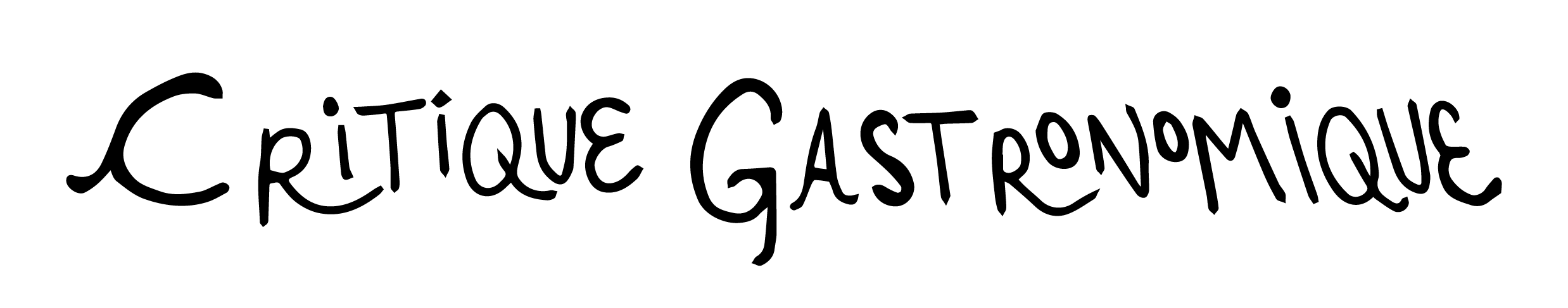Envolées corporelles des ballerines à la souplesse de pâte à modeler, aux gestes de cygnes.
Morceau d’anthologie à la prosodie conventionnelle pour une production colorée et pimentée aux saveurs indiennes, chorégraphiée par Marius Petipa et revisitée ici par Aaron S. Watkin. Un songe romantique aux couleurs brahmanes d’une Inde galante, mystique et cruelle.
Sous les dorures encadrant la scène et sous le médaillon de l’aigle aux yeux perçants et aux ailes déployées, dans la fosse, un des orchestres allemands les plus applaudis. Pour la partition de Ludwig Minkus, arrangée par David Coleman, aussi au pupitre de la direction, le NDR Radiophilharmonique de Hanovre. Impressionnant coup de cymbale pour un lever de rideau dévoilant, dans un décor exotique du pays de Mogli et Bagheera de Kipling, un monde de danse sur chaussons satinés avec tutus frémissants, étoffes saris bariolées, bijoux tintinnabulants et turbans piqués de plumes.
Grâce, équilibre, souplesse, agilité (c’est dans ce spectacle que Rodolf Noureev a ébloui le monde avec ses entrechats électrisés et ses bonds aériens !),
précision et mélodrame pour ce conte de l’amour d’une danseuse, prêtresse sans concessions d’un temple
hindou.
Sous les frondaisons d’une forêt perdue au cœur des terres, des rives du Gange et devant les vieilles pierres d’un temple rongé par les lianes et la verdure, Nikiya, gardienne des lieux, a le cœur qui chavire pour Solor, ce preux guerrier qui n’en pince pas moins pour Hamsatti, fille d’un rajah.
Féroce rivalité de femmes aimant ardemment le même homme et, à part charme et beauté, luttant à armes différentes. L’une avec sa vertu et l’autre avec son rang social... Si le mariage entre le jeune homme et la fille d’un seigneur est prêt d’être officialisé, le serment d’amour entre une fille choisie par les dieux et un homme de courage n’en est pas non plus près d’être rompu.
Passion, jalousie, intrigue, meurtre, passage au royaume des ombres (ce domaine féerique, nervalien par sa folie réservée à l’esprit des «bayadères», terme désignant les danseuses des temples) et intervention divine pour que les deux amants, après des foudres destructrices comme un séisme, reposent enfin dans le nirvana...
Vision en trois actes que cette narration à trame complexe, mais qui se marie très bien avec les lyriques envolées corporelles des ballerines à la souplesse de pâte à modeler, aux gestes de cygnes et des danseurs aux tailles de guêpe, droits comme des ifs et tournoyant comme des toupies.
Si le drame de l’amour est intemporel et universel, La Bayadère colporte aussi toutes les atmosphères et mythologies romantiques: fascination de la mort, chant de la nuit, besoin d’évasion, emprise des passions interdites, amants désunis, attraction pour les mystères de l’au-delà, engouement pour les horizons lointains, femmes entre sacré et profane, entre spiritualité et péché. Mais aussi l’appel au bonheur, à la félicité, aux dépens de toutes considérations terrestres.
Des premiers tableaux brossant les limites d’un univers passionnel entre rituels religieux brahmanes et noces indiennes aux couleurs somptueuses et raffinées, aux scènes d’opium d’avant le cataclysme final, en passant par les limbes de ce royaume des ombres, véritable exercice de style et démonstration de bravoure pour la danse classique en mouvements vaporeux, La Bayadère dégage en toute vivacité la séduction d’un livre d’images adroitement
dessinées.
Images véhiculant, malgré l’explosion et la libération de la danse contemporaine, force, émotion et fougue pour une expression à l’éloquence toujours en vigueur, rebelle à toute catégorisation portant le label de naphtaline ou curiosité du passé... Avec superbe et éclat, la danse classique ici ne perd rien de son lustre.
Pour cette production, authentique fête pour les yeux, tout d’abord la richesse des costumes. Originaux, élégants, rehaussés de broderies fines et taillés avec dextérité pour laisser aux corps toute la liberté d’une gestuelle sans contrainte. Le décor, en carton pâte, suggère un dépaysement de bon aloi pour une Inde de carte postale. Mais sans mièvrerie excessive. Les danseurs, à défaut du brio des solistes du Bolchoï, ne manquent pas de rigueur, même si pour certains grands jetés ou tournoiements (masculins ou féminins) on garde la main sur le cœur pour une cheville qui obéit mollement à la dictature d’une discipline de fer.
La musique, menée de main de véritable maestro par David Coleman, reste un des atouts majeurs de cette création mêlant avec panache, même pour les échaudés de la danse de ballet classique, féerie et intermittences de cœur à la mode romantique.
Un voyage hors du temps sur les ailes d’un rêve indien porté par les tulles et les gazes des Brummel et des Elvire de tous les temps...