
Alexandre Najjar : « Pour un romancier, la ligne de démarcation (pour employer un mot hérité de la guerre !) entre réel et imaginaire n’existe pas. » Photo DR
« Le Syndrome de Beyrouth » ne s’inscrit-il pas entre la chronique fortement documentée, le romanesque et l’essai ?
En effet, c’est un roman hybride, une fresque où s’entremêlent réalité et fiction, selon une technique déjà adoptée dans plusieurs de mes romans, notamment Les Exilés du Caucase, Le Roman de Beyrouth et Berlin 36. Pour un romancier, la ligne de démarcation (pour employer un mot hérité de la guerre !) entre réel et imaginaire n’existe pas. Il se nourrit de ce qui existe, et son imaginaire vient compléter ou transfigurer la réalité.
Il s’agit d’un survol de l’histoire contemporaine de Beyrouth, de l’an 2000 à nos jours, avec son lot de faux espoirs, de malheurs, de sursauts... le tout sous-tendu par une approche poétique, surtout dans l’épilogue où je compare le Liban à la mer.
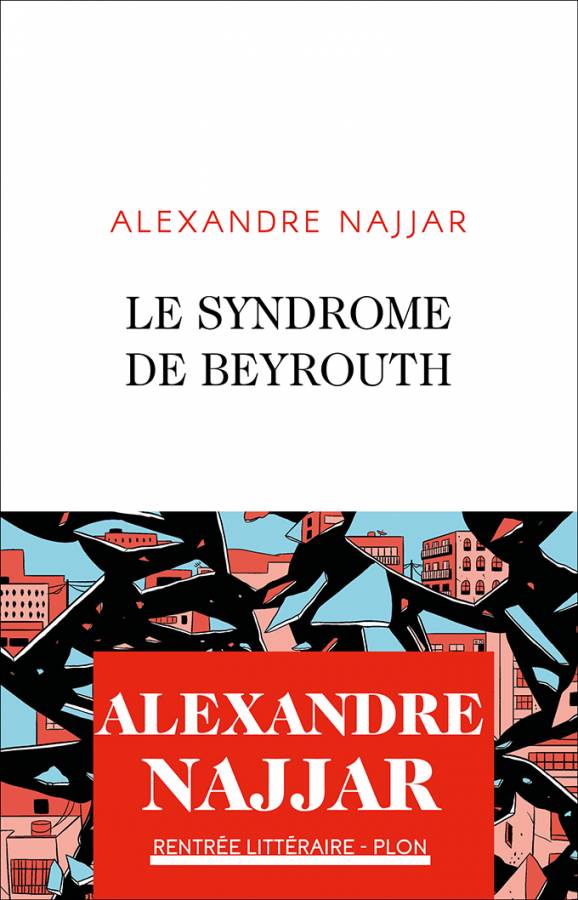 La couverture de l’ouvrage.
La couverture de l’ouvrage.
La structure ternaire du livre accorde une place déterminante aux années 2000-2019 que vous résumez par la formule « la loi des séries ». Cette période ne cristallise-t-elle pas les racines du mal que nous connaissons actuellement au Liban ?
Cette époque représente une série inimaginable de catastrophes, avec des dizaines d’attentats qui parfois se ressemblent, des guerres, trois révolutions et, comble du malheur, l’explosion du 4 août. Comment un si petit pays a-t-il pu supporter autant de coups en vingt ans ? Comment le peuple libanais a-t-il pu encaisser tout cela ? Cette période est aussi révélatrice de ce que vous appelez à juste titre « les racines du mal » : des occupations ou « tutelles » qui ont laissé des séquelles, une classe politique qui ne s’est pas renouvelée au lendemain de la guerre, si bien que nous avons confié le pays aux mafieux qui l’ont détruit. Sans oublier la corruption à tous les étages, un confessionnalisme qui fait que l’appartenance communautaire prime sur l’appartenance nationale et une perméabilité fatale aux ingérences étrangères, de sorte que le Liban est toujours un échiquier où les puissances régionales et les grandes puissances placent et avancent leurs pions...
À travers le personnage d’Amira, avez-vous souhaité mettre des mots sur les oscillations mentales constantes de nombreux Libanais de l’étranger, qui ne cessent de se demander comment serait leur vie s’ils revenaient s’installer dans leur pays, entretenant un fantasme nourri de fascination et de terreur ?
Sans doute. Nous abandonnons le pays parce qu’il est instable et invivable, mais nous y revenons par nostalgie et en raison des attaches familiales. La narratrice Amira aime profondément le Liban, elle s’est même battue pendant la guerre pour sa survie. Exilée en France, elle saute sur l’occasion qui se présente à elle pour rentrer au bercail. Mais ce qui l’attend au pays est bien au-delà de ce qu’elle aurait imaginé. Le Liban est un peu comme un mari infidèle qui trahit sans cesse son épouse. Elle lui pardonne son instabilité parce qu’elle l’aime, mais elle finit un jour par jeter l’éponge.
Le destin romanesque des personnages replonge le lecteur dans une vie culturelle libanaise riche et animée, autour de grandes figures dont on retrouve à la fois la réflexion et l’humanité dans votre livre, comme Ghassan et Gebran Tuéni, Samir Kassir, May Menassa, May Chidiac et bien d’autres. Quel est le sens de l’évocation de tous ceux qui ont lutté jusqu’au bout pour un pays à la hauteur de leurs idéaux ?
Ce roman est aussi un hommage aux journalistes, à ceux qui ont milité pour la liberté d’expression et qui ont parfois payé très cher le prix de leur combat. Ghassan Tuéni, que j’ai bien connu et qui était un homme exceptionnel, est omniprésent dans ce livre qui entend saluer son parcours à la tête du quotidien an-Nahar. Gebran, Samir, May... sont aussi devenus des symboles de la lutte pour la liberté.
Finalement, après l’explosion, Amira rend les armes et choisit de quitter Beyrouth. Avez-vous souhaité tenter de comprendre le découragement collectif qui a accompagné ce drame, et mettre des mots sur la tristesse et l’amertume de ceux qui se sont résignés à quitter leur pays ?
L’explosion du 4 août a été la tragédie de trop. Le dégoût a succédé à la colère et provoqué le découragement actuel, exacerbé par une crise économique impitoyable qui saigne à blanc la population. Le salut viendra du verdict de la justice, car la vérité est un droit et un devoir. En nous la révélant enfin, en dénonçant les coupables, le juge Tarek Bitar pourra apaiser quelque peu la douleur des familles éplorées et celle des survivants, car l’impunité amplifie leur souffrance...
« Le Syndrome de Beyrouth » fait référence à une tendance outrée à la résilience, qui est une notion récurrente pour parler du Liban. Tendez-vous à montrer dans votre ouvrage que celle-ci a deux visages et qu’elle a un aspect dangereux qui empêche le pays d’évoluer ?
La résilience est une arme à double tranchant. Elle permet certes de survivre, d’encaisser les coups, mais c’est aussi une sorte d’anesthésie, voire un acte de lâcheté dans la mesure où elle annihile le besoin de révolte. Mon héroïne s’insurge contre ce sentiment pernicieux qui consiste à apprivoiser le mal au lieu de le combattre !
Dans quelle mesure vos activités d’avocat et d’écrivain sont-elles liées ?
Le grand juriste égyptien al-Sanhouri rappelle à juste titre que les avocats étaient autrefois des philosophes et que nombre d’avocats sont aussi écrivains. L’avocat et l’écrivain ont en partage l’amour des mots et le souci du terme approprié, ainsi que la quête de la vérité et la défense des libertés. L’avocat est un homme d’action ; l’écrivain, un homme de réflexion : pour moi, ces deux activités se complètent.
Le frère de l’héroïne, Alfred, est magistrat. Son souci de la mesure et de l’équité contraste avec un contexte de corruption généralisée, dont il déplore régulièrement l’ampleur. Dans quelle mesure partagez-vous sa vision de la justice libanaise ?
Je la partage tout à fait. Nous avons encore d’excellents juges, Dieu merci, mais de façon générale, notre justice est moribonde et j’ai le sentiment qu’il y a une volonté délibérée de la détruire pour saper l’un des derniers fondements de notre pays. Les dérapages inadmissibles de certains magistrats « politisés » qui se croient au-dessus des lois, au milieu du silence complice de l’inspection judiciaire, le gel des permutations judiciaires et la lenteur dans le vote de la loi sur l’indépendance de la magistrature aggravent hélas l’état inquiétant de notre justice déliquescente.
Lors de la crise d’Électricité du Liban, Amira, qui est journaliste au « Nahar », constate que la véritable crise n’est pas d’ordre technique, mais d’ordre éthique. Son analyse n’est-elle pas applicable à d’autres domaines ?
Certainement. Les professions d’avocat et de médecin sont par exemple fondées sur l’éthique, et chacune dispose d’un code en ce sens. Le Liban est hélas gangrené par la corruption et on a récemment assisté aux « exploits » scandaleux de nombreux profiteurs qui ont entreposé essence et médicaments à des fins mercantiles... On se croirait pendant la Grande Guerre où certains, exploitant la famine et la détresse des citoyens, avaient troqué une galette de pain contre une maison.
Dans le contexte libanais actuel, quel est le sens de votre candidature en tant que bâtonnier ? Est-ce un moyen de ne pas abdiquer dans un pays où, selon votre roman, l’enjeu est avant tout une quête de justice ?
Dans le contexte actuel, on peut soit renoncer et regarder couler le navire de la justice, soit retrousser ses manches et essayer de le renflouer pour le mener à bon port. J’ai choisi la seconde option en présentant ma candidature aux fonctions de membre du conseil de l’ordre et de bâtonnier pour les élections de novembre 2021. J’ai trente ans de carrière, je connais bien les rouages du barreau, puisque j’ai été membre ou président de plusieurs comités au sein de l’ordre, dont le comité de la francophonie. Mon premier souci sera d’améliorer les conditions d’exercice de la profession d’avocat étouffée par la crise économique, la pandémie et les grèves successives. L’ordre des avocats de Beyrouth a aussi une dimension nationale : il a un rôle à jouer tant au niveau du respect nécessaire des échéances électorales à venir qu’au niveau de la protection des libertés publiques et des droits du consommateur ou du déposant. Être bâtonnier est un défi que je suis prêt à relever...
Le lecteur revit avec un pincement au cœur la liesse populaire qui a gagné Beyrouth lors des premiers jours de la révolution d’octobre. À votre avis, dans un pays exsangue, où en est la révolution aujourd’hui ? En filigrane, peut-on lire « Le Syndrome de Beyrouth » comme une invitation à poursuivre la lutte, malgré tout ?
Bien sûr. Cette révolution, je la préconisais déjà dans mon roman Athina paru en 2000 et dans mes éditoriaux de L’Orient littéraire, notamment dans Mafiature et Les Marchands du temple... On ne peut pas baisser les bras. Mais il faut repenser la révolution. Puisque les manifestants sont freinés dans leur élan par la présence de partis armés, il faudra mener la bataille des élections législatives pour espérer un changement. Or cette échéance exige deux conditions : un programme unifié, à l’instar de la charte de salut national, et des leaders bien identifiés, prêts à mener campagne. Il faudra éviter à tout prix l’erreur des « Gilets jaunes » en France, qui ont lamentablement échoué aux élections européennes.
Une femme meurtrie et digne, à l’image de Beyrouth
« Cette femme meurtrie et digne à l’image de Beyrouth, ville féminine par excellence, m’a tellement touché lors de notre rencontre dans le train reliant Paris à Saint-Malo, que je n’ai pu m’empêcher de la solliciter pour recueillir son histoire. » C’est ainsi que le narrateur du Syndrome de Beyrouth introduit le récit qu’il va livrer à son lecteur, qui relate la trajectoire d’Amira Mitri, une ancienne combattante pendant la guerre civile, qui a quitté le Liban à vingt ans pour s’installer à Paris. Elle y revient en l’an 2000 pour être reporter au sein du quotidien an-Nahar. « Pourra-t-elle parler d’elle-même et de sa ville natale en même temps, sans que les deux récits se télescopent ? » se demande le narrateur, suggérant un croisement complexe et dramatique entre les péripéties sanglantes qui se succèdent et une vie amoureuse bouleversée.Le retour au pays s’avère plus difficile que ce que l’héroïne imaginait. « Tfeh ! Ce pays, qui se targuait d’avoir donné l’alphabet au monde, qui comptait des sites archéologiques de toute beauté et exportait des “cerveaux” dans le monde entier, en était réduit à cet état tiers-mondiste à cause de l’incurie d’une classe politique corrompue et incompétente ! » Néanmoins, on retrouve avec une certaine nostalgie l’enthousiasme qu’ont pu connaître bon nombre de Libanais lors de la reconstruction de la capitale. « Nous eûmes, je l’avoue, une période d’euphorie. Beyrouth reprenait forme. La ligne de démarcation s’était estompée, laissant la place à des immeubles neufs, alors que les rues Foch et Allenby avaient été reconstruites à l’identique. La rue Maarad avec ses arcades rappelait le centre historique de Bologne et évoquait les toiles de Giorgio De Chirico, et la place de l’Étoile, où des enfants s’en venaient faire un tour à bicyclette, respirait de nouveau face au Parlement et vivait au rythme de l’horloge al-Abed replantée en son centre. » Cet état de grâce est de courte durée, et « la loi des séries », selon la formule de celui qui a déjà publié une trentaine d’ouvrages, se matérialise par une kyrielle d’attentats à l’encontre de ceux qui expriment des revendications libertaires et démocratiques. C’est finalement la tragédie du 4 août qui met un point final aux espoirs d’Amira, qui décide de s’installer à Saint-Malo, la ville d’origine de celui qu’elle a aimé, et qui a disparu dans les décombres de l’explosion. « Khalas. C’est fini. J’ai pris la décision de quitter mon pays, de ne plus me laisser appâter par ce miroir aux alouettes, de ne plus lui donner l’occasion de me trahir chaque fois que je lui fais confiance, de cesser de le considérer comme le nombril du monde en glorifiant ses atouts sans voir, aveugle volontaire, les vices qui l’abîment tellement qu’il est devenu, pour ainsi dire, irréparable, bon pour la casse. »



commentaires (1)
Ils seront tous là et leurs photos dans les journaux à vouloir vendre leurs livres et leurs œuvres littéraires et historiques après coup alors que le Liban a besoin d’eux maintenant. Où sont les élites du pays pour dénoncer ce qui se passe et se mettre en première ligne pour venir au secours de leur patrie dont ils ne se rappellent à son souvenir que pour relater les guerres la misère et l’injustice. Mon cri n’est pas uniquement à l’attention des écrivains, poètes et historiens, ils est aussi destiné à toutes les élites de ce pays qu’on n’a ni vu ni entendu même après le cataclysme qui s’était produit en août et qui a semé la mort et l’écroulement de ce pays. A part un manifeste qui rendait hommage à Monsieur Slim ils sont tous restés à l’ombre et hors de portée en attendant que tout se décante pour réapparaître et nous inonder de leurs produits ou de leur savoir.
Sissi zayyat
17 h 55, le 02 septembre 2021