
Kaouther Ben Hania : « Les réfugiés qui déferlaient en Europe incarnaient à mon sens et d’une manière très intense l’idée du corps en danger et celle de la quête de liberté. »
Dans The Man Who Sold his Skin de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, Yahya Mahayni joue son premier grand rôle au cinéma. Il incarne Sam Ali, un jeune homme de Raqqa amoureux de Abeer, interprétée par Dea Liane. Pour des raisons sécuritaires, il se voit contraint de fuir la ville après un passage en prison, et se retrouve au Liban, pays accueillant et frontalier de la Syrie.
Une rencontre fortuite avec un célèbre artiste américain, Jeffrey Godefroi, incarné par l’acteur flamand Koen De Bouw, et son assistante Soraya (la très blonde Monica Bellucci) va pousser Sam à se vendre pour obtenir la liberté de voyager. L’artiste (comme l’avait fait en réalité l’artiste belge Wim Delvoye qui avait présenté son œuvre au musée du Louvre, à Paris, en 2012) utilise le dos de Sam pour graver l’énorme tatouage d’un visa Schengen, nécessaire pour entrer en Europe. Au musée ou dans une galerie, Sam se dénude jusqu’à la taille et s’assoit sur un socle pour exposer son dos au public. Les visiteurs, qu’il ne verra jamais, défilent, font des remarques et des blagues cruelles qu’il n’entendra pas. Lui se protège en se réfugiant dans ses écouteurs connectés à son MP3. Il n’a jamais craqué publiquement, jusqu’au jour où il veut reprendre sa vie en main.
À la manière d’une intrigue, Kaouther Ben Hania tisse dans son récit des questions sociopolitiques, y compris la crise des réfugiés et les droits de l’homme, parvenant même à laisser se profiler une satire mordante du monde de l’art. Tourné par Christopher Aoun (responsable des superbes graphismes de Capharnaüm), le film est une magnifique fable, presque dans les règles parfaites d’un conte de fées, malgré son lourd sujet. Kaouther Ben Hania a répondu aux questions de L’Orient-Le Jour lors d’un entretien téléphonique.
 Une image tirée du film « The Man Who Sold his Skin ». Photos DR
Une image tirée du film « The Man Who Sold his Skin ». Photos DR
Comment votre passion pour le cinéma est-elle née alors que vous vous étiez plutôt destinée à l’écriture ?
C’est une longue histoire. Ce n’est pas un film qui m’a donné envie de faire du cinéma, mais tout le cinéma en soi. J’ai commencé par réfléchir à ce que le cinéma m’apportait. J’ai intégré les ciné-clubs en Tunisie et la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. Je fréquentais des cinéphiles, je découvrais les films d’auteur, ceux d’Europe de l’Est, mais aussi les films russes, la Nouvelle Vague, Bergman, Fellini, et tout cet univers que je ne connaissais pas, moi qui avais grandi avec les films égyptiens et ceux de Bollywood.
Quand j’ai tenté (en 2005) de faire mon premier court-métrage de fiction en 35 mm, l’expérience s’est avérée plutôt compliquée. Je n’avais pas les outils nécessaires ni l’autorité suffisante pour faire de la réalisation. Je suis passée par un moment de découragement et de flottement. Ce sont les films documentaires qui allaient me réconcilier avec la réalisation et surtout les mockumentaries (documentaire parodique ou de fiction). Je trouvais ce rapport au réel et cette façon de raconter une histoire fascinants. On aborde la fiction, mais avec les outils et l’esthétique du documentaire. J’ai décidé de réaliser mon premier mockumentary, Le Chalat de Tunis. Ma voie était tracée.
À l’origine de ce projet, il y a « L’homme au dos tatoué » de Wim Delvoye. Comment l’histoire d’un refugié syrien est-elle venue se greffer au récit ?
L’œuvre de Wim Delvoye était certainement à l’origine du projet. Le film restait cependant désincarné, du moment que je n’avais pas encore le personnage principal. Je ne trouvais pas intéressant ou passionnant, du point de vue du récit, de relater l’histoire réelle de Tim Steiner (l’homme qui a prêté son dos à Wim Delvoye). Je voulais recréer ma propre histoire. À l’époque, j’avais beaucoup d’amis dans la communauté syrienne, et j’embrassais indirectement leur combat. Mon personnage allait être un réfugié syrien en quête de liberté, c’était comme une évidence. Voilà comment est né Sam Ali. Les réfugiés qui déferlaient en Europe incarnaient à mon sens et d’une manière très intense l’idée du corps en danger et celle de la quête de liberté, quelque chose de l’ordre du macabre et du réel, quelque chose de l’ordre de l’abstrait. Le mystère de la vie, avec les rencontres et les influences, a fait que le tissage a opéré.
Quel était votre rapport à l’art en général et à l’art contemporain et conceptuel en particulier avant de réaliser le film ? D’avoir exploré cet univers en profondeur a-t-il modifié votre vision des choses ?
Mon rapport à l’art était celui d’intérêt à l’art en général, le rapport d’un spectateur amoureux de l’art et qui s’intéresse à toutes ses formes, le cinéma évidemment, mais aussi les musées, le théâtre, la bande dessinée, la musique, etc.
Ce rapport a clairement été modifié quand j’ai voulu faire ce film. J’ai plongé dans les méandres de l’institution qui est devenue un objet de recherche en soi. Il m’apparaissait clairement que l’art contemporain n’était pas uniquement des œuvres que l’on expose, mais toute une institution avec un mécanisme très complexe, entre galeristes, artistes, marchands et collectionneurs. J’ai exploré les codes, les chiffres, les rouages des ventes aux enchères, la circulation des œuvres et tout le jargon propre à cet univers. C’était tout un système que je découvrais. Dans mon film La Belle et la meute, j’ai voulu comprendre les fonctionnements des rapports de pouvoir et de force de la police. The Man Who Sold his Skin est une réflexion satirique sur le monde de l’art moderne, où à peu près tout se passe. Mais pas que… C’est aussi une fable.
La perfection esthétique du film, vos plans bien léchés et la formidable lumière ont quelquefois tendance à nous éloigner du sujet de fond, le drame des réfugiés...
Les images esthétiques viennent d’une idée qui a pénétré notre inconscient collectif, celle qui sous-entend que filmer les réfugiés et les guerres doit répondre à une stylistique documentaire, ce que le cinéma fait beaucoup. Le mimétisme est très utilisé pour corroborer la réalité dans un récit (que ce que je raconte est vrai et le récit est plus vrai que la vérité). Ce n’était pas du tout mon intention. Je voulais m’éloigner du récit avec la caméra portée à l’épaule pour appuyer la véracité du propos.
Mon but était de raconter une fable. C’est le voyage d’un prince qui, pour sauver sa princesse, accepte un pacte faustien. À mes yeux, le monde des réfugiés est très mythologique, du fait des déplacements et des épreuves qu’ils traversent. À sa manière, Sam est un peu Ulysse qui part en voyage et qui doit affronter les monstres et les difficultés sur son chemin. Christopher Aoun, mon chef opérateur, a fait un travail remarquable, en réussissant le pari de jongler entre images naturalistes et images lyriques. Sa palette de travail extraordinaire lui permet de « switcher » selon le contexte. Il a beaucoup contribué à la réussite du film tel que je le voulais.
Votre choix de casting ?
Le casting s’est fait d’une manière presque inconsciente. Comme le rôle principal avait été attribué à un intrus qui n’appartient pas au monde de l’élite, j’ai voulu intégrer Monica Bellucci, qui appartient à un monde chic, et Koen De Bouw, comédien belge à forte notoriété. J’ai donc confronté des stars à des intrus, Dea Liane (qui incarne Abeer) étant surtout une actrice de théâtre. Il y a quelque chose de l’ordre de la rencontre, comme dans l’histoire. Chaque acteur apporte au personnage une part de son vécu.
Y a-t-il un aspect particulier de votre film que l’on doit retenir ?
Au spectateur de retenir ce qui le touche le plus. J’ai voulu mon film comme une partition de musique avec toutes ses tonalités. Le travail que j’ai accompli est organiquement lié, et chaque partie sert l’autre. On passe de l’humour à la politique, de l’amour au cynisme. C’est aussi la connexion entre deux mondes totalement opposés, celui de l’art contemporain et celui des réfugiés. Le concept de liberté reste cependant très important. Dans le cas de mon film, il s’agit d’une liberté interdite et pour laquelle Sam se bat, quitte à vendre son âme au diable.
Récompenses
The Man Who Sold his Skin a déjà été primé lors de nombreux festivals : meilleur scénario à Stockholm, meilleur long-métrage de fiction arabe à el-Gouna (Égypte), prix Edipo Re pour l’inclusion et meilleur acteur à la Mostra de Venise, ou encore grand prix du public et prix du jeune jury à Arte Mare…
Rendez-vous online
The Man Who Sold his Skin (« L’homme qui a vendu sa peau ») de Kaouther Ben Hania sera diffusé en ligne le dimanche 28 février 2021 à 18h (heure de Beyrouth) en version originale avec sous-titres anglais.
Le film sera suivi à 20h par une discussion sur la plateforme Zoom autour du thème « Arts et réfugiés, au-delà des frontières ». Le débat, mené par Joumana Rizk, réunira autour de la réalisatrice Nasser Yassin, professeur et chercheur (AUB), et Harry Bellet, écrivain et critique d’art (Le Monde).
Réservation nécessaire au : www.beirutartfilmfestival.com

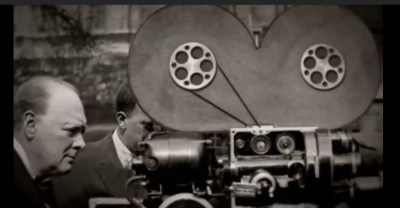

commentaires (0)
Commenter